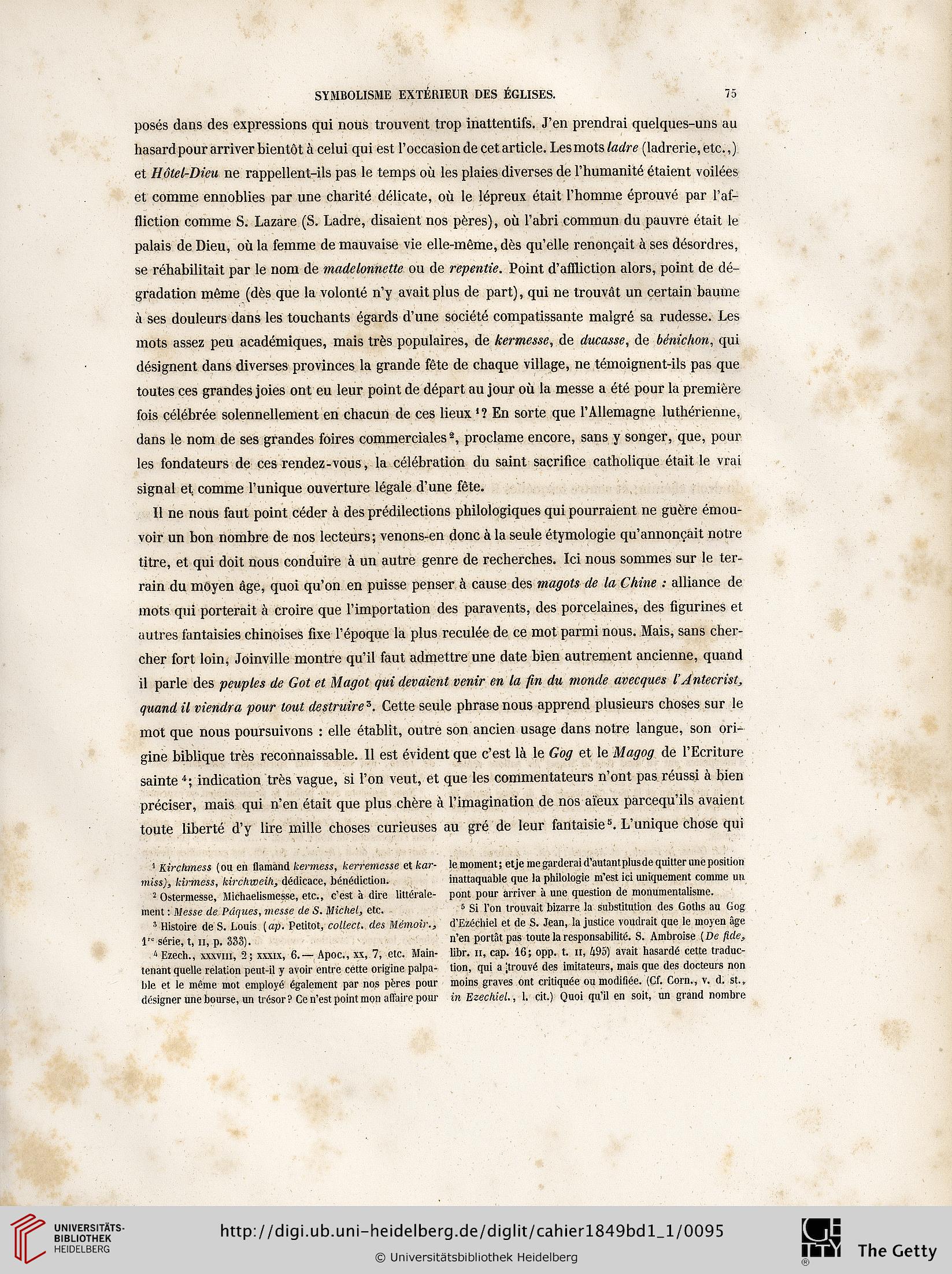SYMBOLISME EXTÉRIEUR DES ÉGLISES.
/3
posés dans des expressions qui nous trouvent trop inattentifs. J'en prendrai quelques-uns au
hasard pour arriver bientôt à celui qui est l'occasion de cet article. Les mots (ladrerie, etc.,)
et ne rappellent-ils pas le temps où les plaies diverses de l'humanité étaient voilées
et comme ennoblies par une charité délicate, où le lépreux était l'homme éprouvé par l'af-
fliction comme S. Lazare (S. Ladre, disaient nos pères), où l'abri commun du pauvre était le
palais de Dieu, où la femme de mauvaise vie elle-même, dès qu'elle renonçait à ses désordres,
se réhabilitait par le nom de ou de rd/M?2?2^. Point d'affliction alors, point de dé-
gradation même (dès que la volonté n'y avait plus de part), qui ne trouvât un certain baume
à ses douleurs dans les touchants égards d'une société compatissante malgré sa rudesse. Les
mots assez peu académiques, mais très populaires, de Adr#2dMd, de 2Ù2f%Md, de àcmcAoM, qui
désignent dans diverses provinces la grande fête de chaque village, ne témoignent-ils pas que
toutes ces grandes joies ont eu leur point de départ au jour où la messe a été pour la première
fois célébrée solennellement en chacun de ces lieux *? En sorte que l'Allemagne luthérienne,
dans le nom de ses grandes foires commerciales s, proclame encore, sans y songer, que, pour
les fondateurs de ces rendez-vous, la célébration du saint sacrifice catholique était le vrai
signal et comme l'unique ouverture légale d'une fête.
H ne nous faut point céder à des prédilections philologiques qui pourraient ne guère émou-
voir un bon nombre de nos lecteurs; venons-en donc à la seule étymologie qu'annonçait notre
titre, et qui doit nous conduire à un autre genre de recherches. Ici nous sommes sur le ter-
rain du moyen âge, quoi qu'on en puisse penser à cause des 7?22%rof3 & ; alliance de
mots qui porterait à croire que l'importation des paravents, des porcelaines, des figurines et
autres fantaisies chinoises fixe l'époque la plus reculée de ce mot parmi nous. Mais, sans cher-
cher fort loin, Joinville montre qu'il faut admettre une date bien autrement ancienne, quand
il parle des tù? Cof c? <7222 &27%2<?w? pcm'r cw /% /Ù2 2/22 222022& %Pdc<y22dF
272222222/ 2/ 2^2^222/^22 poMr ^022/ 2/^/2-2222-2? s. Cette seule phrase nous apprend plusieurs choses sur le
mot que nous poursuivons : elle établit, outre son ancien usage dans notre langue, son ori-
gine biblique très reconnaissable. 11 est évident que c'est là le et le de l'Ecriture
sainte indication très vague, si l'on veut, et que les commentateurs n'ont pas réussi à bien
préciser, mais qui n'en était que plus chère à l'imagination de nos aïeux parcequ'ils avaient
toute liberté d'y lire mille choses curieuses au gré de leur fantaisie^. L'unique chose qui
* Xù'c/Mn&ss (ou en flamand /cerrezncMe et fcar-
wissy, Adrcdtveid; dédicace, bénédiction.
2 Ostermesse, Michaelismcsse, etc., c'est à dire littérale-
ment : Megge de PdqMas, MiM.se de 3. MîcdeG etc.
^ Histoire de S. Louis (ap. Petitot, codecL des Më?noû*.^
1" série, t, ii, p. 333).
AEzech., xxxvm, 2; xxxix, 6.— Apoc., xx, 7, etc. Main-
tenant quelle relation peut-il y avoir entre cette origine palpa-
ble et le même mot employé également par nos pères pour
désigner une bourse, un trésor ? Ce n'est point mon affaire pour
le moment; etje me garderai d'autant plus de quitter une position
inattaquable que la philologie m'est ici uniquement comme un
pont pour arriver à une question de monumentalisme.
s Si l'on trouvait bizarre la substitution des Gotlis au Gog
d'Ezéchiel et de S. Jean, la justice voudrait que le moyen âge
n'en portât pas toute la responsabilité. S. Ambroise (De /2d<?.,
libr. n, cap. 16; opp. t. n, A95) avait hasardé cette traduc-
tion, qui a (trouvé des imitateurs, mais que des docteurs non
moins graves ont critiquée ou modifiée. (Cf. Corn., v. d. st.,
ùt Ezec/deL, 1. cit.) Quoi qu'il en soit, un grand nombre
/3
posés dans des expressions qui nous trouvent trop inattentifs. J'en prendrai quelques-uns au
hasard pour arriver bientôt à celui qui est l'occasion de cet article. Les mots (ladrerie, etc.,)
et ne rappellent-ils pas le temps où les plaies diverses de l'humanité étaient voilées
et comme ennoblies par une charité délicate, où le lépreux était l'homme éprouvé par l'af-
fliction comme S. Lazare (S. Ladre, disaient nos pères), où l'abri commun du pauvre était le
palais de Dieu, où la femme de mauvaise vie elle-même, dès qu'elle renonçait à ses désordres,
se réhabilitait par le nom de ou de rd/M?2?2^. Point d'affliction alors, point de dé-
gradation même (dès que la volonté n'y avait plus de part), qui ne trouvât un certain baume
à ses douleurs dans les touchants égards d'une société compatissante malgré sa rudesse. Les
mots assez peu académiques, mais très populaires, de Adr#2dMd, de 2Ù2f%Md, de àcmcAoM, qui
désignent dans diverses provinces la grande fête de chaque village, ne témoignent-ils pas que
toutes ces grandes joies ont eu leur point de départ au jour où la messe a été pour la première
fois célébrée solennellement en chacun de ces lieux *? En sorte que l'Allemagne luthérienne,
dans le nom de ses grandes foires commerciales s, proclame encore, sans y songer, que, pour
les fondateurs de ces rendez-vous, la célébration du saint sacrifice catholique était le vrai
signal et comme l'unique ouverture légale d'une fête.
H ne nous faut point céder à des prédilections philologiques qui pourraient ne guère émou-
voir un bon nombre de nos lecteurs; venons-en donc à la seule étymologie qu'annonçait notre
titre, et qui doit nous conduire à un autre genre de recherches. Ici nous sommes sur le ter-
rain du moyen âge, quoi qu'on en puisse penser à cause des 7?22%rof3 & ; alliance de
mots qui porterait à croire que l'importation des paravents, des porcelaines, des figurines et
autres fantaisies chinoises fixe l'époque la plus reculée de ce mot parmi nous. Mais, sans cher-
cher fort loin, Joinville montre qu'il faut admettre une date bien autrement ancienne, quand
il parle des tù? Cof c? <7222 &27%2<?w? pcm'r cw /% /Ù2 2/22 222022& %Pdc<y22dF
272222222/ 2/ 2^2^222/^22 poMr ^022/ 2/^/2-2222-2? s. Cette seule phrase nous apprend plusieurs choses sur le
mot que nous poursuivons : elle établit, outre son ancien usage dans notre langue, son ori-
gine biblique très reconnaissable. 11 est évident que c'est là le et le de l'Ecriture
sainte indication très vague, si l'on veut, et que les commentateurs n'ont pas réussi à bien
préciser, mais qui n'en était que plus chère à l'imagination de nos aïeux parcequ'ils avaient
toute liberté d'y lire mille choses curieuses au gré de leur fantaisie^. L'unique chose qui
* Xù'c/Mn&ss (ou en flamand /cerrezncMe et fcar-
wissy, Adrcdtveid; dédicace, bénédiction.
2 Ostermesse, Michaelismcsse, etc., c'est à dire littérale-
ment : Megge de PdqMas, MiM.se de 3. MîcdeG etc.
^ Histoire de S. Louis (ap. Petitot, codecL des Më?noû*.^
1" série, t, ii, p. 333).
AEzech., xxxvm, 2; xxxix, 6.— Apoc., xx, 7, etc. Main-
tenant quelle relation peut-il y avoir entre cette origine palpa-
ble et le même mot employé également par nos pères pour
désigner une bourse, un trésor ? Ce n'est point mon affaire pour
le moment; etje me garderai d'autant plus de quitter une position
inattaquable que la philologie m'est ici uniquement comme un
pont pour arriver à une question de monumentalisme.
s Si l'on trouvait bizarre la substitution des Gotlis au Gog
d'Ezéchiel et de S. Jean, la justice voudrait que le moyen âge
n'en portât pas toute la responsabilité. S. Ambroise (De /2d<?.,
libr. n, cap. 16; opp. t. n, A95) avait hasardé cette traduc-
tion, qui a (trouvé des imitateurs, mais que des docteurs non
moins graves ont critiquée ou modifiée. (Cf. Corn., v. d. st.,
ùt Ezec/deL, 1. cit.) Quoi qu'il en soit, un grand nombre