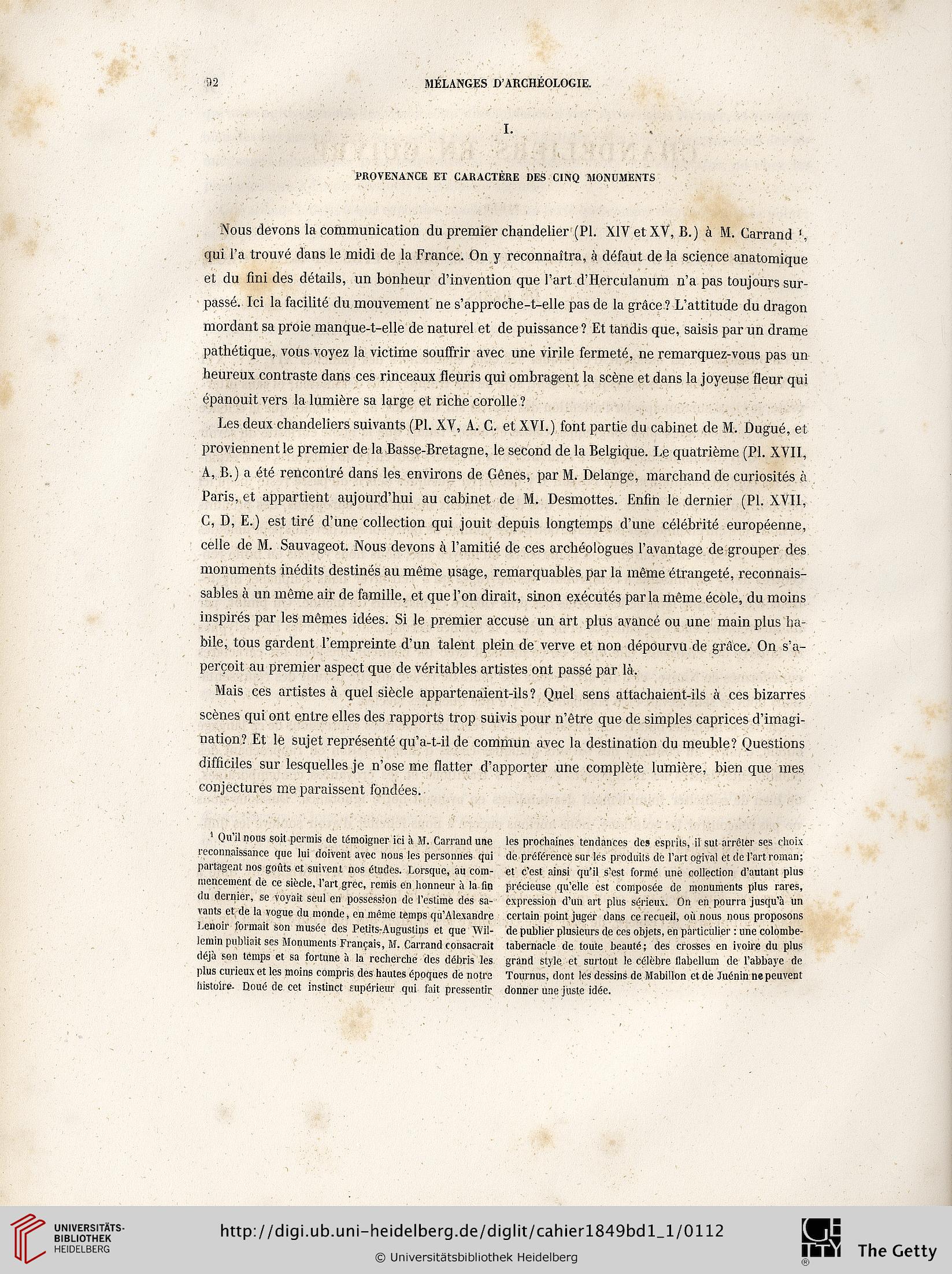92
MÉLANGES D'ARCHÉOLOGIE.
I.
PROVENANCE ET CARACTÈRE DES CtNQ MONUMENTS
Nous devons la communication du premier chandelier (PI. XIV et XV, B.) à M. Carrand
qui l'a trouvé dans le midi de la France. On y reconnaîtra, à défaut de la science anatomique
et du fini des détails, un bonheur d'invention que l'art d'Herculanum n'a pas toujours sur-
passé. Ici la facilité du mouvement ne s'approche-t-elle pas de la grâce ? L'attitude du dragon
mordant sa proie manque-t-elle de naturel et de puissance ? Et tandis que, saisis par un drame
pathétique, vous voyez la victime souffrir avec une virile fermeté, ne remarquez-vous pas un
heureux contraste dans ces rinceaux fleuris qui ombragent la scène et dans la joyeuse fleur qui
épanouit vers la lumière sa large et riche corolle?
Les deux chandeliers suivants (PL XV, A. G. et XVI.) font partie du cabinet de M. Dugué, et
proviennent le premier de la Basse-Bretagne, le second de la Belgique. Le quatrième (PI. XVII,
A, B.) a été rencontré dans les environs de Gênes, par M. Delange, marchand de curiosités à
Paris, et appartient aujourd'hui au cabinet de M. Desmottes. Enfin le dernier (PI. XVII,
G, D, E.) est tiré d'une collection qui jouit depuis longtemps d'une célébrité européenne,
celle de M. Sauvageot. Nous devons à l'amitié de ces archéologues l'avantage de grouper des
monuments inédits destinés au même usage, remarquables par la même étrangeté, reconnais-
sables à un même air de famille, et que l'on dirait, sinon exécutés parla même école, du moins
inspirés par les mêmes idées. Si le premier accuse un art plus avancé ou une main plus ha-
bile, tous gardent l'empreinte d'un talent plein de verve et non dépourvu de grâce. On s'a-
perçoit au premier aspect que de véritables artistes ont passé par là.
Mais ces artistes à quel siècle appartenaient-ils ? Quel sens attachaient-ils à ces bizarres
scènes qui ont entre elles des rapports trop suivis pour n'être que de simples caprices d'imagi-
nation? Et le sujet représenté qu'a-t-il de commun avec la destination du meuble? Questions
difficiles sur lesquelles je n'ose me flatter d'apporter une complète lumière, bien que mes
conjectures me paraissent fondées.
- Qu'il nous soit permis de témoigner ici à M. Carrand une
reconnaissance que iui doivent avec nous ies personnes qui
partagent nos goûts et suivent nos études. Lorsque, au com-
mencement de ce siècle, i'art grec, remis en honneur à !a tin
du dernier, se voyait scui en possession de i'estime des sa-
vants et de ia vogue du monde, en même temps qa'Aiexandre
Lcnoir formait son musée des Petits-Augustins et que Wii-
iemin publiait ses Monuments Français, M. Carrand consacrait
déjà son temps et sa fortune à ia recherche des débris ies
pius curieux et ies moins compris des hautes époques de notre
histoire. Doué de cet instinct supérieur qui fait pressentir
ies prochaines tendances des esprits, il sut arrêter ses choix
de préférence sur ies produits de i'art ogivai et de i'art roman;
et c'est ainsi qu'ii s'est formé une collection d'autant pius
précieuse qu'eiie est composée de monuments pius rares,
expression d'un art pius sérieux. On en pourra jusqu'à un
certain point juger dans ce recueii, où nous nous proposons
de publier plusieurs de ces objets, en particulier : une colombe-
tabernacie de toute beauté; des crosses en ivoire du pius
grand styie et surtout le céièbre iiabciium de l'abbaye de
Tournus, dont ies dessins de Mabiilon et de Juénin ne peuvent
donner une juste idée.
MÉLANGES D'ARCHÉOLOGIE.
I.
PROVENANCE ET CARACTÈRE DES CtNQ MONUMENTS
Nous devons la communication du premier chandelier (PI. XIV et XV, B.) à M. Carrand
qui l'a trouvé dans le midi de la France. On y reconnaîtra, à défaut de la science anatomique
et du fini des détails, un bonheur d'invention que l'art d'Herculanum n'a pas toujours sur-
passé. Ici la facilité du mouvement ne s'approche-t-elle pas de la grâce ? L'attitude du dragon
mordant sa proie manque-t-elle de naturel et de puissance ? Et tandis que, saisis par un drame
pathétique, vous voyez la victime souffrir avec une virile fermeté, ne remarquez-vous pas un
heureux contraste dans ces rinceaux fleuris qui ombragent la scène et dans la joyeuse fleur qui
épanouit vers la lumière sa large et riche corolle?
Les deux chandeliers suivants (PL XV, A. G. et XVI.) font partie du cabinet de M. Dugué, et
proviennent le premier de la Basse-Bretagne, le second de la Belgique. Le quatrième (PI. XVII,
A, B.) a été rencontré dans les environs de Gênes, par M. Delange, marchand de curiosités à
Paris, et appartient aujourd'hui au cabinet de M. Desmottes. Enfin le dernier (PI. XVII,
G, D, E.) est tiré d'une collection qui jouit depuis longtemps d'une célébrité européenne,
celle de M. Sauvageot. Nous devons à l'amitié de ces archéologues l'avantage de grouper des
monuments inédits destinés au même usage, remarquables par la même étrangeté, reconnais-
sables à un même air de famille, et que l'on dirait, sinon exécutés parla même école, du moins
inspirés par les mêmes idées. Si le premier accuse un art plus avancé ou une main plus ha-
bile, tous gardent l'empreinte d'un talent plein de verve et non dépourvu de grâce. On s'a-
perçoit au premier aspect que de véritables artistes ont passé par là.
Mais ces artistes à quel siècle appartenaient-ils ? Quel sens attachaient-ils à ces bizarres
scènes qui ont entre elles des rapports trop suivis pour n'être que de simples caprices d'imagi-
nation? Et le sujet représenté qu'a-t-il de commun avec la destination du meuble? Questions
difficiles sur lesquelles je n'ose me flatter d'apporter une complète lumière, bien que mes
conjectures me paraissent fondées.
- Qu'il nous soit permis de témoigner ici à M. Carrand une
reconnaissance que iui doivent avec nous ies personnes qui
partagent nos goûts et suivent nos études. Lorsque, au com-
mencement de ce siècle, i'art grec, remis en honneur à !a tin
du dernier, se voyait scui en possession de i'estime des sa-
vants et de ia vogue du monde, en même temps qa'Aiexandre
Lcnoir formait son musée des Petits-Augustins et que Wii-
iemin publiait ses Monuments Français, M. Carrand consacrait
déjà son temps et sa fortune à ia recherche des débris ies
pius curieux et ies moins compris des hautes époques de notre
histoire. Doué de cet instinct supérieur qui fait pressentir
ies prochaines tendances des esprits, il sut arrêter ses choix
de préférence sur ies produits de i'art ogivai et de i'art roman;
et c'est ainsi qu'ii s'est formé une collection d'autant pius
précieuse qu'eiie est composée de monuments pius rares,
expression d'un art pius sérieux. On en pourra jusqu'à un
certain point juger dans ce recueii, où nous nous proposons
de publier plusieurs de ces objets, en particulier : une colombe-
tabernacie de toute beauté; des crosses en ivoire du pius
grand styie et surtout le céièbre iiabciium de l'abbaye de
Tournus, dont ies dessins de Mabiilon et de Juénin ne peuvent
donner une juste idée.