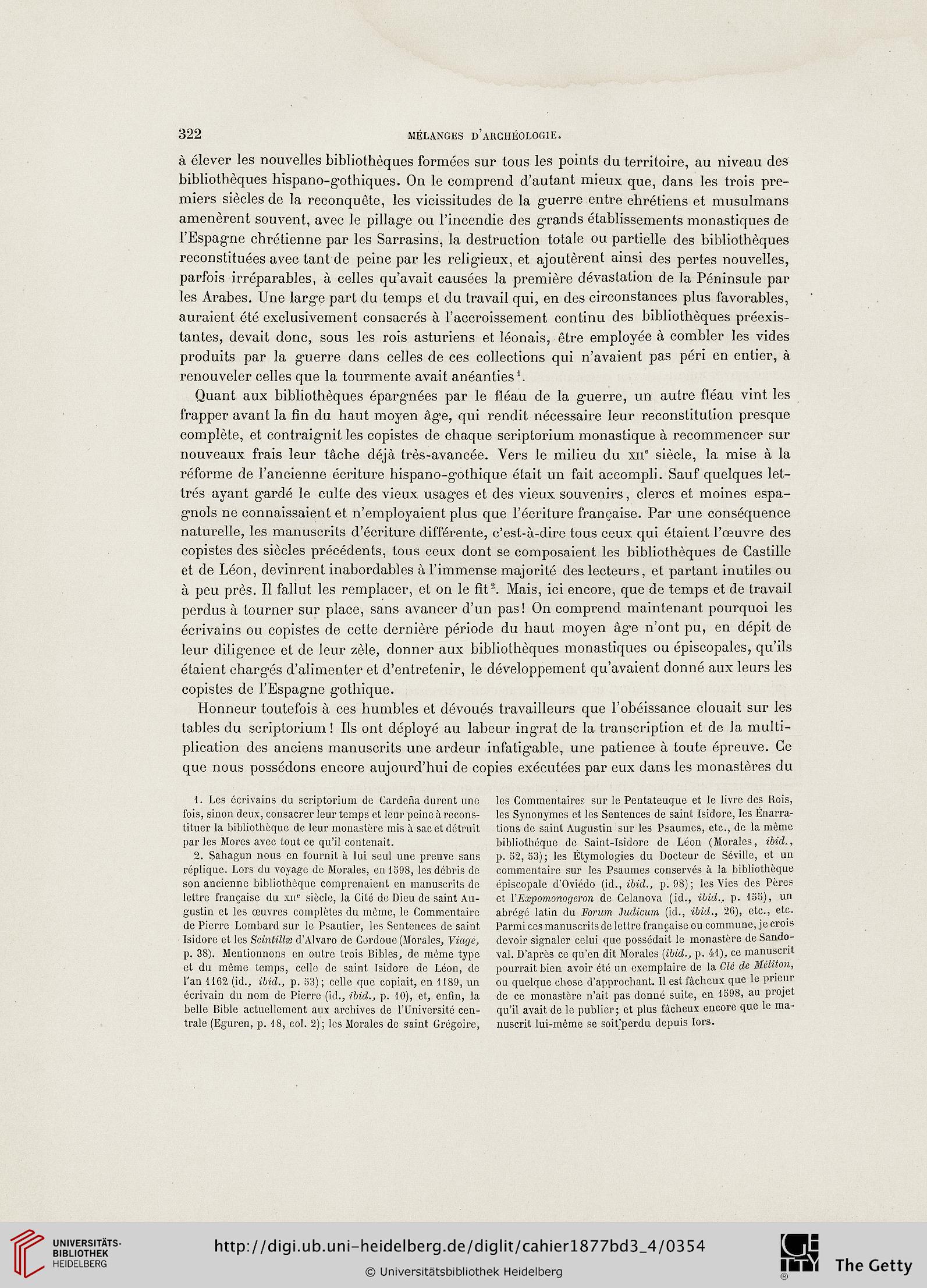322
MÉLANGES D'ARCHÉOLOGIE.
à élever les nouvelles bibliothèques formées sur tous les points du territoire, au niveau des
bibliothèques hispano-g'othiques. On le comprend d'autant mieux que, dans les trois pre-
miers siècles de la reconquête, les vicissitudes de la guerre entre chrétiens et musulmans
amenèrent souvent, avec le piüage ou l'incendie des grands établissements monastiques de
t'Espagne chrétienne par les Sarrasins, la destruction totale ou partielle des bibliothèques
reconstituées avec tant de peine par les religieux, et ajoutèrent ainsi des pertes nouvelles,
parfois irréparables, à celles qu'avait causées la première dévastation de la Péninsule par
les Arabes. Une largue part du temps et du travail qui, en des circonstances plus favorables,
auraient été exclusivement consacrés à l'accroissement continu des bibliothèques préexis-
tantes, devait donc, sous les rois asturiens et léonais, être employée à combler les vides
produits par la grnerre dans celles de ces collections qui n'avaient pas péri en entier, à
renouveler celles que la tourmente avait anéanties*.
Quant aux bibliothèques épargnées par le fléau de la grnerre, un autre fléau vint les
frapper avant la fin du haut moyen âge, qui rendit nécessaire leur reconstitution presque
complète, et contraignit les copistes de chaque scriptorium monastique à recommencer sur
nouveaux frais leur tâche déjà très-avancée. Vers le milieu du xn° siècle, la mise à la
réforme de l'ancienne écriture hispano-gothique était un fait accompli. Sauf quelques let-
trés ayant gardé le culte des vieux usages et des vieux souvenirs, clercs et moines espa-
gnols ne connaissaient et n'employaient plus que l'écriture française. Par une conséquence
naturelle, les manuscrits d'écriture différente, c'est-à-dire tous ceux qui étaient l'œuvre des
copistes des siècles précédents, tous ceux dont se composaient les bibliothèques de Castille
et de Léon, devinrent inabordables à l'immense majorité des lecteurs, et partant inutiles ou
à peu près. Il fallut les remplacer, et on le fltL Mais, ici encore, que de temps et de travail
perdus à tourner sur place, sans avancer d'un pas! On comprend maintenant pourquoi les
écrivains ou copistes de cette dernière période du haut moyen âge n'ont pu, en dépit de
leur diligence et de leur zèle, donner aux bibliothèques monastiques ou épiscopales, qu ils
étaient chargés d'alimenter et d'entretenir, le développement qu'avaient donné aux leurs les
copistes de l'Espagne gothique.
Honneur toutefois à ces humbles et dévoués travailleurs que l'obéissance clouait sur les
tables du scriptorium ! Ils ont déployé au labeur ingrat de la transcription et de la multi-
plication des anciens manuscrits une ardeur infatigable, une patience à toute épreuve. Ce
que nous possédons encore aujourd'hui de copies exécutées par eux dans les monastères du
1. Les écrivains du scriptorium de Cardena durent une
fois, sinon deux, consacrer leur temps et ieur peine à recons-
tituer la bibliothèque de leur monastère mis à sac et détruit
par les Mores avec tout ce qu'il contenait.
2. Sahagun nous en fournit à lui seul une preuve sans
réplique. Lors du voyage de Morales, en 1598, les débris do
son ancienne bibliothèque comprenaient en manuscrits do
lettre française du xm siècle, la Cité de Dieu do saint Au-
gustin et les œuvres complètes du même, le Commentaire
de Pierre Lombard sur le Psautier, les Sentences de saint
ïsidore et les ScintfMæ d'Alvaro de Cordoue (Morales, yfage,
p. 38). Mentionnons en outre trois Bibles, de même type
et du même temps, celle de saint ïsidore de Léon, de
l'an 1162 (ld., fMd., p. 53); celle que copiait, en 1189, un
écrivain du nom de Pierre (id., ?'Md., p. 10), et, enfin, la
belle Bible actuellement aux archives de l'Université cen-
trale (Eguren, p. 18, col. 2); les Morales de saint Grégoire,
les Commentaires sur le Pentateuque et le livre des Bois,
les Synonymes et les Sentences de saint Isidore, les Énarra-
tions de saint Augustin sur les Psaumes, etc., de la même
bibliothèque de Saint-Isidore de Léon (Morales, fMd.,
p. 32, 53); les Étymologies du Docteur de Séville, et un
commentaire sur les Psaumes conservés à la bibliothèque
épiscopale d'Oviédo (id., fMd., p. 98); les Vies des Pères
et l'Ææpomonog'eroT: de Celanova (id., fMd.. p. 155), un
abrégé latin du Forum Judieum (id., fMd., 26), etc., etc.
Parmi ces manuscrits de lettre française ou commune, je crois
devoir signaler celui que possédait le monastère de Sando-
val. D'après ce qu'en dit Morales (iMd., p. 41), ce manuscrit
pourrait bien avoir été un exemplaire de la Clé de MéKIon,
ou quoique chose d'approchant. Il est fâcheux que le prieur
de ce monastère n'ait pas donné suite, en 1598, au projet
qu'il avait de le publier; et plus fâcheux encore que le ma-
nuscrit lui-même se soit'perdu depuis lors.
MÉLANGES D'ARCHÉOLOGIE.
à élever les nouvelles bibliothèques formées sur tous les points du territoire, au niveau des
bibliothèques hispano-g'othiques. On le comprend d'autant mieux que, dans les trois pre-
miers siècles de la reconquête, les vicissitudes de la guerre entre chrétiens et musulmans
amenèrent souvent, avec le piüage ou l'incendie des grands établissements monastiques de
t'Espagne chrétienne par les Sarrasins, la destruction totale ou partielle des bibliothèques
reconstituées avec tant de peine par les religieux, et ajoutèrent ainsi des pertes nouvelles,
parfois irréparables, à celles qu'avait causées la première dévastation de la Péninsule par
les Arabes. Une largue part du temps et du travail qui, en des circonstances plus favorables,
auraient été exclusivement consacrés à l'accroissement continu des bibliothèques préexis-
tantes, devait donc, sous les rois asturiens et léonais, être employée à combler les vides
produits par la grnerre dans celles de ces collections qui n'avaient pas péri en entier, à
renouveler celles que la tourmente avait anéanties*.
Quant aux bibliothèques épargnées par le fléau de la grnerre, un autre fléau vint les
frapper avant la fin du haut moyen âge, qui rendit nécessaire leur reconstitution presque
complète, et contraignit les copistes de chaque scriptorium monastique à recommencer sur
nouveaux frais leur tâche déjà très-avancée. Vers le milieu du xn° siècle, la mise à la
réforme de l'ancienne écriture hispano-gothique était un fait accompli. Sauf quelques let-
trés ayant gardé le culte des vieux usages et des vieux souvenirs, clercs et moines espa-
gnols ne connaissaient et n'employaient plus que l'écriture française. Par une conséquence
naturelle, les manuscrits d'écriture différente, c'est-à-dire tous ceux qui étaient l'œuvre des
copistes des siècles précédents, tous ceux dont se composaient les bibliothèques de Castille
et de Léon, devinrent inabordables à l'immense majorité des lecteurs, et partant inutiles ou
à peu près. Il fallut les remplacer, et on le fltL Mais, ici encore, que de temps et de travail
perdus à tourner sur place, sans avancer d'un pas! On comprend maintenant pourquoi les
écrivains ou copistes de cette dernière période du haut moyen âge n'ont pu, en dépit de
leur diligence et de leur zèle, donner aux bibliothèques monastiques ou épiscopales, qu ils
étaient chargés d'alimenter et d'entretenir, le développement qu'avaient donné aux leurs les
copistes de l'Espagne gothique.
Honneur toutefois à ces humbles et dévoués travailleurs que l'obéissance clouait sur les
tables du scriptorium ! Ils ont déployé au labeur ingrat de la transcription et de la multi-
plication des anciens manuscrits une ardeur infatigable, une patience à toute épreuve. Ce
que nous possédons encore aujourd'hui de copies exécutées par eux dans les monastères du
1. Les écrivains du scriptorium de Cardena durent une
fois, sinon deux, consacrer leur temps et ieur peine à recons-
tituer la bibliothèque de leur monastère mis à sac et détruit
par les Mores avec tout ce qu'il contenait.
2. Sahagun nous en fournit à lui seul une preuve sans
réplique. Lors du voyage de Morales, en 1598, les débris do
son ancienne bibliothèque comprenaient en manuscrits do
lettre française du xm siècle, la Cité de Dieu do saint Au-
gustin et les œuvres complètes du même, le Commentaire
de Pierre Lombard sur le Psautier, les Sentences de saint
ïsidore et les ScintfMæ d'Alvaro de Cordoue (Morales, yfage,
p. 38). Mentionnons en outre trois Bibles, de même type
et du même temps, celle de saint ïsidore de Léon, de
l'an 1162 (ld., fMd., p. 53); celle que copiait, en 1189, un
écrivain du nom de Pierre (id., ?'Md., p. 10), et, enfin, la
belle Bible actuellement aux archives de l'Université cen-
trale (Eguren, p. 18, col. 2); les Morales de saint Grégoire,
les Commentaires sur le Pentateuque et le livre des Bois,
les Synonymes et les Sentences de saint Isidore, les Énarra-
tions de saint Augustin sur les Psaumes, etc., de la même
bibliothèque de Saint-Isidore de Léon (Morales, fMd.,
p. 32, 53); les Étymologies du Docteur de Séville, et un
commentaire sur les Psaumes conservés à la bibliothèque
épiscopale d'Oviédo (id., fMd., p. 98); les Vies des Pères
et l'Ææpomonog'eroT: de Celanova (id., fMd.. p. 155), un
abrégé latin du Forum Judieum (id., fMd., 26), etc., etc.
Parmi ces manuscrits de lettre française ou commune, je crois
devoir signaler celui que possédait le monastère de Sando-
val. D'après ce qu'en dit Morales (iMd., p. 41), ce manuscrit
pourrait bien avoir été un exemplaire de la Clé de MéKIon,
ou quoique chose d'approchant. Il est fâcheux que le prieur
de ce monastère n'ait pas donné suite, en 1598, au projet
qu'il avait de le publier; et plus fâcheux encore que le ma-
nuscrit lui-même se soit'perdu depuis lors.