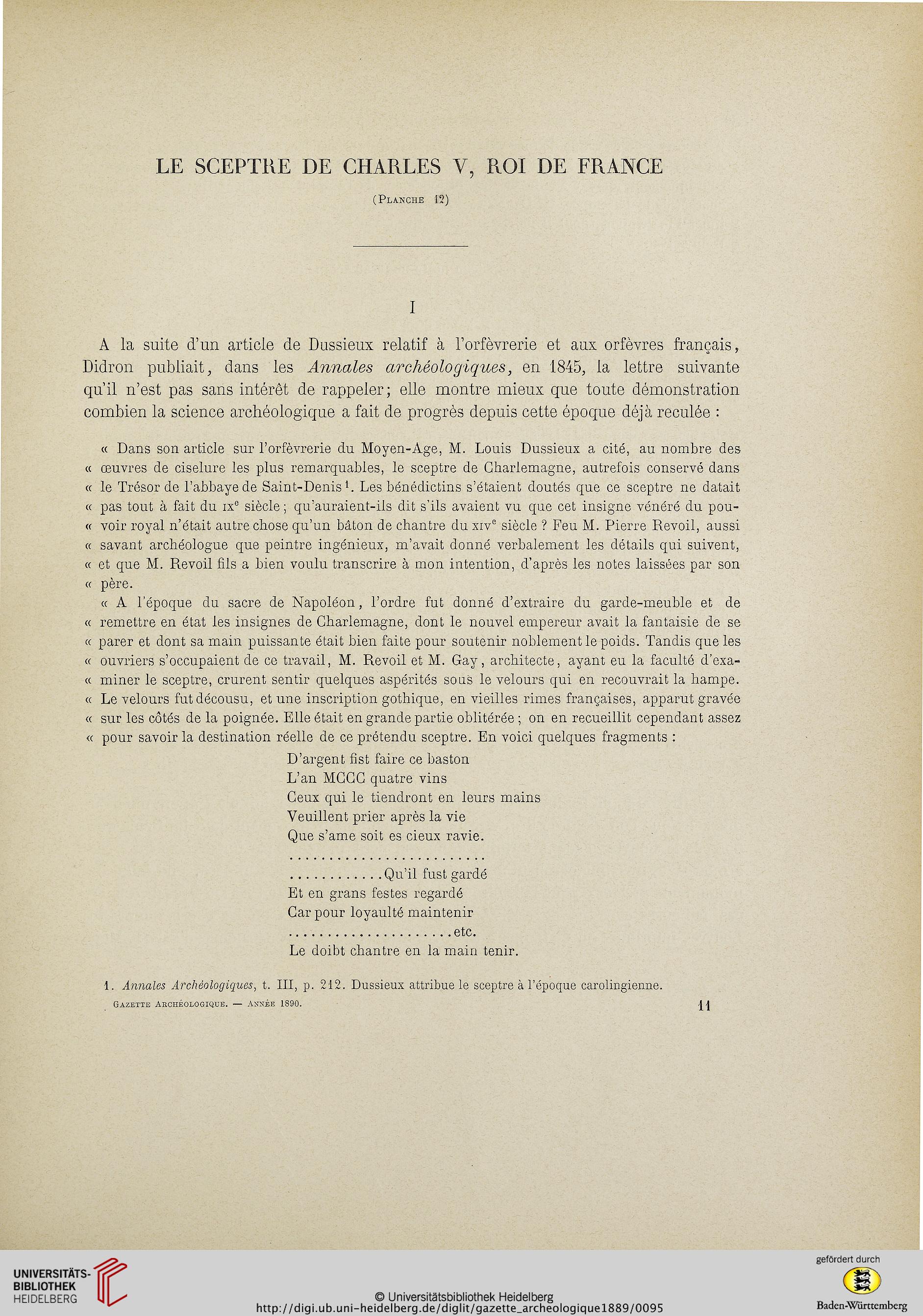LE SCEPTRE DE CHARLES V, ROI DE FRANCE
(Planche 12)
I
A la suite d’un article de Dussieux relatif à l’orfèvrerie et aux orfèvres français,
Didron publiait, dans les Annales archéologiques, en 1845, la lettre suivante
qu’il n’est pas sans intérêt de rappeler; elle montre mieux que toute démonstration
combien la science archéologique a fait de progrès depuis cette époque déjà reculée :
« Dans son article sur l’orfèvrerie du Moyen-Age, M. Louis Dussieux a cité, au nombre des
« œuvres de ciselure les plus remarquables, le sceptre de Charlemagne, autrefois conservé dans
« le Trésor de l’abbaye de Saint-Denis1. Les bénédictins s’étaient doutés que ce sceptre ne datait
« pas tout à fait du ixe siècle ; qu’auraient-ils dit s’ils avaient vu que cet insigne vénéré du pou-
« voir royal n’était autre chose qu’un bâton de chantre du xive siècle ? Feu M. Pierre Revoil, aussi
« savant archéologue que peintre ingénieux, m’avait donné verbalement les détails qui suivent,
« et que M. Revoil fils a bien voulu transcrire à mon intention, d’après les notes laissées par son
« père.
« A l’époque du sacre de Napoléon, l’ordre fut donné d’extraire du garde-meuble et de
« remettre en état les insignes de Charlemagne, dont le nouvel empereur avait la fantaisie de se
« parer et dont sa main puissante était bien faite pour soutenir noblement le poids. Tandis que les
« ouvriers s’occupaient de ce travail, M. Revoil et M. Gay, architecte, ayant eu la faculté d’exa-
« miner le sceptre, crurent sentir quelques aspérités sons le velours qui en recouvrait la hampe.
« Le velours fut décousu, et une inscription gothique, en vieilles rimes françaises, apparut gravée
« sur les côtés de la poignée. Elle était en grande partie oblitérée ; on en recueillit cependant assez
« pour savoir la destination réelle de ce prétendu sceptre. En voici quelques fragments :
D’argent fist faire ce baston
L’an MCGC quatre vins
Ceux qui le tiendront en leurs mains
Veuillent prier après la vie
Que s’ame soit es cieux ravie.
.Qu’il fust gardé
Et en grans festes regardé
Car pour loyaulté maintenir
.etc.
Le doibt chantre en la main tenir.
1. Annales Archéologiques, t. III, p. 212. Dussieux attribue le sceptre à l’époque carolingienne.
Gazette Archéologique. — Année 1S90.
(Planche 12)
I
A la suite d’un article de Dussieux relatif à l’orfèvrerie et aux orfèvres français,
Didron publiait, dans les Annales archéologiques, en 1845, la lettre suivante
qu’il n’est pas sans intérêt de rappeler; elle montre mieux que toute démonstration
combien la science archéologique a fait de progrès depuis cette époque déjà reculée :
« Dans son article sur l’orfèvrerie du Moyen-Age, M. Louis Dussieux a cité, au nombre des
« œuvres de ciselure les plus remarquables, le sceptre de Charlemagne, autrefois conservé dans
« le Trésor de l’abbaye de Saint-Denis1. Les bénédictins s’étaient doutés que ce sceptre ne datait
« pas tout à fait du ixe siècle ; qu’auraient-ils dit s’ils avaient vu que cet insigne vénéré du pou-
« voir royal n’était autre chose qu’un bâton de chantre du xive siècle ? Feu M. Pierre Revoil, aussi
« savant archéologue que peintre ingénieux, m’avait donné verbalement les détails qui suivent,
« et que M. Revoil fils a bien voulu transcrire à mon intention, d’après les notes laissées par son
« père.
« A l’époque du sacre de Napoléon, l’ordre fut donné d’extraire du garde-meuble et de
« remettre en état les insignes de Charlemagne, dont le nouvel empereur avait la fantaisie de se
« parer et dont sa main puissante était bien faite pour soutenir noblement le poids. Tandis que les
« ouvriers s’occupaient de ce travail, M. Revoil et M. Gay, architecte, ayant eu la faculté d’exa-
« miner le sceptre, crurent sentir quelques aspérités sons le velours qui en recouvrait la hampe.
« Le velours fut décousu, et une inscription gothique, en vieilles rimes françaises, apparut gravée
« sur les côtés de la poignée. Elle était en grande partie oblitérée ; on en recueillit cependant assez
« pour savoir la destination réelle de ce prétendu sceptre. En voici quelques fragments :
D’argent fist faire ce baston
L’an MCGC quatre vins
Ceux qui le tiendront en leurs mains
Veuillent prier après la vie
Que s’ame soit es cieux ravie.
.Qu’il fust gardé
Et en grans festes regardé
Car pour loyaulté maintenir
.etc.
Le doibt chantre en la main tenir.
1. Annales Archéologiques, t. III, p. 212. Dussieux attribue le sceptre à l’époque carolingienne.
Gazette Archéologique. — Année 1S90.