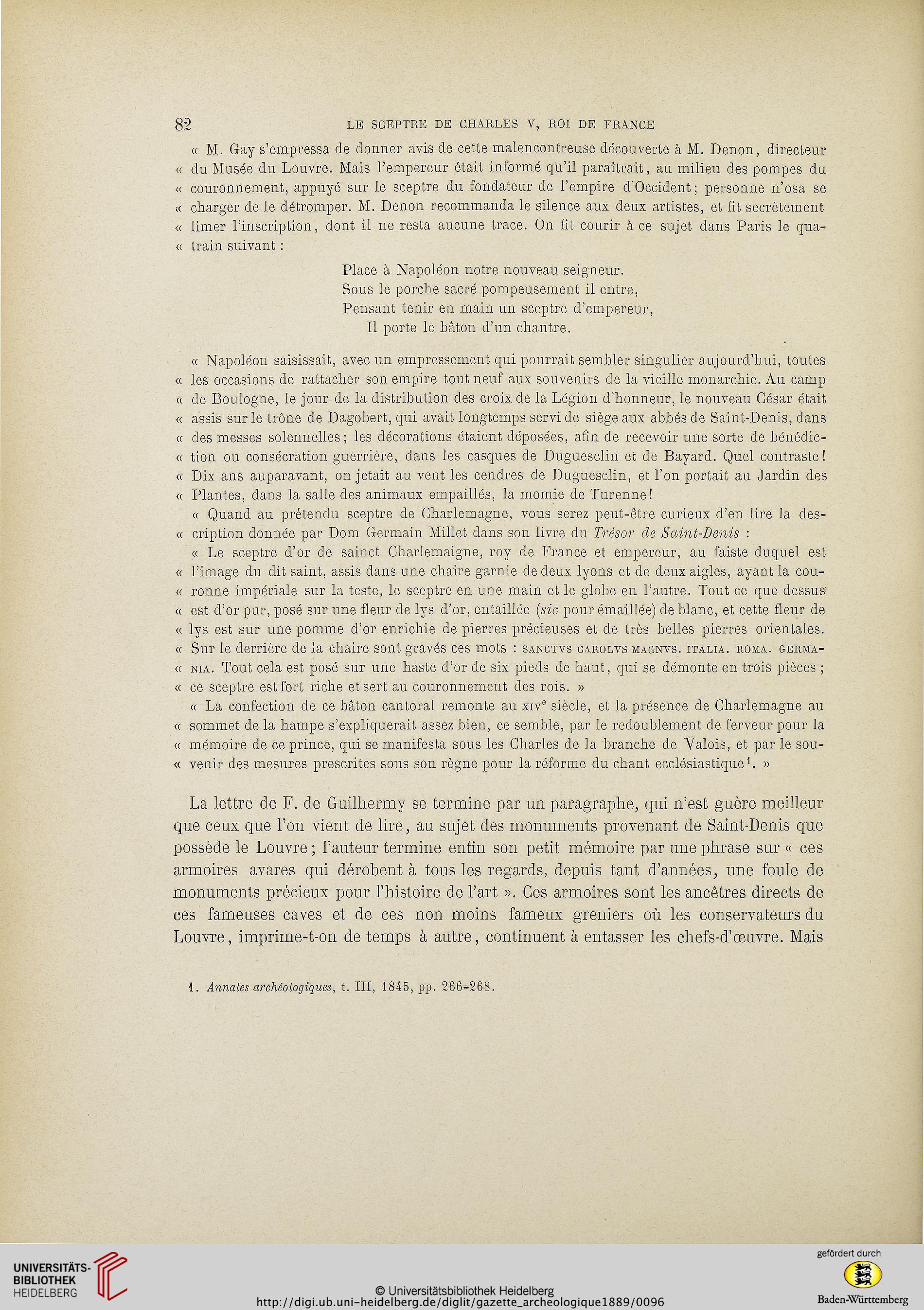82 LE SCEPTRE DE CHARLES V, ROI DE FRANCE
« M. Gay s’empressa de donner avis de cette malencontreuse découverte à M. Denon, directeur
« du Musée du Louvre. Mais l’empereur était informé qu’il paraîtrait, au milieu des pompes du
« couronnement, appuyé sur le sceptre du fondateur de l’empire d’Occident; personne n’osa se
ce charger de le détromper. M. Denon recommanda le silence aux deux artistes, et fît secrètement
<c limer l’inscription, dont il ne resta aucune trace. On fit courir à ce sujet dans Paris le qua-
« train suivant :
Place à Napoléon notre nouveau seigneur.
Sous le porche sacré pompeusement il entre,
Pensant tenir en main un sceptre d’empereur,
Il porte le hâton d’un chantre.
« Napoléon saisissait, avec un empressement qui pourrait sembler singulier aujourd’hui, toutes
« les occasions de rattacher son empire tout neuf aux souvenirs de la vieille monarchie. Au camp
« de Boulogne, le jour de la distribution des croix de la Légion d’honneur, le nouveau César était
« assis sur le trône de Dagobert, qui avait longtemps servi de siège aux abbés de Saint-Denis, dans
« des messes solennelles; les décorations étaient déposées, afin de recevoir une sorte de bénédic-
« tion ou consécration guerrière, dans les casques de Duguesclin et de Bayard. Quel contraste !
« Dix ans auparavant, on jetait au vent les cendres de Duguesclin, et l’on portait au Jardin des
« Plantes, dans la salle des animaux empaillés, la momie de Turenne!
« Quand au prétendu sceptre de Charlemagne, vous serez peut-être curieux d’en lire la des-
<c cription donnée par Dom Germain Millet dans son livre du Trésor de Saint-Denis :
« Le sceptre d’or de sainct Charlemaigne, roy de France et empereur, au faiste duquel est
« l’image du dit saint, assis dans une chaire garnie de deux lyons et de deux aigles, ayant la cou-
« ronne impériale sur la teste, le sceptre en une main et le globe en l’autre. Tout ce que dessus
« est d’or pur, posé sur une fleur de lys d’or, entaillée (sic pour émaillée) de blanc, et cette fleur de
« lys est sur une pomme d’or enrichie de pierres précieuses et de très belles pierres orientales.
« Sur le derrière de la chaire sont gravés ces mots : sanctvs carolvs magnvs. italia. roma. germa-
« nia. Tout cela est posé sur une haste d’or de six pieds de haut, qui se démonte en trois pièces ;
« ce sceptre est fort riche et sert au couronnement des rois. »
« La confection de ce bâton cantoral remonte au xive siècle, et la présence de Charlemagne au
« sommet de la hampe s’expliquerait assez bien, ce semble, par le redoublement de ferveur pour la
« mémoire de ce prince, qui se manifesta sous les Charles de la branche de Valois, et par le sou-
« venir des mesures prescrites sous son règne pour la réforme du chant ecclésiastique1. »
La lettre de F. de Guilliermv se termine par un paragraphe, qui n’est guère meilleur
que ceux que l’on vient de lire, au sujet des monuments provenant de Saint-Denis que
possède le Louvre ; l’auteur termine enfin son petit mémoire par une phrase sur « ces
armoires avares qui dérobent à tous les regards, depuis tant d’années, une foule de
monuments précieux pour l’histoire de l’art ». Ces armoires sont les ancêtres directs de
ces fameuses caves et de ces non moins fameux greniers où les conservateurs du
Louvre, imprime-t-on de temps à autre, continuent à entasser les chefs-d’œuvre. Mais
1. Annales archéologiques, t. III, 1845, pp. 266-268.
« M. Gay s’empressa de donner avis de cette malencontreuse découverte à M. Denon, directeur
« du Musée du Louvre. Mais l’empereur était informé qu’il paraîtrait, au milieu des pompes du
« couronnement, appuyé sur le sceptre du fondateur de l’empire d’Occident; personne n’osa se
ce charger de le détromper. M. Denon recommanda le silence aux deux artistes, et fît secrètement
<c limer l’inscription, dont il ne resta aucune trace. On fit courir à ce sujet dans Paris le qua-
« train suivant :
Place à Napoléon notre nouveau seigneur.
Sous le porche sacré pompeusement il entre,
Pensant tenir en main un sceptre d’empereur,
Il porte le hâton d’un chantre.
« Napoléon saisissait, avec un empressement qui pourrait sembler singulier aujourd’hui, toutes
« les occasions de rattacher son empire tout neuf aux souvenirs de la vieille monarchie. Au camp
« de Boulogne, le jour de la distribution des croix de la Légion d’honneur, le nouveau César était
« assis sur le trône de Dagobert, qui avait longtemps servi de siège aux abbés de Saint-Denis, dans
« des messes solennelles; les décorations étaient déposées, afin de recevoir une sorte de bénédic-
« tion ou consécration guerrière, dans les casques de Duguesclin et de Bayard. Quel contraste !
« Dix ans auparavant, on jetait au vent les cendres de Duguesclin, et l’on portait au Jardin des
« Plantes, dans la salle des animaux empaillés, la momie de Turenne!
« Quand au prétendu sceptre de Charlemagne, vous serez peut-être curieux d’en lire la des-
<c cription donnée par Dom Germain Millet dans son livre du Trésor de Saint-Denis :
« Le sceptre d’or de sainct Charlemaigne, roy de France et empereur, au faiste duquel est
« l’image du dit saint, assis dans une chaire garnie de deux lyons et de deux aigles, ayant la cou-
« ronne impériale sur la teste, le sceptre en une main et le globe en l’autre. Tout ce que dessus
« est d’or pur, posé sur une fleur de lys d’or, entaillée (sic pour émaillée) de blanc, et cette fleur de
« lys est sur une pomme d’or enrichie de pierres précieuses et de très belles pierres orientales.
« Sur le derrière de la chaire sont gravés ces mots : sanctvs carolvs magnvs. italia. roma. germa-
« nia. Tout cela est posé sur une haste d’or de six pieds de haut, qui se démonte en trois pièces ;
« ce sceptre est fort riche et sert au couronnement des rois. »
« La confection de ce bâton cantoral remonte au xive siècle, et la présence de Charlemagne au
« sommet de la hampe s’expliquerait assez bien, ce semble, par le redoublement de ferveur pour la
« mémoire de ce prince, qui se manifesta sous les Charles de la branche de Valois, et par le sou-
« venir des mesures prescrites sous son règne pour la réforme du chant ecclésiastique1. »
La lettre de F. de Guilliermv se termine par un paragraphe, qui n’est guère meilleur
que ceux que l’on vient de lire, au sujet des monuments provenant de Saint-Denis que
possède le Louvre ; l’auteur termine enfin son petit mémoire par une phrase sur « ces
armoires avares qui dérobent à tous les regards, depuis tant d’années, une foule de
monuments précieux pour l’histoire de l’art ». Ces armoires sont les ancêtres directs de
ces fameuses caves et de ces non moins fameux greniers où les conservateurs du
Louvre, imprime-t-on de temps à autre, continuent à entasser les chefs-d’œuvre. Mais
1. Annales archéologiques, t. III, 1845, pp. 266-268.