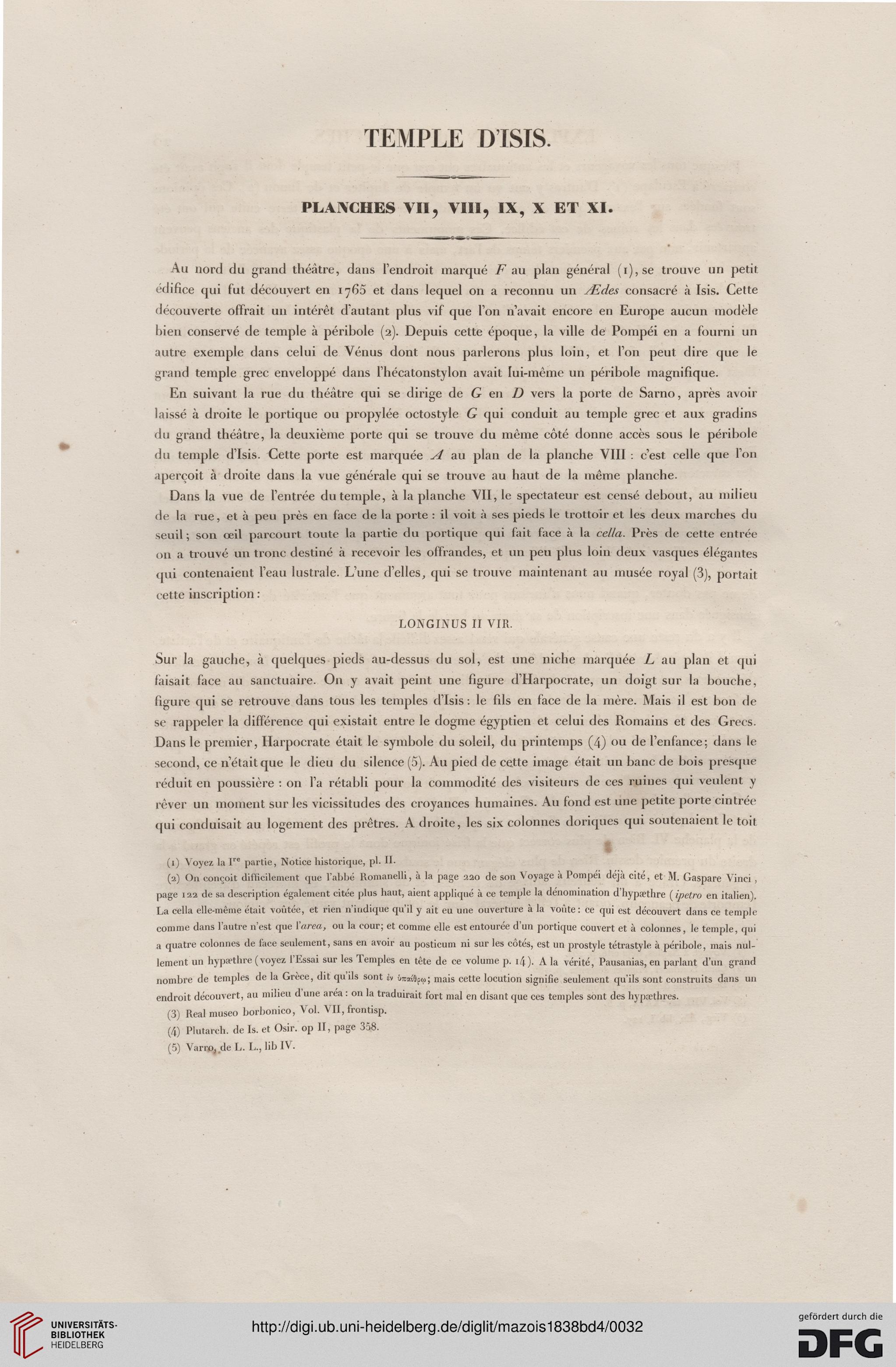TEMPLE D'ISIS.
PLANCHES VII, VIII, IX, X ET XI.
Au nord du grand théâtre, dans l'endroit marqué F au plan général (i),se trouve un petit
édifice qui fut découvert en 1765 et dans lequel on a reconnu un AS des consacré à Isis. Cette
découverte offrait un intérêt d'autant plus vif que Ton n'avait encore en Europe aucun modèle
bien conservé de temple à péribole (2). Depuis cette époque, la ville de Pompéi en a fourni un
autre exemple dans celui de Vénus dont nous parlerons plus loin, et l'on peut dire que le
grand temple grec enveloppé dans l'hécatonstylon avait lui-même un péribole magnifique.
En suivant la rue du théâtre qui se dirige de G en D vers la porte de Sarno, après avoir
laissé à droite le portique ou propylée octostyle G qui conduit au temple grec et aux gradins
du grand théâtre, la deuxième porte qui se trouve du même côté donne accès sous le péribole
du temple d'Isis. Cette porte est marquée A au plan de la planche VIII : c'est celle que l'on
aperçoit à droite dans la vue générale qui se trouve au haut de la même planche.
Dans la vue de l'entrée du temple, à la planche VII, le spectateur est censé debout, au milieu
de la rue, et à peu près en face de la porte : il voit à ses pieds le trottoir et les deux marches du
seuil ; son œil parcourt toute la partie du portique qui fait face à la cella. Près de cette entrée
on a trouvé un tronc destiné à recevoir les offrandes, et un peu plus loin deux vasques élégantes
qui contenaient l'eau lustrale. L'une d'elles, qui se trouve maintenant au musée royal (3), portait
cette inscription :
LONGINUS II VIR.
Sur la gauche, à quelques pieds au-dessus du sol, est une niche marquée L au plan et qui
faisait face au sanctuaire. On y avait peint une figure d'Harpocrate, un doigt sur la bouche,
figure qui se retrouve dans tous les temples d'Isis : le fils en face de la mère. Mais il est bon de
se rappeler la différence qui existait entre le dogme égyptien et celui des Romains et des Grecs.
Dans le premier, Harpocrate était le symbole du soleil, du printemps (4) ou de l'enfance: dans le
second, ce n'était que le dieu du silence (5). Au pied de cette image était un banc de bois presque
réduit en poussière : on l'a rétabli pour la commodité des visiteurs de ces ruines qui veulent y
rêver un moment sur les vicissitudes des croyances humaines. Au fond est une petite porte cintrée
qui conduisait au logement des prêtres. A droite, les six colonnes doriques qui soutenaient le toit
I
(1) Voyez la Ire partie, Notice historique, pi. II.
(a) On conçoit difficilement que l'abbé Romanelli, c\ la page 220 de son Voyage à Pompéi déjà cité, et M. Gaspare Vinci ,
page 122 de sa description également citée plus haut, aient appliqué à ce temple la dénomination d'hypaethre (ipetro en italien).
La cella elle-même était voûtée, et rien n'indique qu'il y ait eu une ouverture à la voûte: ce qui est découvert dans ce temple
comme dans l'autre n'est que ïarea, ou la cour; et comme elle est entourée d'un portique couvert et à colonnes, le temple, qui
a quatre colonnes de face seulement, sans en avoir au posticum ni sur les côtés, est un prostyle tétrastyle à péribole, mais nul-
lement un hypsethre (voyez l'Essai sur les Temples en tête de ce volume p. 14). A la vérité, Pausanias, en parlant d'un grand
nombre de temples de la Grèce, dit quils sont èv ûitatôpw; mais cette locution signifie seulement qu'ils sont construits dans un
endroit découvert, au milieu d'une aréa : on la traduirait fort mal en disant que ces temples sont des hypœthres.
(3) Realmuseo borbonico, Vol. VII, frontisp.
(4) Plutarch. de Is. et Osir. op II, page 358.
(5) Varro, de L. L., lib IV.
PLANCHES VII, VIII, IX, X ET XI.
Au nord du grand théâtre, dans l'endroit marqué F au plan général (i),se trouve un petit
édifice qui fut découvert en 1765 et dans lequel on a reconnu un AS des consacré à Isis. Cette
découverte offrait un intérêt d'autant plus vif que Ton n'avait encore en Europe aucun modèle
bien conservé de temple à péribole (2). Depuis cette époque, la ville de Pompéi en a fourni un
autre exemple dans celui de Vénus dont nous parlerons plus loin, et l'on peut dire que le
grand temple grec enveloppé dans l'hécatonstylon avait lui-même un péribole magnifique.
En suivant la rue du théâtre qui se dirige de G en D vers la porte de Sarno, après avoir
laissé à droite le portique ou propylée octostyle G qui conduit au temple grec et aux gradins
du grand théâtre, la deuxième porte qui se trouve du même côté donne accès sous le péribole
du temple d'Isis. Cette porte est marquée A au plan de la planche VIII : c'est celle que l'on
aperçoit à droite dans la vue générale qui se trouve au haut de la même planche.
Dans la vue de l'entrée du temple, à la planche VII, le spectateur est censé debout, au milieu
de la rue, et à peu près en face de la porte : il voit à ses pieds le trottoir et les deux marches du
seuil ; son œil parcourt toute la partie du portique qui fait face à la cella. Près de cette entrée
on a trouvé un tronc destiné à recevoir les offrandes, et un peu plus loin deux vasques élégantes
qui contenaient l'eau lustrale. L'une d'elles, qui se trouve maintenant au musée royal (3), portait
cette inscription :
LONGINUS II VIR.
Sur la gauche, à quelques pieds au-dessus du sol, est une niche marquée L au plan et qui
faisait face au sanctuaire. On y avait peint une figure d'Harpocrate, un doigt sur la bouche,
figure qui se retrouve dans tous les temples d'Isis : le fils en face de la mère. Mais il est bon de
se rappeler la différence qui existait entre le dogme égyptien et celui des Romains et des Grecs.
Dans le premier, Harpocrate était le symbole du soleil, du printemps (4) ou de l'enfance: dans le
second, ce n'était que le dieu du silence (5). Au pied de cette image était un banc de bois presque
réduit en poussière : on l'a rétabli pour la commodité des visiteurs de ces ruines qui veulent y
rêver un moment sur les vicissitudes des croyances humaines. Au fond est une petite porte cintrée
qui conduisait au logement des prêtres. A droite, les six colonnes doriques qui soutenaient le toit
I
(1) Voyez la Ire partie, Notice historique, pi. II.
(a) On conçoit difficilement que l'abbé Romanelli, c\ la page 220 de son Voyage à Pompéi déjà cité, et M. Gaspare Vinci ,
page 122 de sa description également citée plus haut, aient appliqué à ce temple la dénomination d'hypaethre (ipetro en italien).
La cella elle-même était voûtée, et rien n'indique qu'il y ait eu une ouverture à la voûte: ce qui est découvert dans ce temple
comme dans l'autre n'est que ïarea, ou la cour; et comme elle est entourée d'un portique couvert et à colonnes, le temple, qui
a quatre colonnes de face seulement, sans en avoir au posticum ni sur les côtés, est un prostyle tétrastyle à péribole, mais nul-
lement un hypsethre (voyez l'Essai sur les Temples en tête de ce volume p. 14). A la vérité, Pausanias, en parlant d'un grand
nombre de temples de la Grèce, dit quils sont èv ûitatôpw; mais cette locution signifie seulement qu'ils sont construits dans un
endroit découvert, au milieu d'une aréa : on la traduirait fort mal en disant que ces temples sont des hypœthres.
(3) Realmuseo borbonico, Vol. VII, frontisp.
(4) Plutarch. de Is. et Osir. op II, page 358.
(5) Varro, de L. L., lib IV.