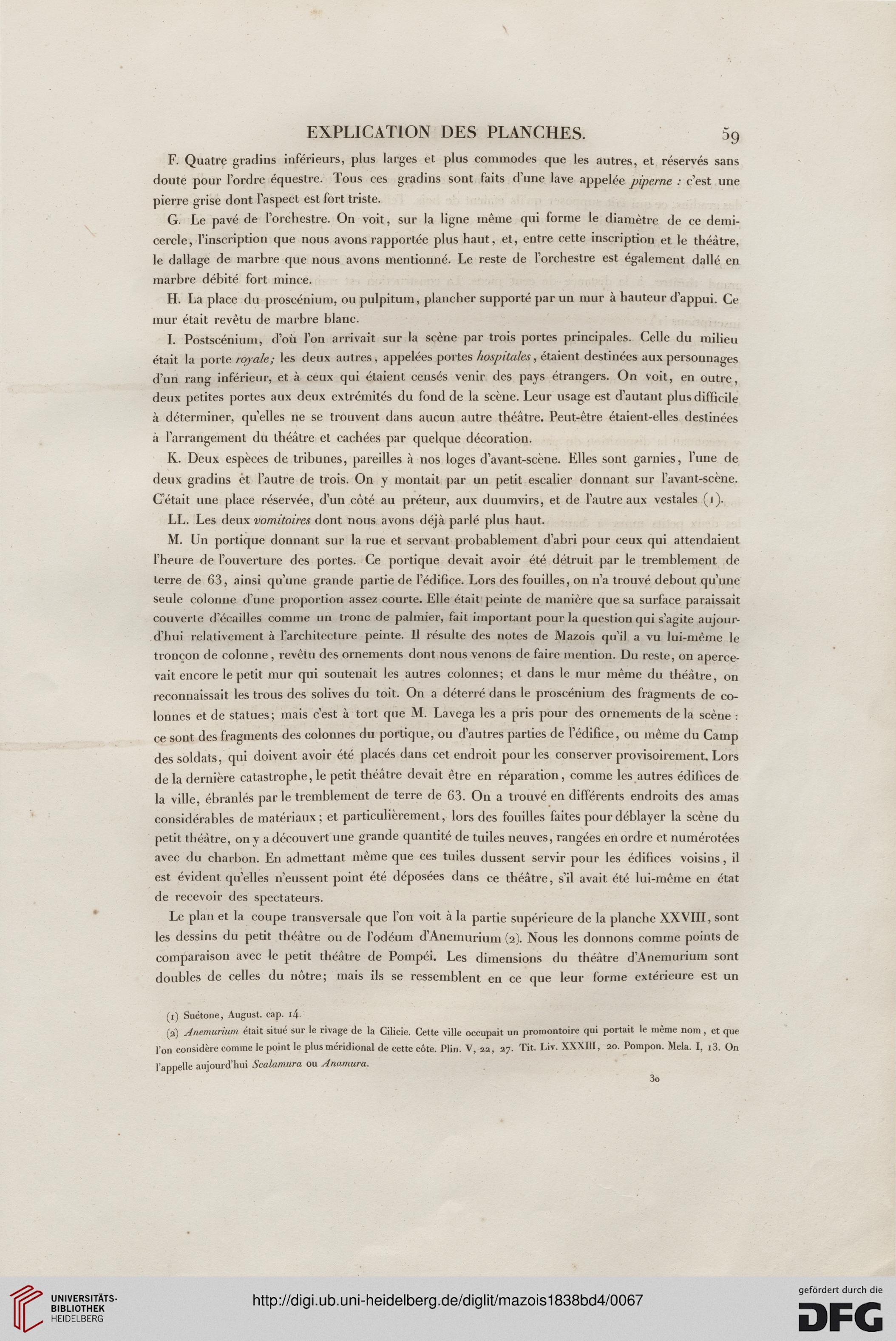EXPLICATION DES PLANCHES. 5g
F. Quatre gradins inférieurs, plus larges et plus commodes que les autres, et réservés sans
doute pour Tordre équestre. Tous ces gradins sont faits d'une lave appelée piperne : c'est une
pierre grise dont l'aspect est fort triste.
G. Le pavé de l'orchestre. On voit, sur la ligne même qui forme le diamètre de ce demi-
cercle, l'inscription que nous avons rapportée plus haut, et, entre cette inscription et le théâtre,
le dallage de marbre que nous avons mentionné. Le reste de l'orchestre est également dallé en
marbre débité fort mince.
H. La place du proscenium, ou pulpitum, plancher supporté par un mur à hauteur d'appui. Ce
mur était revêtu de marbre blanc.
I. Postscénium, d'où l'on arrivait sur la scène par trois portes principales. Celle du milieu
était la porte rojale; les deux autres, appelées portes hospitales, étaient destinées aux personnages
d'un rang inférieur, et à ceux qui étaient censés venir des pays étrangers. On voit, en outre,
deux petites portes aux deux extrémités du fond de la scène. Leur usage est d'autant plus difficile
à déterminer, qu'elles ne se trouvent dans aucun autre théâtre. Peut-être étaient-elles destinées
à l'arrangement du théâtre et cachées par quelque décoration.
K. Deux espèces de tribunes, pareilles à nos loges d'avant-scène. Elles sont garnies, l'une de
deux gradins et l'autre de trois. On y montait par un petit escalier donnant sur l'avant-scène.
C'était une place réservée, d'un côté au préteur, aux duumvirs, et de l'autre aux vestales (i).
LL. Les deux vomitoires dont nous avons déjà parlé plus haut.
M. Un portique donnant sur la rue et servant probablement d'abri pour ceux qui attendaient
l'heure de l'ouverture des portes. Ce portique devait avoir été détruit par le tremblement de
terre de 63, ainsi qu'une grande partie de l'édifice. Lors des fouilles, on n'a trouvé debout qu'une
seule colonne d'une proportion assez courte. Elle était peinte de manière que sa surface paraissait
couverte d'écaillés comme un tronc de palmier, fait important pour la question qui s'agite aujour-
d'hui relativement à l'architecture peinte. Il résulte des notes de Mazois qu'il a vu lui-même le
tronçon de colonne , revêtu des ornements dont nous venons de faire mention. Du reste, on aperce-
vait encore le petit mur qui soutenait les autres colonnes; et dans le mur même du théâtre, on
reconnaissait les trous des solives du toit. On a déterré dans le proscenium des fragments de co-
lonnes et de statues; mais c'est à tort que M. Lavega les a pris pour des ornements de la scène :
ce sont des fragments des colonnes du portique, ou d'autres parties de l'édifice, ou même du Camp
des soldats, qui doivent avoir été placés dans cet endroit pour les conserver provisoirement. Lors
de la dernière catastrophe, le petit théâtre devait être en réparation, comme les autres édifices de
la ville, ébranlés par le tremblement de terre de 63. On a trouvé en différents endroits des amas
considérables de matériaux; et particulièrement, lors des fouilles faites pour déblayer la scène du
petit théâtre, on y a découvert une grande quantité de tuiles neuves, rangées en ordre et numérotées
avec du charbon. En admettant même que ces tuiles dussent servir pour les édifices voisins, il
est évident qu'elles n'eussent point été déposées dans ce théâtre, s'il avait été lui-même en état
de recevoir des spectateurs.
Le plan et la coupe transversale que l'on voit à la partie supérieure de la planche XXVIII, sont
les dessins du petit théâtre ou de l'odéum d'Anemurium (2). Nous les donnons comme points de
comparaison avec le petit théâtre de Pompéi. Les dimensions du théâtre d'Anemurium sont
doubles de celles du nôtre; mais ils se ressemblent en ce que leur forme extérieure est un
(r) Suétone, August. cap. i4
(2) Jnemurium était situé sur le rivage de la Cilicie. Cette ville occupait un promontoire qui portait le même nom, et que
l'on considère comme le point le plus méridional de cette côte. Plin. V, 22, 27. Tit. Liv. XXXIII, 20. Pompon. Mêla. I, i3. On
l'appelle aujourd'hui Scalamura ou Anamura.
3o
F. Quatre gradins inférieurs, plus larges et plus commodes que les autres, et réservés sans
doute pour Tordre équestre. Tous ces gradins sont faits d'une lave appelée piperne : c'est une
pierre grise dont l'aspect est fort triste.
G. Le pavé de l'orchestre. On voit, sur la ligne même qui forme le diamètre de ce demi-
cercle, l'inscription que nous avons rapportée plus haut, et, entre cette inscription et le théâtre,
le dallage de marbre que nous avons mentionné. Le reste de l'orchestre est également dallé en
marbre débité fort mince.
H. La place du proscenium, ou pulpitum, plancher supporté par un mur à hauteur d'appui. Ce
mur était revêtu de marbre blanc.
I. Postscénium, d'où l'on arrivait sur la scène par trois portes principales. Celle du milieu
était la porte rojale; les deux autres, appelées portes hospitales, étaient destinées aux personnages
d'un rang inférieur, et à ceux qui étaient censés venir des pays étrangers. On voit, en outre,
deux petites portes aux deux extrémités du fond de la scène. Leur usage est d'autant plus difficile
à déterminer, qu'elles ne se trouvent dans aucun autre théâtre. Peut-être étaient-elles destinées
à l'arrangement du théâtre et cachées par quelque décoration.
K. Deux espèces de tribunes, pareilles à nos loges d'avant-scène. Elles sont garnies, l'une de
deux gradins et l'autre de trois. On y montait par un petit escalier donnant sur l'avant-scène.
C'était une place réservée, d'un côté au préteur, aux duumvirs, et de l'autre aux vestales (i).
LL. Les deux vomitoires dont nous avons déjà parlé plus haut.
M. Un portique donnant sur la rue et servant probablement d'abri pour ceux qui attendaient
l'heure de l'ouverture des portes. Ce portique devait avoir été détruit par le tremblement de
terre de 63, ainsi qu'une grande partie de l'édifice. Lors des fouilles, on n'a trouvé debout qu'une
seule colonne d'une proportion assez courte. Elle était peinte de manière que sa surface paraissait
couverte d'écaillés comme un tronc de palmier, fait important pour la question qui s'agite aujour-
d'hui relativement à l'architecture peinte. Il résulte des notes de Mazois qu'il a vu lui-même le
tronçon de colonne , revêtu des ornements dont nous venons de faire mention. Du reste, on aperce-
vait encore le petit mur qui soutenait les autres colonnes; et dans le mur même du théâtre, on
reconnaissait les trous des solives du toit. On a déterré dans le proscenium des fragments de co-
lonnes et de statues; mais c'est à tort que M. Lavega les a pris pour des ornements de la scène :
ce sont des fragments des colonnes du portique, ou d'autres parties de l'édifice, ou même du Camp
des soldats, qui doivent avoir été placés dans cet endroit pour les conserver provisoirement. Lors
de la dernière catastrophe, le petit théâtre devait être en réparation, comme les autres édifices de
la ville, ébranlés par le tremblement de terre de 63. On a trouvé en différents endroits des amas
considérables de matériaux; et particulièrement, lors des fouilles faites pour déblayer la scène du
petit théâtre, on y a découvert une grande quantité de tuiles neuves, rangées en ordre et numérotées
avec du charbon. En admettant même que ces tuiles dussent servir pour les édifices voisins, il
est évident qu'elles n'eussent point été déposées dans ce théâtre, s'il avait été lui-même en état
de recevoir des spectateurs.
Le plan et la coupe transversale que l'on voit à la partie supérieure de la planche XXVIII, sont
les dessins du petit théâtre ou de l'odéum d'Anemurium (2). Nous les donnons comme points de
comparaison avec le petit théâtre de Pompéi. Les dimensions du théâtre d'Anemurium sont
doubles de celles du nôtre; mais ils se ressemblent en ce que leur forme extérieure est un
(r) Suétone, August. cap. i4
(2) Jnemurium était situé sur le rivage de la Cilicie. Cette ville occupait un promontoire qui portait le même nom, et que
l'on considère comme le point le plus méridional de cette côte. Plin. V, 22, 27. Tit. Liv. XXXIII, 20. Pompon. Mêla. I, i3. On
l'appelle aujourd'hui Scalamura ou Anamura.
3o