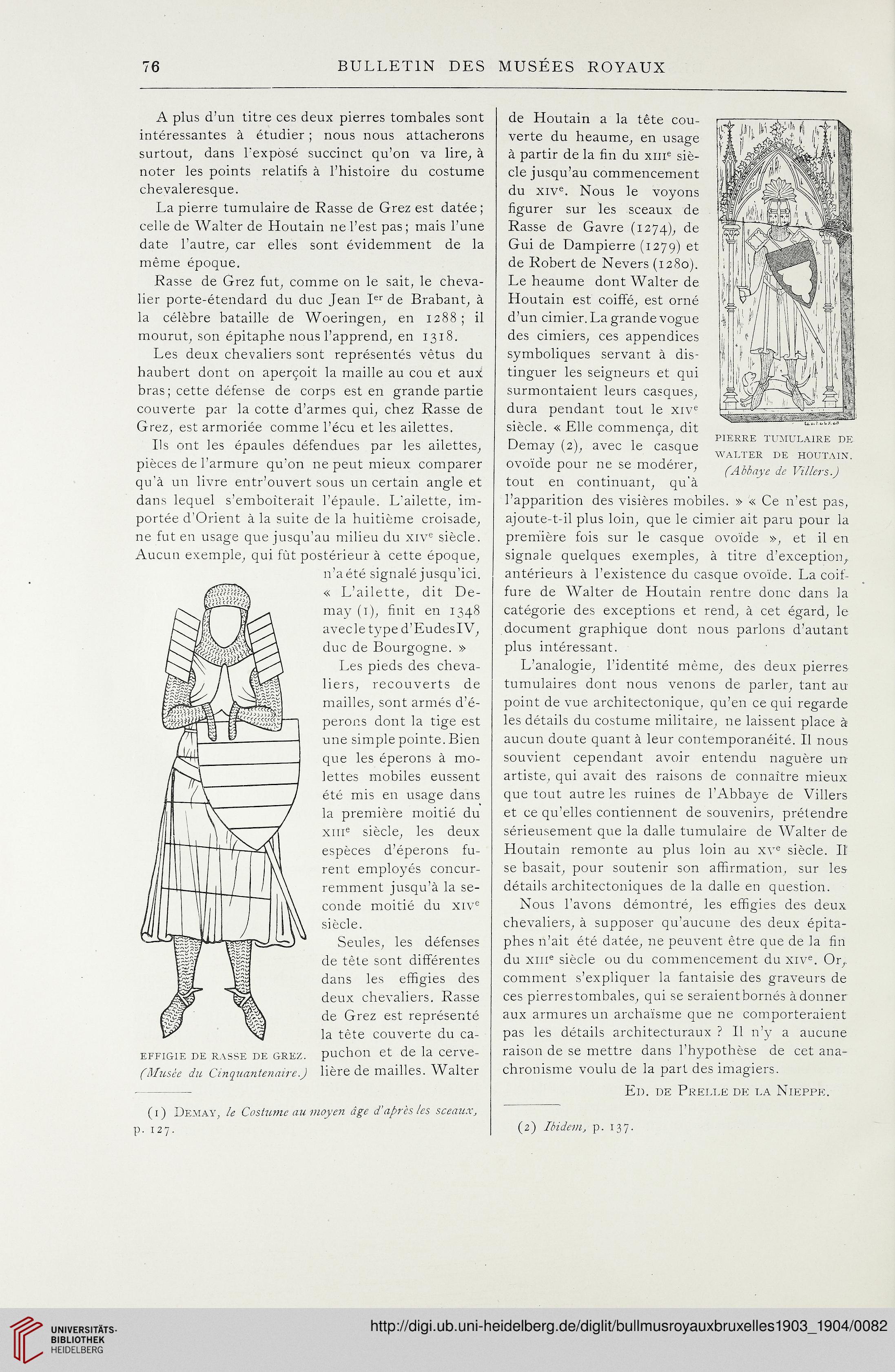76
BULLETIN DES MUSÉES ROYAUX
A plus d’un titre ces deux pierres tombales sont
intéressantes à étudier ; nous nous attacherons
surtout, dans l'exposé succinct qu’on va lire, à
noter les points relatifs à l’histoire du costume
chevaleresque.
La pierre tumulaire de Rasse de Grez est datée ;
celle de Walter de Houtain ne l’est pas; mais l’une
date l'autre, car elles sont évidemment de la
même époque.
Rasse de Grez fut, comme on le sait, le cheva-
lier porte-étendard du duc Jean Ier de Brabant, à
la célèbre bataille de Woeringen, en 1288; il
mourut, son épitaphe nous l’apprend, en 1318.
Les deux chevaliers sont représentés vêtus du
haubert dont 011 aperçoit la maille au cou et aux
bras ; cette défense de corps est en grande partie
couverte par la cotte d’armes qui, chez Rasse de
Grez, est armoriée comme l’écu et les ailettes.
Ils ont les épaules défendues par les ailettes,
pièces de l’armure qu’on ne peut mieux comparer
qu'à un livre entr’ouvert sous un certain angle et
dans lequel s’emboîterait l’épaule. L'ailette, im-
portée d’Orient à la suite de la huitième croisade,
ne fut en usage que jusqu’au milieu du xive siècle.
Aucun exemple, qui fût postérieur à cette époque,
n’a été signalé jusqu’ici.
« L’ailette, dit De-
may (1), finit en 1348
avecle type d’EudesIV,
duc de Bourgogne. »
Les pieds des cheva-
liers, recouverts de
mailles, sont armés d’é-
perons dont la tige est
une simple pointe. Bien
que les éperons à mo-
lettes mobiles eussent
été mis en usage dans
la première moitié du
xme siècle, les deux
espèces d’éperons fu-
rent employés concur-
remment jusqu’à la se-
conde moitié du xive
siècle.
Seules, les défenses
de tête sont différentes
dans les effigies des
deux chevaliers. Rasse
de Grez est représenté
la tète couverte du ca-
puchon et de la cerve-
lière de mailles. Walter
(1) Demay, le Costume au moyen âge d’après les sceaux,
p. 127.
de Houtain a la tête cou-
verte du heaume, en usage
à partir de la fin du xme siè-
cle jusqu’au commencement
du xive. Nous le voyons
figurer sur les sceaux de
Rasse de Gavre (1274), de
Gui de Dampierre (1279) et
de Robert de Nevers (1280).
Le heaume dont Walter de
Houtain est coiffé, est orné
d’un cimier. La grande vogue
des cimiers, ces appendices
symboliques servant à dis-
tinguer les seigneurs et qui
surmontaient leurs casques,
dura pendant tout le xive
siècle. « Elle commença, dit
Demay (2), avec le casque
ovoïde pour ne se modérer,
tout en continuant, qu’à
l’apparition des visières mobiles. » « Ce n’est pas,
ajoute-t-il plus loin, que le cimier ait paru pour la
première fois sur le casque ovoïde », et il en
signale quelques exemples, à titre d’exception,
antérieurs à l’existence du casque ovoïde. La coif-
fure de Walter de Houtain rentre donc dans la
catégorie des exceptions et rend, à cet égard, le
document graphique dont nous parlons d’autant
plus intéressant.
L’analogie, l’identité même, des deux pierres
tumulaires dont nous venons de parler, tant au
point de vue architectonique, qu’en ce qui regarde
les détails du costume militaire, ne laissent place à
aucun doute quant à leur contemporanéité. Il nous
souvient cependant avoir entendu naguère un
artiste, qui avait des raisons de connaître mieux
que tout autre les ruines de l’Abbaye de Villers
et ce qu’elles contiennent de souvenirs, prétendre
sérieusement que la dalle tumulaire de Walter de
Houtain remonte au plus loin au xve siècle. Il
se basait, pour soutenir son affirmation, sur les
détails architectoniques de la dalle en question.
Nous l’avons démontré, les effigies des deux
chevaliers, à supposer qu’aucune des deux épita-
phes n’ait été datée, ne peuvent être que de la fin
du xme siècle ou du commencement du xive. Or,,
comment s’expliquer la fantaisie des graveurs de
ces pierrestombales, qui se seraientbornés à donner
aux armures un archaïsme que ne comporteraient
pas les détails architecturaux ? Il n’y a aucune
raison de se mettre dans l’hypothèse de cet ana-
chronisme voulu de la part des imagiers.
PIERRE TUMULAIRE DE
WALTER DE HOUTAIN.
(Abbaye de Villers.)
El), de Prelle de la Nieppk.
(2) Ibidemj p. 137.
BULLETIN DES MUSÉES ROYAUX
A plus d’un titre ces deux pierres tombales sont
intéressantes à étudier ; nous nous attacherons
surtout, dans l'exposé succinct qu’on va lire, à
noter les points relatifs à l’histoire du costume
chevaleresque.
La pierre tumulaire de Rasse de Grez est datée ;
celle de Walter de Houtain ne l’est pas; mais l’une
date l'autre, car elles sont évidemment de la
même époque.
Rasse de Grez fut, comme on le sait, le cheva-
lier porte-étendard du duc Jean Ier de Brabant, à
la célèbre bataille de Woeringen, en 1288; il
mourut, son épitaphe nous l’apprend, en 1318.
Les deux chevaliers sont représentés vêtus du
haubert dont 011 aperçoit la maille au cou et aux
bras ; cette défense de corps est en grande partie
couverte par la cotte d’armes qui, chez Rasse de
Grez, est armoriée comme l’écu et les ailettes.
Ils ont les épaules défendues par les ailettes,
pièces de l’armure qu’on ne peut mieux comparer
qu'à un livre entr’ouvert sous un certain angle et
dans lequel s’emboîterait l’épaule. L'ailette, im-
portée d’Orient à la suite de la huitième croisade,
ne fut en usage que jusqu’au milieu du xive siècle.
Aucun exemple, qui fût postérieur à cette époque,
n’a été signalé jusqu’ici.
« L’ailette, dit De-
may (1), finit en 1348
avecle type d’EudesIV,
duc de Bourgogne. »
Les pieds des cheva-
liers, recouverts de
mailles, sont armés d’é-
perons dont la tige est
une simple pointe. Bien
que les éperons à mo-
lettes mobiles eussent
été mis en usage dans
la première moitié du
xme siècle, les deux
espèces d’éperons fu-
rent employés concur-
remment jusqu’à la se-
conde moitié du xive
siècle.
Seules, les défenses
de tête sont différentes
dans les effigies des
deux chevaliers. Rasse
de Grez est représenté
la tète couverte du ca-
puchon et de la cerve-
lière de mailles. Walter
(1) Demay, le Costume au moyen âge d’après les sceaux,
p. 127.
de Houtain a la tête cou-
verte du heaume, en usage
à partir de la fin du xme siè-
cle jusqu’au commencement
du xive. Nous le voyons
figurer sur les sceaux de
Rasse de Gavre (1274), de
Gui de Dampierre (1279) et
de Robert de Nevers (1280).
Le heaume dont Walter de
Houtain est coiffé, est orné
d’un cimier. La grande vogue
des cimiers, ces appendices
symboliques servant à dis-
tinguer les seigneurs et qui
surmontaient leurs casques,
dura pendant tout le xive
siècle. « Elle commença, dit
Demay (2), avec le casque
ovoïde pour ne se modérer,
tout en continuant, qu’à
l’apparition des visières mobiles. » « Ce n’est pas,
ajoute-t-il plus loin, que le cimier ait paru pour la
première fois sur le casque ovoïde », et il en
signale quelques exemples, à titre d’exception,
antérieurs à l’existence du casque ovoïde. La coif-
fure de Walter de Houtain rentre donc dans la
catégorie des exceptions et rend, à cet égard, le
document graphique dont nous parlons d’autant
plus intéressant.
L’analogie, l’identité même, des deux pierres
tumulaires dont nous venons de parler, tant au
point de vue architectonique, qu’en ce qui regarde
les détails du costume militaire, ne laissent place à
aucun doute quant à leur contemporanéité. Il nous
souvient cependant avoir entendu naguère un
artiste, qui avait des raisons de connaître mieux
que tout autre les ruines de l’Abbaye de Villers
et ce qu’elles contiennent de souvenirs, prétendre
sérieusement que la dalle tumulaire de Walter de
Houtain remonte au plus loin au xve siècle. Il
se basait, pour soutenir son affirmation, sur les
détails architectoniques de la dalle en question.
Nous l’avons démontré, les effigies des deux
chevaliers, à supposer qu’aucune des deux épita-
phes n’ait été datée, ne peuvent être que de la fin
du xme siècle ou du commencement du xive. Or,,
comment s’expliquer la fantaisie des graveurs de
ces pierrestombales, qui se seraientbornés à donner
aux armures un archaïsme que ne comporteraient
pas les détails architecturaux ? Il n’y a aucune
raison de se mettre dans l’hypothèse de cet ana-
chronisme voulu de la part des imagiers.
PIERRE TUMULAIRE DE
WALTER DE HOUTAIN.
(Abbaye de Villers.)
El), de Prelle de la Nieppk.
(2) Ibidemj p. 137.