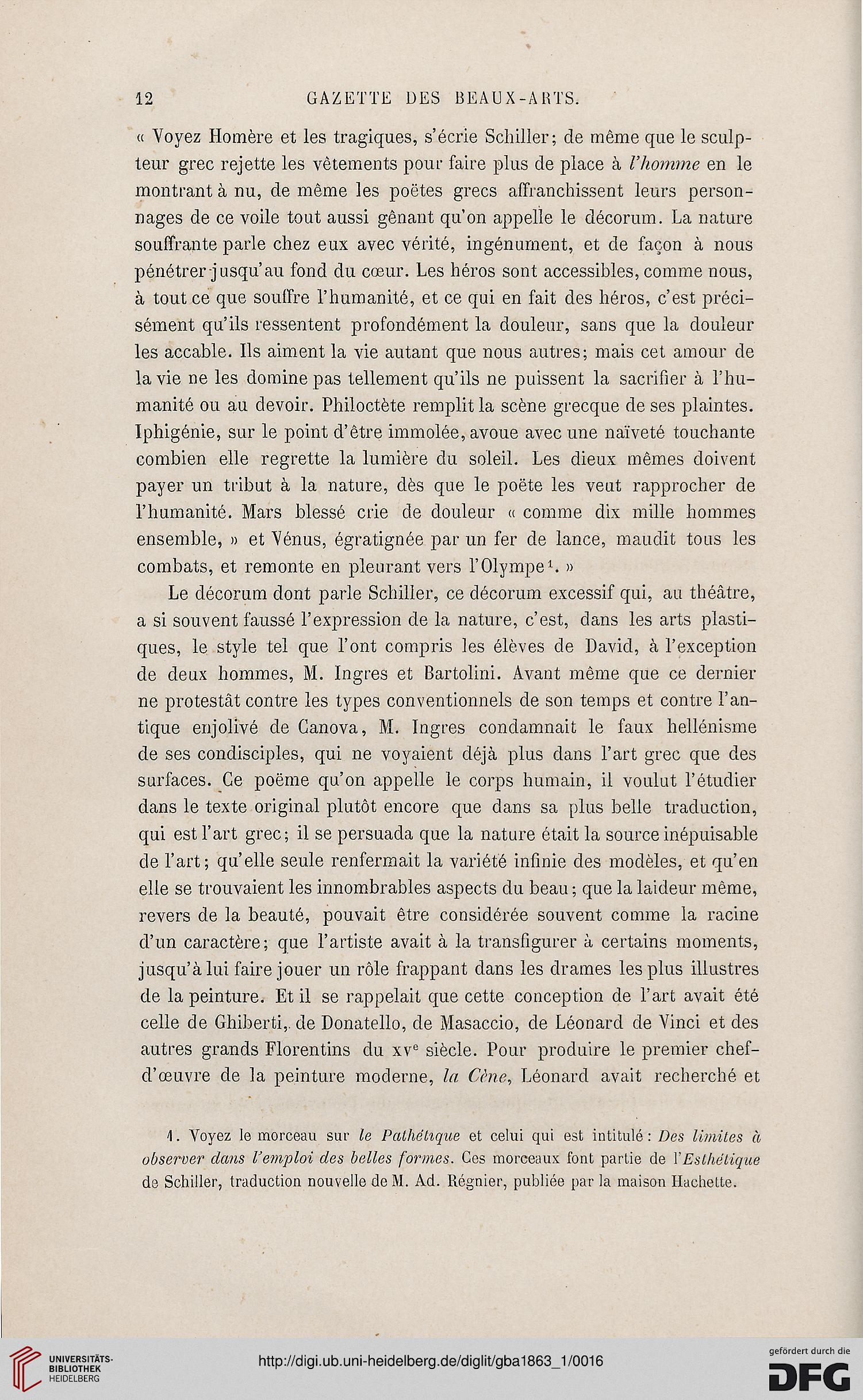12
GAZETTE DES BEAUX-AKTS.
« Voyez Homère et les tragiques, s'écrie Schiller; de même que le sculp-
teur grec rejette les vêtements pour faire plus de place à l'homme en le
montrant à nu, de même les poètes grecs affranchissent leurs person-
nages de ce voile tout aussi gênant qu'on appelle le décorum. La nature
souffrante parle chez eux avec vérité, ingénument, et de façon à nous
pénétrer jusqu'au fond du cœur. Les héros sont accessibles, comme nous,
à tout ce que souffre l'humanité, et ce qui en fait des héros, c'est préci-
sément qu'ils ressentent profondément la douleur, sans que la douleur
les accable. Ils aiment la vie autant que nous autres; mais cet amour de
la vie ne les domine pas tellement qu'ils ne puissent la sacrifier à l'hu-
manité ou au devoir. Philoctète remplit la scène grecque de ses plaintes.
Iphigénie, sur le point d'être immolée, avoue avec une naïveté touchante
combien elle regrette la lumière du soleil. Les dieux mêmes doivent
payer un tribut à la nature, dès que le poète les veut rapprocher de
l'humanité. Mars blessé crie de douleur « comme dix mille hommes
ensemble, » et Vénus, égratignée par un fer de lance, maudit tous les
combats, et remonte en pleurant vers l'Olympe1. »
Le décorum dont parle Schiller, ce décorum excessif qui, au théâtre,
a si souvent faussé l'expression de la nature, c'est, dans les arts plasti-
ques, le style tel que l'ont compris les élèves de David, à l'exception
de deux hommes, M. Ingres et Bartolini. Avant même que ce dernier
ne protestât contre les types conventionnels de son temps et contre l'an-
tique enjolivé de Ganova, M. Ingres condamnait le faux hellénisme
de ses condisciples, qui ne voyaient déjà plus dans l'art grec que des
surfaces. Ce poëme qu'on appelle le corps humain, il voulut l'étudier
dans le texte original plutôt encore que dans sa plus belle traduction,
qui est l'art grec; il se persuada que la nature était la source inépuisable
de l'art; qu'elle seule renfermait la variété infinie des modèles, et qu'en
elle se trouvaient les innombrables aspects du beau ; que la laideur même,
revers de la beauté, pouvait être considérée souvent comme la racine
d'un caractère; que l'artiste avait à la transfigurer à certains moments,
jusqu'à lui faire jouer un rôle frappant dans les drames les plus illustres
de la peinture. Et il se rappelait que cette conception de l'art avait été
celle de Ghiberti,. de Donatello, de Masaccio, de Léonard de Vinci et des
autres grands Florentins du xve siècle. Pour produire le premier chef-
d'œuvre de la peinture moderne, la Cène, Léonard avait recherché et
\. Voyez le morceau sur le Pathétique et celui qui est intitulé : Des limites à
observer dans l'emploi des belles formes. Ces morceaux font partie de l'Esthétique
ds Schiller, traduction nouvelle de M. Ad. Régnier, publiée par la maison Hachette.
GAZETTE DES BEAUX-AKTS.
« Voyez Homère et les tragiques, s'écrie Schiller; de même que le sculp-
teur grec rejette les vêtements pour faire plus de place à l'homme en le
montrant à nu, de même les poètes grecs affranchissent leurs person-
nages de ce voile tout aussi gênant qu'on appelle le décorum. La nature
souffrante parle chez eux avec vérité, ingénument, et de façon à nous
pénétrer jusqu'au fond du cœur. Les héros sont accessibles, comme nous,
à tout ce que souffre l'humanité, et ce qui en fait des héros, c'est préci-
sément qu'ils ressentent profondément la douleur, sans que la douleur
les accable. Ils aiment la vie autant que nous autres; mais cet amour de
la vie ne les domine pas tellement qu'ils ne puissent la sacrifier à l'hu-
manité ou au devoir. Philoctète remplit la scène grecque de ses plaintes.
Iphigénie, sur le point d'être immolée, avoue avec une naïveté touchante
combien elle regrette la lumière du soleil. Les dieux mêmes doivent
payer un tribut à la nature, dès que le poète les veut rapprocher de
l'humanité. Mars blessé crie de douleur « comme dix mille hommes
ensemble, » et Vénus, égratignée par un fer de lance, maudit tous les
combats, et remonte en pleurant vers l'Olympe1. »
Le décorum dont parle Schiller, ce décorum excessif qui, au théâtre,
a si souvent faussé l'expression de la nature, c'est, dans les arts plasti-
ques, le style tel que l'ont compris les élèves de David, à l'exception
de deux hommes, M. Ingres et Bartolini. Avant même que ce dernier
ne protestât contre les types conventionnels de son temps et contre l'an-
tique enjolivé de Ganova, M. Ingres condamnait le faux hellénisme
de ses condisciples, qui ne voyaient déjà plus dans l'art grec que des
surfaces. Ce poëme qu'on appelle le corps humain, il voulut l'étudier
dans le texte original plutôt encore que dans sa plus belle traduction,
qui est l'art grec; il se persuada que la nature était la source inépuisable
de l'art; qu'elle seule renfermait la variété infinie des modèles, et qu'en
elle se trouvaient les innombrables aspects du beau ; que la laideur même,
revers de la beauté, pouvait être considérée souvent comme la racine
d'un caractère; que l'artiste avait à la transfigurer à certains moments,
jusqu'à lui faire jouer un rôle frappant dans les drames les plus illustres
de la peinture. Et il se rappelait que cette conception de l'art avait été
celle de Ghiberti,. de Donatello, de Masaccio, de Léonard de Vinci et des
autres grands Florentins du xve siècle. Pour produire le premier chef-
d'œuvre de la peinture moderne, la Cène, Léonard avait recherché et
\. Voyez le morceau sur le Pathétique et celui qui est intitulé : Des limites à
observer dans l'emploi des belles formes. Ces morceaux font partie de l'Esthétique
ds Schiller, traduction nouvelle de M. Ad. Régnier, publiée par la maison Hachette.