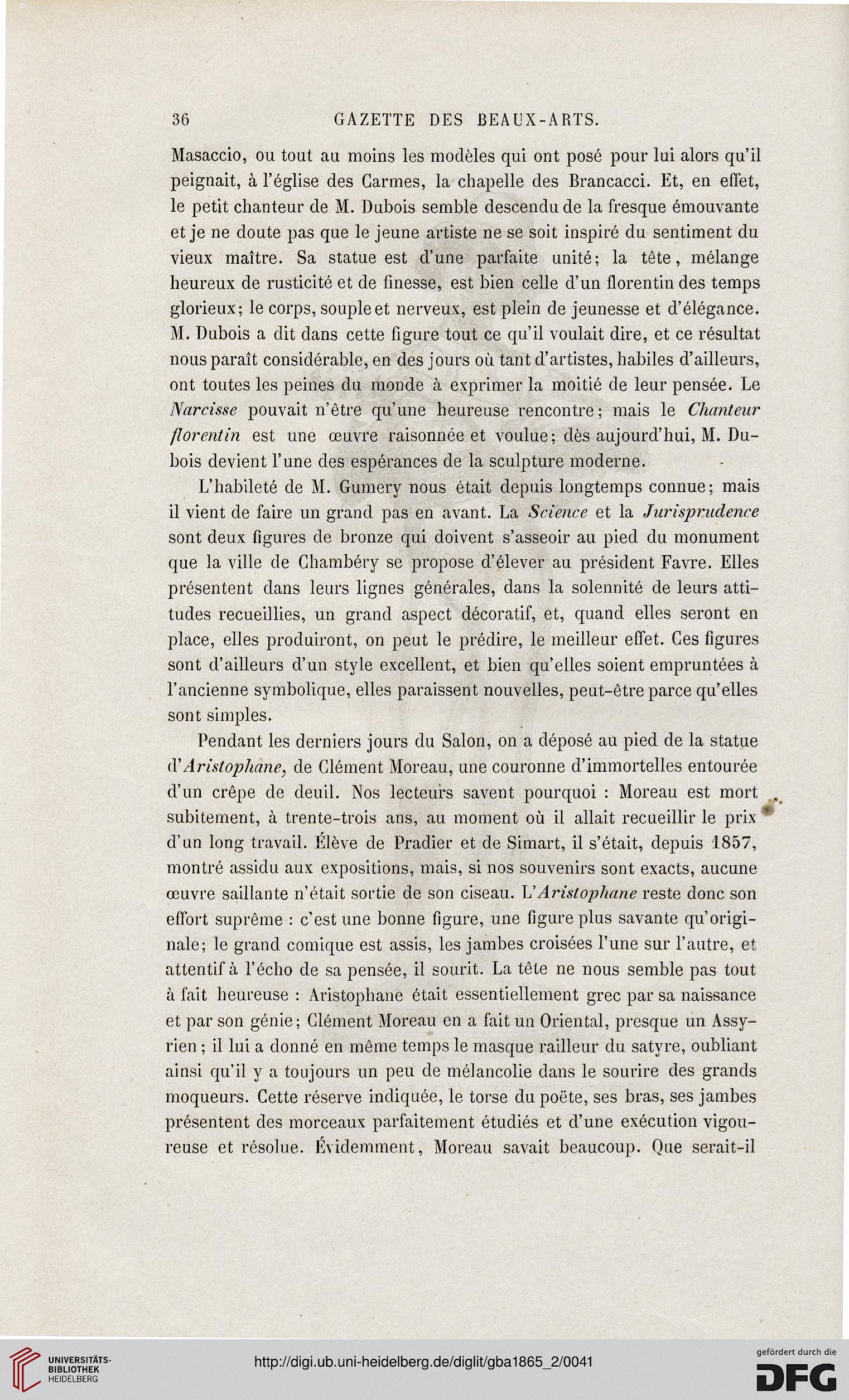36
GAZETTE DES BEAUX-ARTS.
Masaccio, ou tout au moins les modèles qui ont posé pour lui alors qu’il
peignait, à l’église des Carmes, la chapelle des Brancacci. Et, en effet,
le petit chanteur de M. Dubois semble descendu de la fresque émouvante
et je ne doute pas que le jeune artiste ne se soit inspiré du sentiment du
vieux maître. Sa statue est d’une parfaite unité; la tête, mélange
heureux de rusticité et de finesse, est bien celle d’un florentin des temps
glorieux; le corps, souple et nerveux, est plein de jeunesse et d’élégance.
M. Dubois a dit dans cette figure tout ce qu’il voulait dire, et ce résultat
nous paraît considérable, en des jours où tant d’artistes, habiles d’ailleurs,
ont toutes les peines du monde à exprimer la moitié de leur pensée. Le
Narcisse pouvait n’être qu’une heureuse rencontre; mais le Chanteur
florentin est une œuvre raisonnée et voulue; dès aujourd’hui, M. Du-
bois devient l’une des espérances de la sculpture moderne.
L’habileté de M. Gumery nous était depuis longtemps connue; mais
il vient de faire un grand pas en avant. La Science et la Jurisprudence
sont deux figures de bronze qui doivent s’asseoir au pied du monument
que la ville de Chambéry se propose d’élever au président Favre. Elles
présentent dans leurs lignes générales, dans la solennité de leurs atti-
tudes recueillies, un grand aspect décoratif, et, quand elles seront en
place, elles produiront, on peut le prédire, le meilleur effet. Ces figures
sont d’ailleurs d’un style excellent, et bien qu’elles soient empruntées à
l’ancienne symbolique, elles paraissent nouvelles, peut-être parce qu’elles
sont simples.
Pendant les derniers jours du Salon, on a déposé au pied de la statue
d'Aristophane, de Clément Moreau, une couronne d’immortelles entourée
d’un crêpe de deuil. Nos lecteurs savent pourquoi : Moreau est mort
, *
subitement, à trente-trois ans, au moment où il allait recueillir le prix
d’un long travail. Élève de Pradier et de Simart, il s’était, depuis 1857,
montré assidu aux expositions, mais, si nos souvenirs sont exacts, aucune
œuvre saillante n’était sortie de son ciseau. L'Aristophane reste donc son
effort suprême : c’est une bonne figure, une figure plus savante qu’origi-
nale; le grand comique est assis, les jambes croisées l’une sur l’autre, et
attentif cà l’écho de sa pensée, il sourit. La tête ne nous semble pas tout
à fait heureuse : Aristophane était essentiellement grec par sa naissance
et par son génie; Clément Moreau en a fait un Oriental, presque un Assy-
rien ; il lui a donné en même temps le masque railleur du satyre, oubliant
ainsi qu’il y a toujours un peu de mélancolie dans le sourire des grands
moqueurs. Cette réserve indiquée, le torse du poète, ses bras, ses jambes
présentent des morceaux parfaitement étudiés et d’une exécution vigou-
reuse et résolue. Évidemment, Moreau savait beaucoup. Que serait-il
GAZETTE DES BEAUX-ARTS.
Masaccio, ou tout au moins les modèles qui ont posé pour lui alors qu’il
peignait, à l’église des Carmes, la chapelle des Brancacci. Et, en effet,
le petit chanteur de M. Dubois semble descendu de la fresque émouvante
et je ne doute pas que le jeune artiste ne se soit inspiré du sentiment du
vieux maître. Sa statue est d’une parfaite unité; la tête, mélange
heureux de rusticité et de finesse, est bien celle d’un florentin des temps
glorieux; le corps, souple et nerveux, est plein de jeunesse et d’élégance.
M. Dubois a dit dans cette figure tout ce qu’il voulait dire, et ce résultat
nous paraît considérable, en des jours où tant d’artistes, habiles d’ailleurs,
ont toutes les peines du monde à exprimer la moitié de leur pensée. Le
Narcisse pouvait n’être qu’une heureuse rencontre; mais le Chanteur
florentin est une œuvre raisonnée et voulue; dès aujourd’hui, M. Du-
bois devient l’une des espérances de la sculpture moderne.
L’habileté de M. Gumery nous était depuis longtemps connue; mais
il vient de faire un grand pas en avant. La Science et la Jurisprudence
sont deux figures de bronze qui doivent s’asseoir au pied du monument
que la ville de Chambéry se propose d’élever au président Favre. Elles
présentent dans leurs lignes générales, dans la solennité de leurs atti-
tudes recueillies, un grand aspect décoratif, et, quand elles seront en
place, elles produiront, on peut le prédire, le meilleur effet. Ces figures
sont d’ailleurs d’un style excellent, et bien qu’elles soient empruntées à
l’ancienne symbolique, elles paraissent nouvelles, peut-être parce qu’elles
sont simples.
Pendant les derniers jours du Salon, on a déposé au pied de la statue
d'Aristophane, de Clément Moreau, une couronne d’immortelles entourée
d’un crêpe de deuil. Nos lecteurs savent pourquoi : Moreau est mort
, *
subitement, à trente-trois ans, au moment où il allait recueillir le prix
d’un long travail. Élève de Pradier et de Simart, il s’était, depuis 1857,
montré assidu aux expositions, mais, si nos souvenirs sont exacts, aucune
œuvre saillante n’était sortie de son ciseau. L'Aristophane reste donc son
effort suprême : c’est une bonne figure, une figure plus savante qu’origi-
nale; le grand comique est assis, les jambes croisées l’une sur l’autre, et
attentif cà l’écho de sa pensée, il sourit. La tête ne nous semble pas tout
à fait heureuse : Aristophane était essentiellement grec par sa naissance
et par son génie; Clément Moreau en a fait un Oriental, presque un Assy-
rien ; il lui a donné en même temps le masque railleur du satyre, oubliant
ainsi qu’il y a toujours un peu de mélancolie dans le sourire des grands
moqueurs. Cette réserve indiquée, le torse du poète, ses bras, ses jambes
présentent des morceaux parfaitement étudiés et d’une exécution vigou-
reuse et résolue. Évidemment, Moreau savait beaucoup. Que serait-il