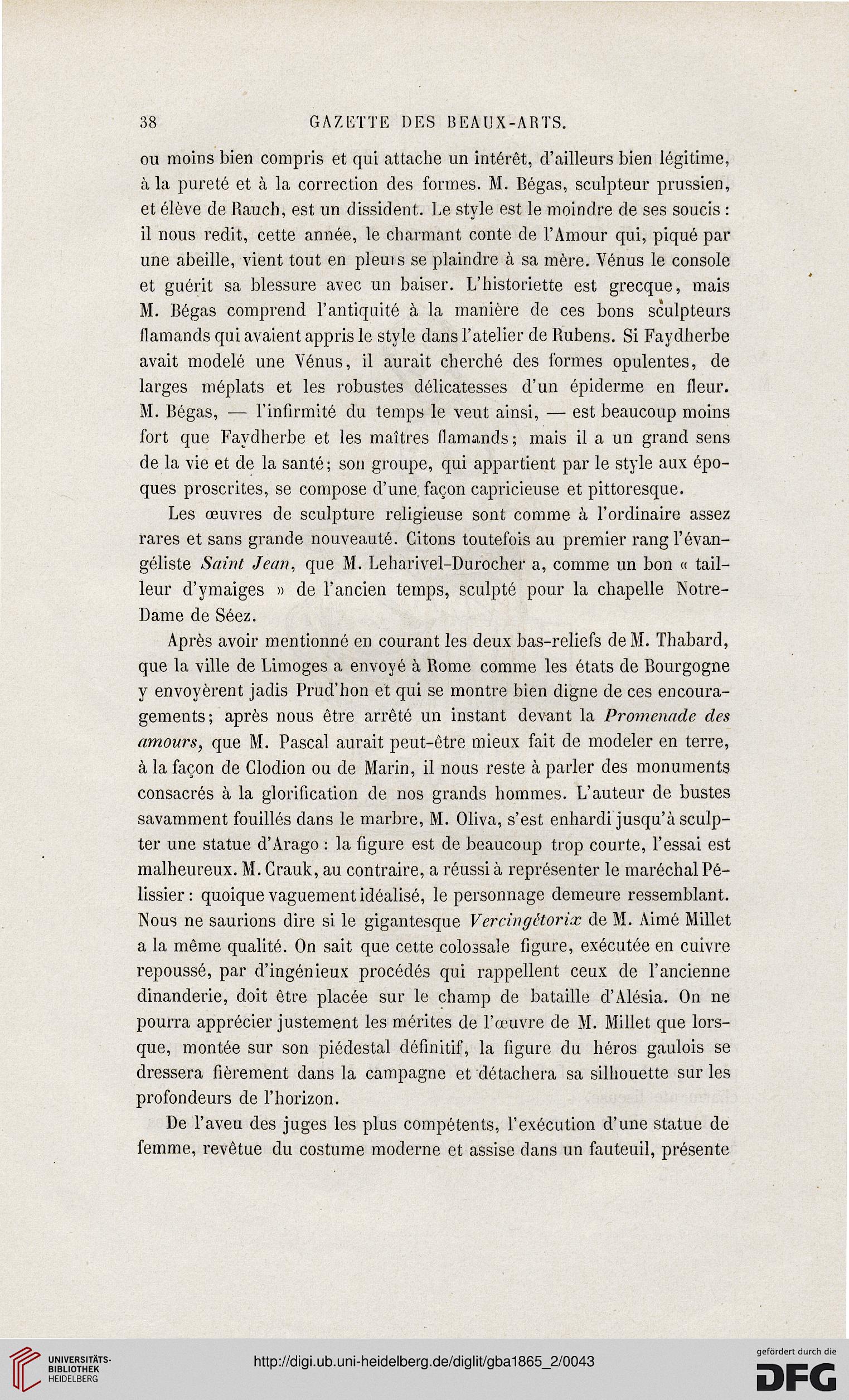38
GAZIiTTE DES BEAUX-ARTS.
ou moins bien compris et qui attache un intérêt, d’ailleurs bien légitime,
à la pureté et à la correction des formes. M. Bégas, sculpteur prussien,
et élève de Rauch, est un dissident. Le style est le moindre de ses soucis :
il nous redit, cette année, le charmant conte de l’Amour qui, piqué par
une abeille, vient tout en pleuis se plaindre à sa mère. Vénus le console
et guérit sa blessure avec un baiser. L’historiette est grecque, mais
M. Bégas comprend l’antiquité à la manière de ces bons sculpteurs
flamands qui avaient appris le style dans l’atelier de Rubens. Si Faydherbe
avait modelé une Vénus, il aurait cherché des formes opulentes, de
larges méplats et les robustes délicatesses d’un épiderme en fleur.
M. Bégas, — l’infirmité du temps le veut ainsi, — est beaucoup moins
fort que Faydherbe et les maîtres flamands; mais il a un grand sens
de la vie et de la santé ; son groupe, qui appartient par le style aux épo-
ques proscrites, se compose d’une, façon capricieuse et pittoresque.
Les œuvres de sculpture religieuse sont comme à l’ordinaire assez
rares et sans grande nouveauté. Citons toutefois au premier rang l’évan-
géliste Saint Jean, que M. Leharivel-Durocher a, comme un bon « tail-
leur d’ymaiges » de l’ancien temps, sculpté pour la chapelle Notre-
Dame de Séez.
Après avoir mentionné en courant les deux bas-reliefs deM. Thabard,
que la ville de Limoges a envoyé à Rome comme les états de Bourgogne
y envoyèrent jadis Prud’hon et qui se montre bien digne de ces encoura-
gements; après nous être arrêté un instant devant la Promenade des
amours, que M. Pascal aurait peut-être mieux fait de modeler en terre,
à la façon de Clodion ou de Marin, il nous reste à parler des monuments
consacrés à la glorification de nos grands hommes. L’auteur de bustes
savamment fouillés dans le marbre, M. Oliva, s’est enhardi jusqu’à sculp-
ter une statue d’Arago : la figure est de beaucoup trop courte, l’essai est
malheureux. M. Crauk, au contraire, a réussi à représenter le maréchal Pé-
lissier : quoique vaguement idéalisé, le personnage demeure ressemblant.
Nous ne saurions dire si le gigantesque Vercingétorix de M. Aimé Millet
a la même qualité. On sait que cette colossale figure, exécutée en cuivre
repoussé, par d’ingénieux procédés qui rappellent ceux de l’ancienne
dinanderie, doit être placée sur le champ de bataille d’Alésia. On ne
pourra apprécier justement les mérites de l’œuvre de M. Millet que lors-
que, montée sur son piédestal définitif, la figure du héros gaulois se
dressera fièrement dans la campagne et détachera sa silhouette sur les
profondeurs de l’horizon.
De l’aveu des juges les plus compétents, l’exécution d’une statue de
femme, revêtue du costume moderne et assise dans un fauteuil, présente
GAZIiTTE DES BEAUX-ARTS.
ou moins bien compris et qui attache un intérêt, d’ailleurs bien légitime,
à la pureté et à la correction des formes. M. Bégas, sculpteur prussien,
et élève de Rauch, est un dissident. Le style est le moindre de ses soucis :
il nous redit, cette année, le charmant conte de l’Amour qui, piqué par
une abeille, vient tout en pleuis se plaindre à sa mère. Vénus le console
et guérit sa blessure avec un baiser. L’historiette est grecque, mais
M. Bégas comprend l’antiquité à la manière de ces bons sculpteurs
flamands qui avaient appris le style dans l’atelier de Rubens. Si Faydherbe
avait modelé une Vénus, il aurait cherché des formes opulentes, de
larges méplats et les robustes délicatesses d’un épiderme en fleur.
M. Bégas, — l’infirmité du temps le veut ainsi, — est beaucoup moins
fort que Faydherbe et les maîtres flamands; mais il a un grand sens
de la vie et de la santé ; son groupe, qui appartient par le style aux épo-
ques proscrites, se compose d’une, façon capricieuse et pittoresque.
Les œuvres de sculpture religieuse sont comme à l’ordinaire assez
rares et sans grande nouveauté. Citons toutefois au premier rang l’évan-
géliste Saint Jean, que M. Leharivel-Durocher a, comme un bon « tail-
leur d’ymaiges » de l’ancien temps, sculpté pour la chapelle Notre-
Dame de Séez.
Après avoir mentionné en courant les deux bas-reliefs deM. Thabard,
que la ville de Limoges a envoyé à Rome comme les états de Bourgogne
y envoyèrent jadis Prud’hon et qui se montre bien digne de ces encoura-
gements; après nous être arrêté un instant devant la Promenade des
amours, que M. Pascal aurait peut-être mieux fait de modeler en terre,
à la façon de Clodion ou de Marin, il nous reste à parler des monuments
consacrés à la glorification de nos grands hommes. L’auteur de bustes
savamment fouillés dans le marbre, M. Oliva, s’est enhardi jusqu’à sculp-
ter une statue d’Arago : la figure est de beaucoup trop courte, l’essai est
malheureux. M. Crauk, au contraire, a réussi à représenter le maréchal Pé-
lissier : quoique vaguement idéalisé, le personnage demeure ressemblant.
Nous ne saurions dire si le gigantesque Vercingétorix de M. Aimé Millet
a la même qualité. On sait que cette colossale figure, exécutée en cuivre
repoussé, par d’ingénieux procédés qui rappellent ceux de l’ancienne
dinanderie, doit être placée sur le champ de bataille d’Alésia. On ne
pourra apprécier justement les mérites de l’œuvre de M. Millet que lors-
que, montée sur son piédestal définitif, la figure du héros gaulois se
dressera fièrement dans la campagne et détachera sa silhouette sur les
profondeurs de l’horizon.
De l’aveu des juges les plus compétents, l’exécution d’une statue de
femme, revêtue du costume moderne et assise dans un fauteuil, présente