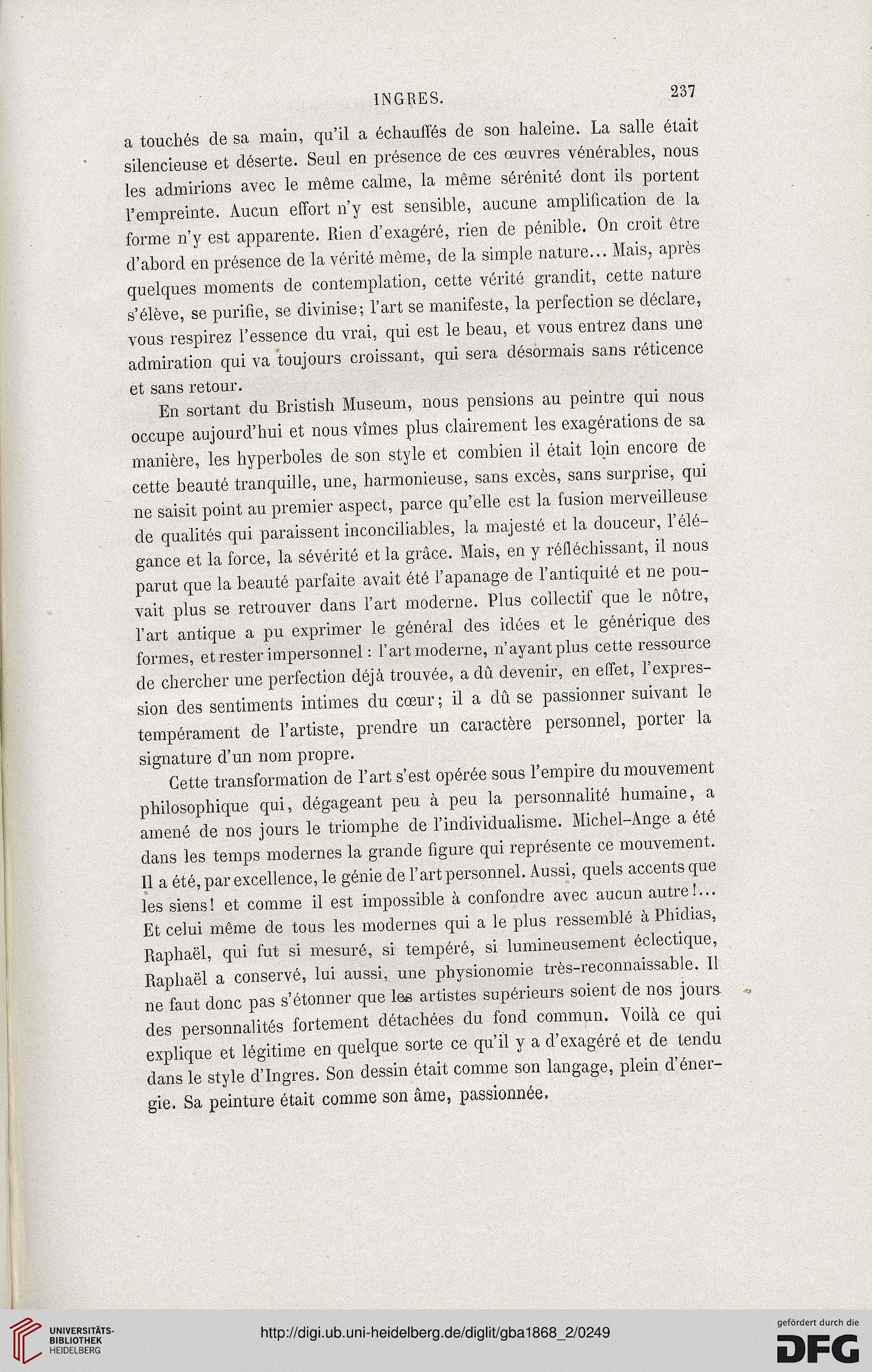INGRES.
237
a touchés de sa main, qu’il a échauffés de son haleine. La salle était
silencieuse et déserte. Seul en présence de ces œuvres vénérables, nous
les admirions avec le même calme, la même sérénité dont ils portent
l’empreinte. Aucun effort n’y est sensible, aucune amplification de la
forme n’y est apparente. Rien d’exagéré, rien de pénible. On croit être
d’abord en présence de la vérité même, de la simple nature... Mais, après
quelques moments de contemplation, cette vérité grandit, cette nature
s’élève, se purifie, se divinise; l’art se manifeste, la perfection se déclare,
vous respirez l’essence du vrai, qui est le beau, et vous entrez dans une
admiration qui va toujours croissant, qui sera désormais sans réticence
et sans retour.
En sortant du Bristish Muséum, nous pensions au peintre qui nous
occupe aujourd’hui et nous vîmes plus clairement les exagérations de sa
manière, les hyperboles de son style et combien il était loin encore de
cette beauté tranquille, une, harmonieuse, sans excès, sans surprise, qui
ne saisit point au premier aspect, parce qu’elle est la fusion merveilleuse
de qualités qui paraissent inconciliables, la majesté et la douceur, l’élé-
gance et la force, la sévérité et la grâce. Mais, en y réfléchissant, il nous
parut que la beauté parfaite avait été l’apanage de l’antiquité et ne pou-
vait plus se retrouver dans l’art moderne. Plus collectif que le nôtre,
l’art antique a pu exprimer le général des idées et le générique des
formes, et rester impersonnel : l’art moderne, n’ayant plus cette ressource
de chercher une perfection déjà trouvée, a dû devenir, en effet, l’expres-
sion des sentiments intimes du cœur ; il a dû se passionner suivant le
tempérament de l’artiste, prendre un caractère personnel, porter la
signature d’un nom propre.
Cette transformation de l’art s’est opéi’ée sous l’empire du mouvement
philosophique qui, dégageant peu à peu la personnalité humaine, a
amené de nos jours le triomphe de l’individualisme. Michel-Ange a été
dans les temps modernes la grande figure qui représente ce mouvement.
Il a été, par excellence, le génie de l’art personnel. Aussi, quels accents que
les siens ! et comme il est impossible à confondre avec aucun autre !...
Et celui même de tous les modernes qui a le plus ressemblé à Phidias,
Raphaël, qui fut si mesuré, si tempéré, si lumineusement éclectique,
Raphaël a conservé, lui aussi, une physionomie très-reconnaissable. Il
ne faut donc pas s’étonner que lee artistes supérieurs soient de nos jours
des personnalités fortement détachées du fond commun. Voilà ce qui
explique et légitime en quelque sorte ce qu’il y a d’exagéré et de tendu
dans le style d’Ingres. Son dessin était comme son langage, plein d’éner-
gie. Sa peinture était comme son âme, passionnée.
237
a touchés de sa main, qu’il a échauffés de son haleine. La salle était
silencieuse et déserte. Seul en présence de ces œuvres vénérables, nous
les admirions avec le même calme, la même sérénité dont ils portent
l’empreinte. Aucun effort n’y est sensible, aucune amplification de la
forme n’y est apparente. Rien d’exagéré, rien de pénible. On croit être
d’abord en présence de la vérité même, de la simple nature... Mais, après
quelques moments de contemplation, cette vérité grandit, cette nature
s’élève, se purifie, se divinise; l’art se manifeste, la perfection se déclare,
vous respirez l’essence du vrai, qui est le beau, et vous entrez dans une
admiration qui va toujours croissant, qui sera désormais sans réticence
et sans retour.
En sortant du Bristish Muséum, nous pensions au peintre qui nous
occupe aujourd’hui et nous vîmes plus clairement les exagérations de sa
manière, les hyperboles de son style et combien il était loin encore de
cette beauté tranquille, une, harmonieuse, sans excès, sans surprise, qui
ne saisit point au premier aspect, parce qu’elle est la fusion merveilleuse
de qualités qui paraissent inconciliables, la majesté et la douceur, l’élé-
gance et la force, la sévérité et la grâce. Mais, en y réfléchissant, il nous
parut que la beauté parfaite avait été l’apanage de l’antiquité et ne pou-
vait plus se retrouver dans l’art moderne. Plus collectif que le nôtre,
l’art antique a pu exprimer le général des idées et le générique des
formes, et rester impersonnel : l’art moderne, n’ayant plus cette ressource
de chercher une perfection déjà trouvée, a dû devenir, en effet, l’expres-
sion des sentiments intimes du cœur ; il a dû se passionner suivant le
tempérament de l’artiste, prendre un caractère personnel, porter la
signature d’un nom propre.
Cette transformation de l’art s’est opéi’ée sous l’empire du mouvement
philosophique qui, dégageant peu à peu la personnalité humaine, a
amené de nos jours le triomphe de l’individualisme. Michel-Ange a été
dans les temps modernes la grande figure qui représente ce mouvement.
Il a été, par excellence, le génie de l’art personnel. Aussi, quels accents que
les siens ! et comme il est impossible à confondre avec aucun autre !...
Et celui même de tous les modernes qui a le plus ressemblé à Phidias,
Raphaël, qui fut si mesuré, si tempéré, si lumineusement éclectique,
Raphaël a conservé, lui aussi, une physionomie très-reconnaissable. Il
ne faut donc pas s’étonner que lee artistes supérieurs soient de nos jours
des personnalités fortement détachées du fond commun. Voilà ce qui
explique et légitime en quelque sorte ce qu’il y a d’exagéré et de tendu
dans le style d’Ingres. Son dessin était comme son langage, plein d’éner-
gie. Sa peinture était comme son âme, passionnée.