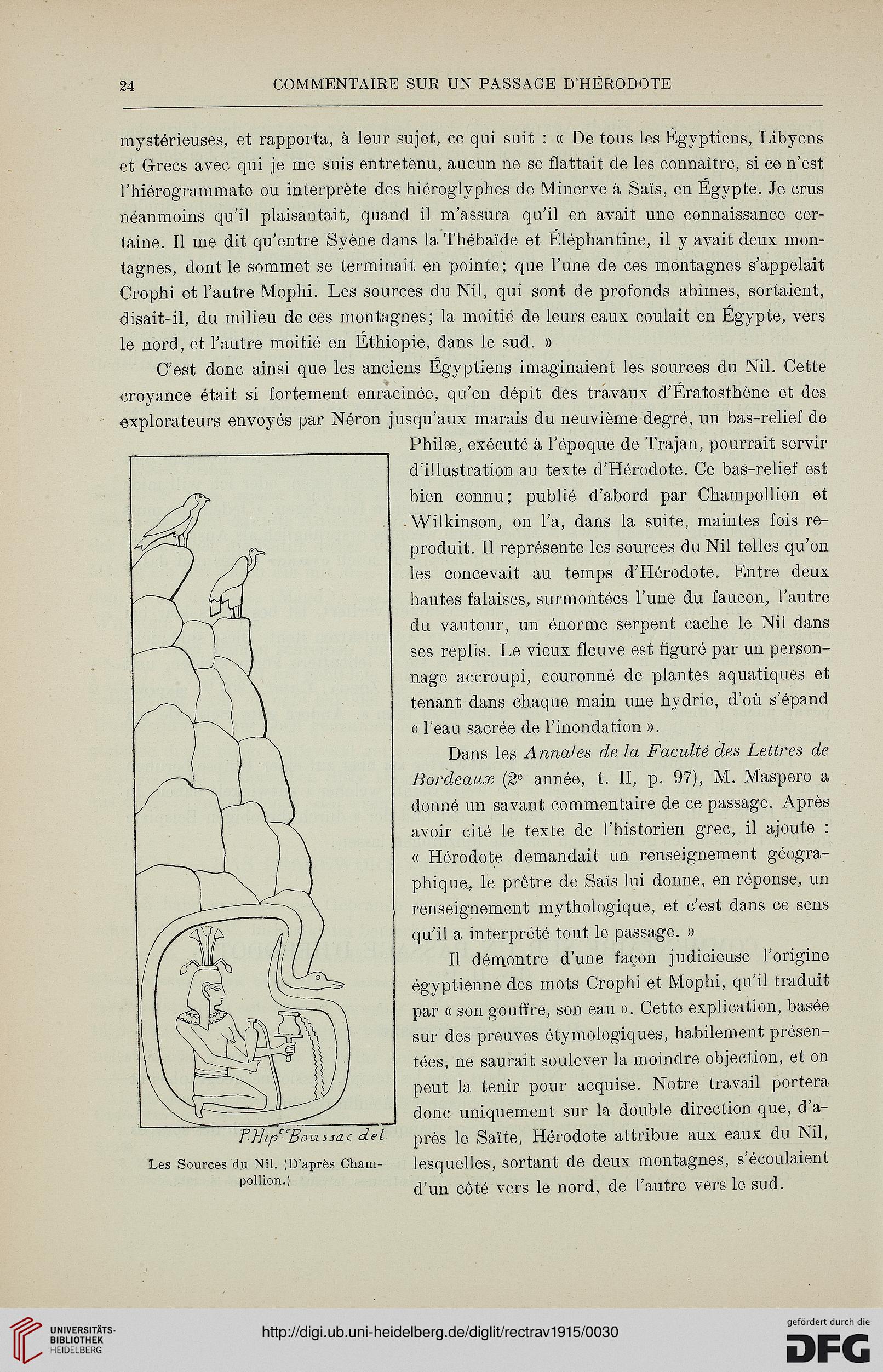24
COMMENTAIRE SUR UN PASSAGE D'HÉRODOTE
mystérieuses, et rapporta, à leur sujet, ce qui suit : « De tous les Égyptiens, Libyens
et Grecs avec qui je me suis entretenu, aucun ne se flattait de les connaître, si ce n'est
l'hiérogrammate ou interprète des hiéroglyphes de Minerve à Sais, en Égypte. Je crus
néanmoins qu'il plaisantait, quand il m'assura qu'il en avait une connaissance cer-
taine. Il me dit qu'entre Syène dans la Thébaïde et Éléphantine, il y avait deux mon-
tagnes, dont le sommet se terminait en pointe; que l'une de ces montagnes s'appelait
Crophi et l'autre Mophi. Les sources du Nil, qui sont de profonds abîmes, sortaient,
disait-il, du milieu de ces montagnes; la moitié de leurs eaux coulait en Égypte, vers
le nord, et l'autre moitié en Éthiopie, dans le sud. »
C'est donc ainsi que les anciens Égyptiens imaginaient les sources du Nil. Cette
croyance était si fortement enracinée, qu'en dépit des travaux d'Ératosthène et des
explorateurs envoyés par Néron jusqu'aux marais du neuvième degré, un bas-relief de
Philse, exécuté à l'époque de Trajan, pourrait servir
d'illustration au texte d'Hérodote. Ce bas-relief est
bien connu; publié d'abord par Champollion et
Wilkinson, on l'a, dans la suite, maintes fois re-
produit. Il représente les sources du Nil telles qu'on
les concevait au temps d'Hérodote. Entre deux
hautes falaises, surmontées l'une du faucon, l'autre
du vautour, un énorme serpent cache le Nil dans
ses replis. Le vieux fleuve est figuré par un person-
nage accroupi, couronné de plantes aquatiques et
tenant dans chaque main une hydrie, d'où s'épand
o l'eau sacrée de l'inondation ».
Dans les A nna/es de la Faculté des Lettres de
Bordeaux (2e année, t. II, p. 97), M. Maspero a
donné un savant commentaire de ce passage. Après
avoir cité le texte de l'historien grec, il ajoute :
« Hérodote demandait un renseignement géogra-
phique, le prêtre de Sais lui donne, en réponse, un
renseignement mythologique, et c'est dans ce sens
qu'il a interprété tout le passage. »
Il démontre d'une façon judicieuse l'origine
égyptienne des mots Crophi et Mophi, qu'il traduit
par « son gouffre, son eau ». Cette explication, basée
sur des preuves étymologiques, habilement présen-
tées, ne saurait soulever la moindre objection, et on
peut la tenir pour acquise. Notre travail portera
donc uniquement sur la double direction que, d'a-
FHjp^Bo-assac del près ]e Saïte, Hérodote attribue aux eaux du Nil,
Les Sources du Nil. (D'après Cham- lesquelles, sortant de deux montagnes, s'écoulaient
polhon') d'un côté vers le nord, de l'autre vers le sud.
COMMENTAIRE SUR UN PASSAGE D'HÉRODOTE
mystérieuses, et rapporta, à leur sujet, ce qui suit : « De tous les Égyptiens, Libyens
et Grecs avec qui je me suis entretenu, aucun ne se flattait de les connaître, si ce n'est
l'hiérogrammate ou interprète des hiéroglyphes de Minerve à Sais, en Égypte. Je crus
néanmoins qu'il plaisantait, quand il m'assura qu'il en avait une connaissance cer-
taine. Il me dit qu'entre Syène dans la Thébaïde et Éléphantine, il y avait deux mon-
tagnes, dont le sommet se terminait en pointe; que l'une de ces montagnes s'appelait
Crophi et l'autre Mophi. Les sources du Nil, qui sont de profonds abîmes, sortaient,
disait-il, du milieu de ces montagnes; la moitié de leurs eaux coulait en Égypte, vers
le nord, et l'autre moitié en Éthiopie, dans le sud. »
C'est donc ainsi que les anciens Égyptiens imaginaient les sources du Nil. Cette
croyance était si fortement enracinée, qu'en dépit des travaux d'Ératosthène et des
explorateurs envoyés par Néron jusqu'aux marais du neuvième degré, un bas-relief de
Philse, exécuté à l'époque de Trajan, pourrait servir
d'illustration au texte d'Hérodote. Ce bas-relief est
bien connu; publié d'abord par Champollion et
Wilkinson, on l'a, dans la suite, maintes fois re-
produit. Il représente les sources du Nil telles qu'on
les concevait au temps d'Hérodote. Entre deux
hautes falaises, surmontées l'une du faucon, l'autre
du vautour, un énorme serpent cache le Nil dans
ses replis. Le vieux fleuve est figuré par un person-
nage accroupi, couronné de plantes aquatiques et
tenant dans chaque main une hydrie, d'où s'épand
o l'eau sacrée de l'inondation ».
Dans les A nna/es de la Faculté des Lettres de
Bordeaux (2e année, t. II, p. 97), M. Maspero a
donné un savant commentaire de ce passage. Après
avoir cité le texte de l'historien grec, il ajoute :
« Hérodote demandait un renseignement géogra-
phique, le prêtre de Sais lui donne, en réponse, un
renseignement mythologique, et c'est dans ce sens
qu'il a interprété tout le passage. »
Il démontre d'une façon judicieuse l'origine
égyptienne des mots Crophi et Mophi, qu'il traduit
par « son gouffre, son eau ». Cette explication, basée
sur des preuves étymologiques, habilement présen-
tées, ne saurait soulever la moindre objection, et on
peut la tenir pour acquise. Notre travail portera
donc uniquement sur la double direction que, d'a-
FHjp^Bo-assac del près ]e Saïte, Hérodote attribue aux eaux du Nil,
Les Sources du Nil. (D'après Cham- lesquelles, sortant de deux montagnes, s'écoulaient
polhon') d'un côté vers le nord, de l'autre vers le sud.