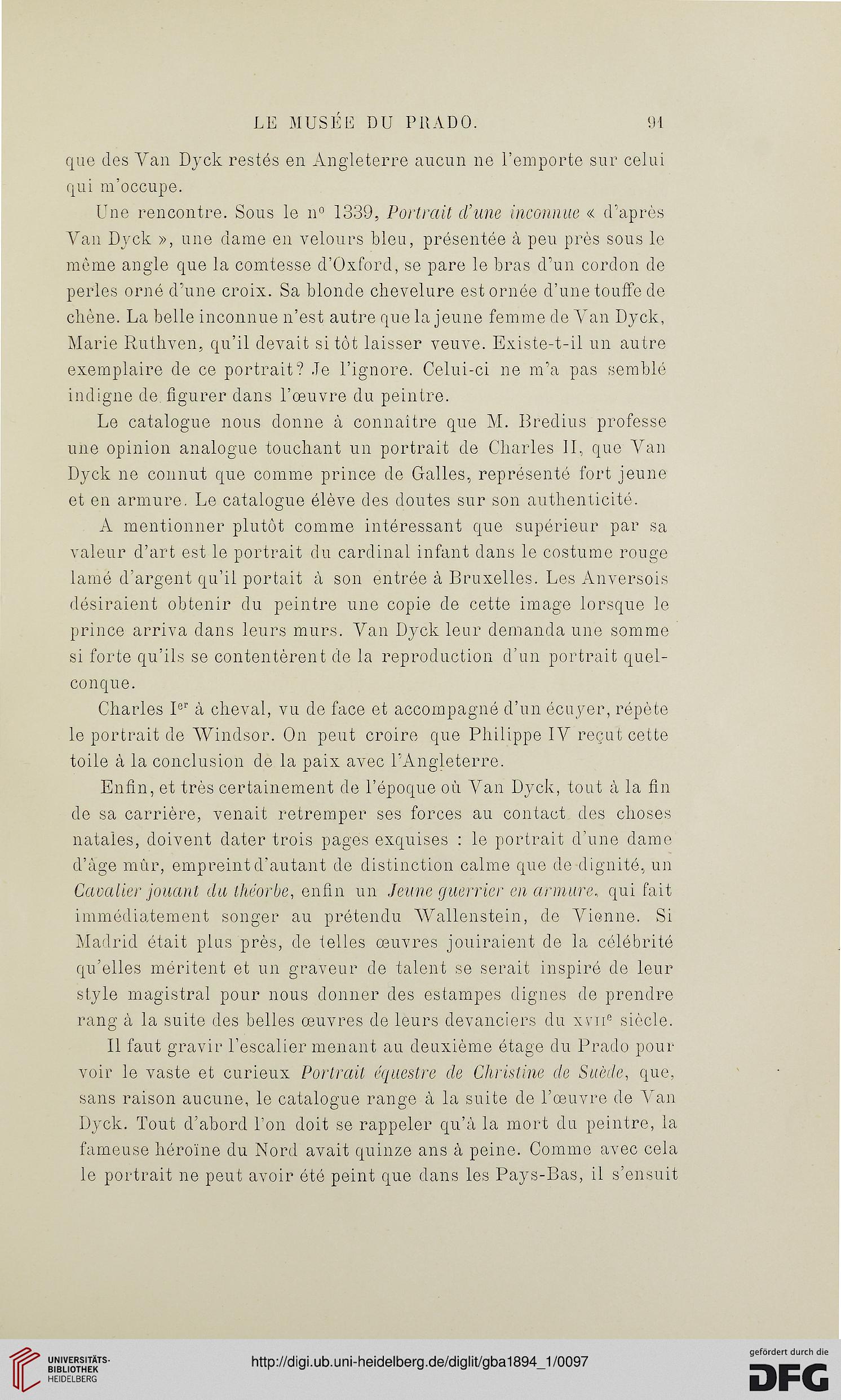LE MUSÉE DU P 11 ADO. 91
que des Van Dyck restés en Angleterre aucun ne l’emporte sur celui
qui m’occupe.
Une rencontre. Sous le n° 1339, Portrait d’une inconnue « d’après
Van Dyck », une dame en velours bleu, présentée à peu près sous le
même angle que la comtesse d’Oxford, se pare le bras d’un cordon de
perles orné d’une croix. Sa blonde chevelure est ornée d’une touffe de
chêne. La belle inconnue n’est autre que la jeune femme de Van Dyck,
Marie Ruthven, qu’il devait si tôt laisser veuve. Existe-t-il un autre
exemplaire de ce portrait? Je l’ignore. Celui-ci ne m’a pas semblé
indigne de figurer dans l’œuvre du peintre.
Le catalogue nous donne à connaître que M. Bredius professe
une opinion analogue touchant un portrait de Charles II, que Van
Dyck ne connut que comme prince de Galles, représenté fort jeune
et en armure. Le catalogue élève des doutes sur son authenticité.
A mentionner plutôt comme intéressant que supérieur par sa
valeur d’art est le portrait du cardinal infant dans le costume rouge
lamé d’argent qu’il portait à son entrée à Bruxelles. Les Anversois
désiraient obtenir du peintre une copie de cette image lorsque le
prince arriva dans leurs murs. Van Dyck leur demanda une somme
si forte qu’ils se contentèrent de la reproduction d’un portrait quel-
conque.
Charles Ier à cheval, vu de face et accompagné d’un écuyer, répète
le portrait de Windsor. On peut croire que Philippe IV reçut cette
toile à la conclusion de la paix avec l’Angleterre.
Enfin, et très certainement de l’époque où Aran Dyck, tout à la fin
de sa carrière, venait retremper ses forces au contact des choses
natales, doivent dater trois pages exquises : le portrait d’une dame
d’âge mûr, empreint d’autant de distinction calme que de dignité, un
Cavalier jouant du théorbe, enfin un Jeune guerrier en armure, qui fait
immédiatement songer au prétendu Wallenstein, de Vienne. Si
Madrid était plus près, de telles œuvres jouiraient de la célébrité
qu’elles méritent et un graveur de talent se serait inspiré de leur
style magistral pour nous donner des estampes dignes de prendre
rang à la suite des belles œuvres de leurs devanciers du xviP siècle.
Il faut gravir l’escalier menant au deuxième étage du Prado pour-
voir le vaste et curieux Portrait équestre de Christine de Suède, que,
sans raison aucune, le catalogue range à la suite de l’œuvre de Van
Dyck. Tout d’abord l’on doit se rappeler qu’à la mort du peintre, la
fameuse héroïne du Nord avait quinze ans à peine. Comme avec cela
le portrait ne peut avoir été peint que dans les Pays-Bas, il s’ensuit
que des Van Dyck restés en Angleterre aucun ne l’emporte sur celui
qui m’occupe.
Une rencontre. Sous le n° 1339, Portrait d’une inconnue « d’après
Van Dyck », une dame en velours bleu, présentée à peu près sous le
même angle que la comtesse d’Oxford, se pare le bras d’un cordon de
perles orné d’une croix. Sa blonde chevelure est ornée d’une touffe de
chêne. La belle inconnue n’est autre que la jeune femme de Van Dyck,
Marie Ruthven, qu’il devait si tôt laisser veuve. Existe-t-il un autre
exemplaire de ce portrait? Je l’ignore. Celui-ci ne m’a pas semblé
indigne de figurer dans l’œuvre du peintre.
Le catalogue nous donne à connaître que M. Bredius professe
une opinion analogue touchant un portrait de Charles II, que Van
Dyck ne connut que comme prince de Galles, représenté fort jeune
et en armure. Le catalogue élève des doutes sur son authenticité.
A mentionner plutôt comme intéressant que supérieur par sa
valeur d’art est le portrait du cardinal infant dans le costume rouge
lamé d’argent qu’il portait à son entrée à Bruxelles. Les Anversois
désiraient obtenir du peintre une copie de cette image lorsque le
prince arriva dans leurs murs. Van Dyck leur demanda une somme
si forte qu’ils se contentèrent de la reproduction d’un portrait quel-
conque.
Charles Ier à cheval, vu de face et accompagné d’un écuyer, répète
le portrait de Windsor. On peut croire que Philippe IV reçut cette
toile à la conclusion de la paix avec l’Angleterre.
Enfin, et très certainement de l’époque où Aran Dyck, tout à la fin
de sa carrière, venait retremper ses forces au contact des choses
natales, doivent dater trois pages exquises : le portrait d’une dame
d’âge mûr, empreint d’autant de distinction calme que de dignité, un
Cavalier jouant du théorbe, enfin un Jeune guerrier en armure, qui fait
immédiatement songer au prétendu Wallenstein, de Vienne. Si
Madrid était plus près, de telles œuvres jouiraient de la célébrité
qu’elles méritent et un graveur de talent se serait inspiré de leur
style magistral pour nous donner des estampes dignes de prendre
rang à la suite des belles œuvres de leurs devanciers du xviP siècle.
Il faut gravir l’escalier menant au deuxième étage du Prado pour-
voir le vaste et curieux Portrait équestre de Christine de Suède, que,
sans raison aucune, le catalogue range à la suite de l’œuvre de Van
Dyck. Tout d’abord l’on doit se rappeler qu’à la mort du peintre, la
fameuse héroïne du Nord avait quinze ans à peine. Comme avec cela
le portrait ne peut avoir été peint que dans les Pays-Bas, il s’ensuit