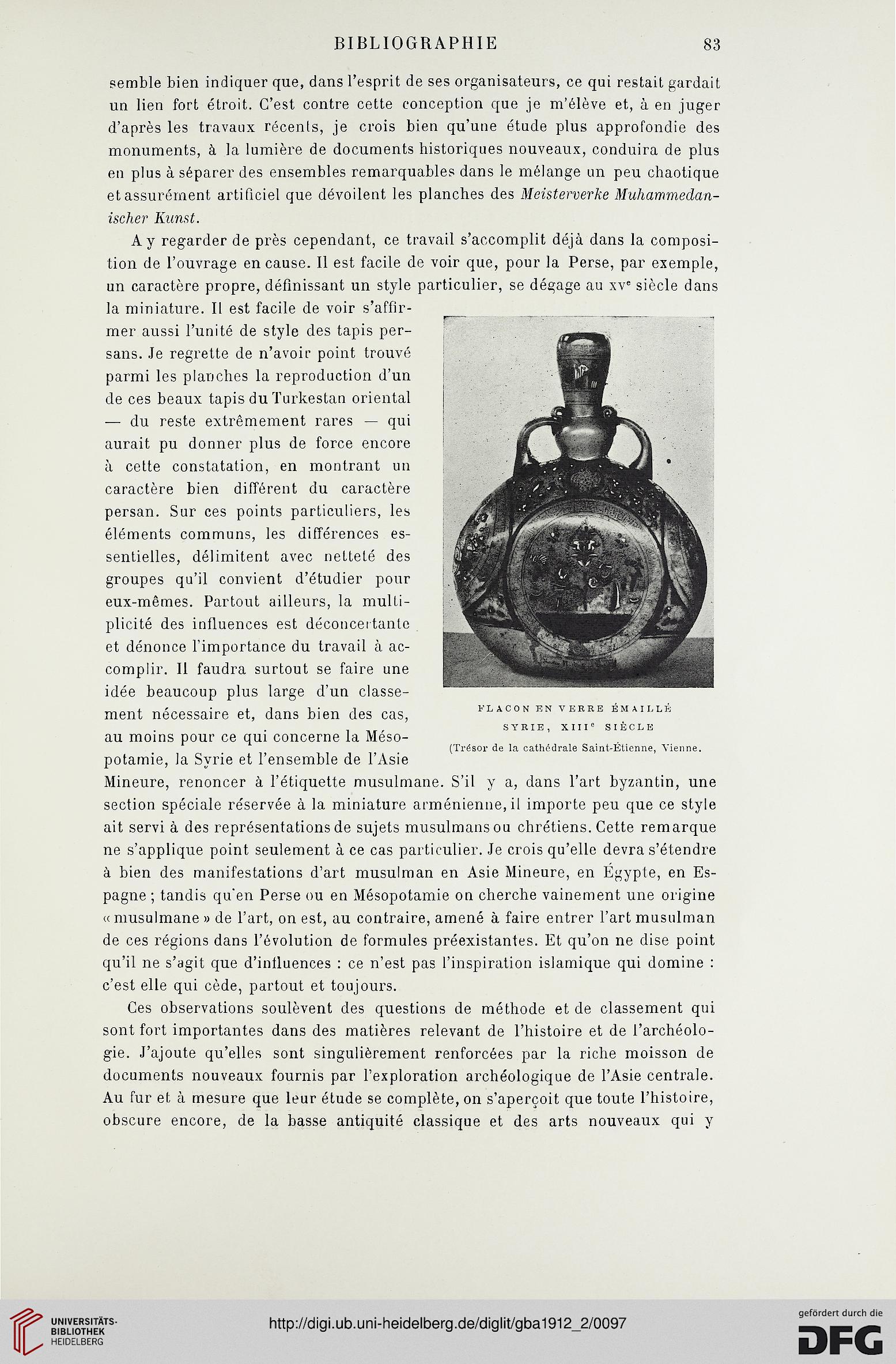BIBLIOGRAPHIE
83
semble bien indiquer que, dans l’esprit de ses organisateurs, ce qui restait gardait
un lien fort étroit. C’est contre cette conception que je m’élève et, à en juger
d’après les travaux récents, je crois bien qu’une étude plus approfondie des
monuments, à la lumière de documents historiques nouveaux, conduira de plus
en plus à séparer des ensembles remarquables dans le mélange un peu chaotique
et assurément artificiel que dévoilent les planches des Meisterverke Muhammedan-
ischer Kunst.
A y regarder de près cependant, ce travail s’accomplit déjà dans la composi-
tion de l’ouvrage en cause. Il est facile de voir que, pour la Perse, par exemple,
un caractère propre, définissant un style particulier, se dégage au xve siècle dans
la miniature. Il est facile de voir s’affir-
mer aussi l’unité de style des tapis per-
sans. Je regrette de n’avoir point trouvé
parmi les planches la reproduction d’un
de ces beaux tapis du Turkestan oriental
— du reste extrêmement rares — qui
aurait pu donner plus de force encore
à cette constatation, en montrant un
caractère bien différent du caractère
persan. Sur ces points particuliers, les
éléments communs, les différences es-
sentielles, délimitent avec netteté des
groupes qu’il convient d’étudier pour
eux-mêmes. Partout ailleurs, la multi-
plicité des influences est déconcertante
et dénonce l'importance du travail à ac-
complir. Il faudra surtout se faire une
idée beaucoup plus large d’un classe-
ment nécessaire et, dans bien des cas,
au moins pour ce qui concerne la Méso-
potamie, la Syrie et l’ensemble de l’Asie
Mineure, renoncer à l’étiquette musulmane. S’il y a, dans l’art byzantin, une
section spéciale réservée à la miniature arménienne, il importe peu que ce style
ait servi à des représentations de sujets musulmans ou chrétiens. Cette remarque
ne s’applique point seulement à ce cas particulier. Je crois qu’elle devra s’étendre
à bien des manifestations d’art musulman en Asie Mineure, en Egypte, en Es-
pagne ; tandis qu’en Perse ou en Mésopotamie on cherche vainement une origine
«musulmane» de l’art, on est, au contraire, amené à faire entrer l’art musulman
de ces régions dans l’évolution de formules préexistantes. Et qu’on ne dise point
qu’il ne s’agit que d’influences : ce n’est pas l’inspiration islamique qui domine :
c’est elle qui cède, partout et toujours.
Ces observations soulèvent des questions de méthode et de classement qui
sont fort importantes dans des matières relevant de l’histoire et de l’archéolo-
gie. J'ajoute qu’elles sont singulièrement renforcées par la riche moisson de
documents nouveaux fournis par l’exploration archéologique de l’Asie centrale.
Au fur et à mesure que leur étude se complète, on s’aperçoit que toute l’histoire,
obscure encore, de la basse antiquité classique et des arts nouveaux qui y
FLACON EN VERRE EMAILLE
SYRIE , XIIIe SIÈCLE
(Trésor de la cathédrale Saint-Étienne, Vienne.
83
semble bien indiquer que, dans l’esprit de ses organisateurs, ce qui restait gardait
un lien fort étroit. C’est contre cette conception que je m’élève et, à en juger
d’après les travaux récents, je crois bien qu’une étude plus approfondie des
monuments, à la lumière de documents historiques nouveaux, conduira de plus
en plus à séparer des ensembles remarquables dans le mélange un peu chaotique
et assurément artificiel que dévoilent les planches des Meisterverke Muhammedan-
ischer Kunst.
A y regarder de près cependant, ce travail s’accomplit déjà dans la composi-
tion de l’ouvrage en cause. Il est facile de voir que, pour la Perse, par exemple,
un caractère propre, définissant un style particulier, se dégage au xve siècle dans
la miniature. Il est facile de voir s’affir-
mer aussi l’unité de style des tapis per-
sans. Je regrette de n’avoir point trouvé
parmi les planches la reproduction d’un
de ces beaux tapis du Turkestan oriental
— du reste extrêmement rares — qui
aurait pu donner plus de force encore
à cette constatation, en montrant un
caractère bien différent du caractère
persan. Sur ces points particuliers, les
éléments communs, les différences es-
sentielles, délimitent avec netteté des
groupes qu’il convient d’étudier pour
eux-mêmes. Partout ailleurs, la multi-
plicité des influences est déconcertante
et dénonce l'importance du travail à ac-
complir. Il faudra surtout se faire une
idée beaucoup plus large d’un classe-
ment nécessaire et, dans bien des cas,
au moins pour ce qui concerne la Méso-
potamie, la Syrie et l’ensemble de l’Asie
Mineure, renoncer à l’étiquette musulmane. S’il y a, dans l’art byzantin, une
section spéciale réservée à la miniature arménienne, il importe peu que ce style
ait servi à des représentations de sujets musulmans ou chrétiens. Cette remarque
ne s’applique point seulement à ce cas particulier. Je crois qu’elle devra s’étendre
à bien des manifestations d’art musulman en Asie Mineure, en Egypte, en Es-
pagne ; tandis qu’en Perse ou en Mésopotamie on cherche vainement une origine
«musulmane» de l’art, on est, au contraire, amené à faire entrer l’art musulman
de ces régions dans l’évolution de formules préexistantes. Et qu’on ne dise point
qu’il ne s’agit que d’influences : ce n’est pas l’inspiration islamique qui domine :
c’est elle qui cède, partout et toujours.
Ces observations soulèvent des questions de méthode et de classement qui
sont fort importantes dans des matières relevant de l’histoire et de l’archéolo-
gie. J'ajoute qu’elles sont singulièrement renforcées par la riche moisson de
documents nouveaux fournis par l’exploration archéologique de l’Asie centrale.
Au fur et à mesure que leur étude se complète, on s’aperçoit que toute l’histoire,
obscure encore, de la basse antiquité classique et des arts nouveaux qui y
FLACON EN VERRE EMAILLE
SYRIE , XIIIe SIÈCLE
(Trésor de la cathédrale Saint-Étienne, Vienne.