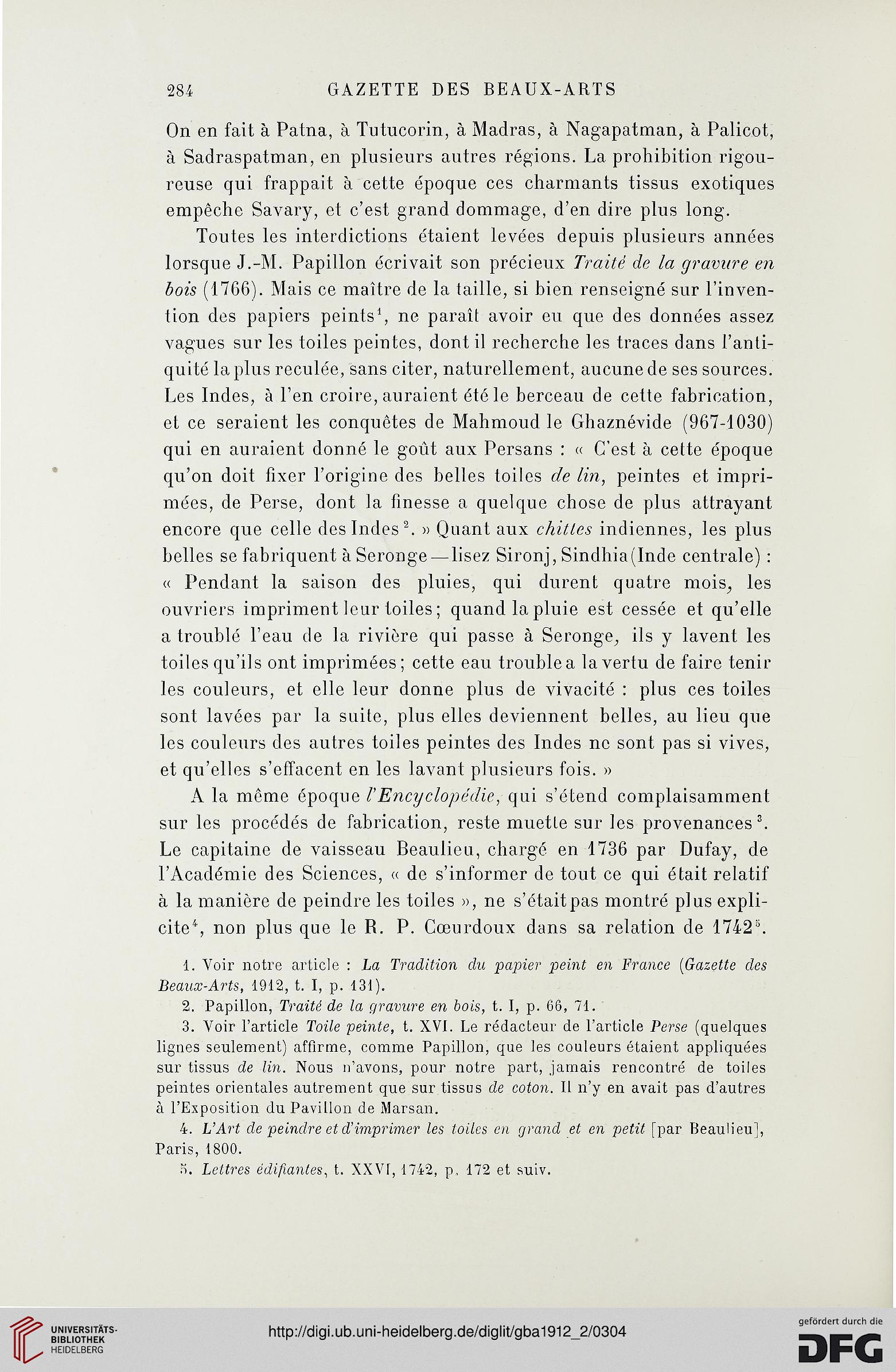28-4
GAZETTE DES BEAUX-ARTS
On en fait à Patna, à Tutucorin, à Madras, à Nagapatman, à Palicot,
à Sadraspatman, en plusieurs autres régions. La prohibition rigou-
reuse qui frappait à cette époque ces charmants tissus exotiques
empêche Savary, et c’est grand dommage, d’en dire plus long.
Toutes les interdictions étaient levées depuis plusieurs années
lorsque J.-M. Papillon écrivait son précieux Traité de la gravure en
bois (1766). Mais ce maître de la taille, si bien renseigné sur l’inven-
tion des papiers peints1, ne paraît avoir eu que des données assez
vagues sur les toiles peintes, dont il recherche les traces dans l’anti-
quité la plus reculée, sans citer, naturellement, aucune de ses sources.
Les Indes, à l’en croire, auraient été le berceau de cette fabrication,
et ce seraient les conquêtes de Mahmoud le Ghaznévide (967-1030)
qui en auraient donné le goût aux Persans : « C’est à cette époque
qu’on doit fixer l’origine des belles toiles de lin, peintes et impri-
mées, de Perse, dont la finesse a quelque chose de plus attrayant
encore que celle des Indes2. » Quant aux chittes indiennes, les plus
belles se fabriquent à Seronge — lisez Sironj, Sindhia(Inde centrale) :
« Pendant la saison des pluies, qui durent quatre mois, les
ouvriers impriment leur toiles ; quand la pluie est cessée et qu’elle
a troublé l’eau de la rivière qui passe à Seronge, ils y lavent les
toiles qu’ils ont imprimées; cette eau trouble a la vertu de faire tenir
les couleurs, et elle leur donne plus de vivacité : plus ces toiles
sont lavées par la suite, plus elles deviennent belles, au lieu que
les couleurs des autres toiles peintes des Indes ne sont pas si vives,
et qu’elles s’effacent en les lavant plusieurs fois. »
A la même époque /’Encyclopédie, qui s’étend complaisamment
sur les procédés de fabrication, reste muette sur les provenances3.
Le capitaine de vaisseau Beaulieu, chargé en 1736 par Dufay, de
l’Académie des Sciences, « de s’informer de tout ce qui était relatif
à la manière de peindre les toiles », ne s’était pas montré plus expli-
cite4, non plus que le R. P. Cœurdoux dans sa relation de 17423.
1. Voir notre article : La Tradition du papier peint en France (Gazette des
Beaux-Arts, 1912, t. I, p. 131).
2. Papillon, Traité de la gravure en bois, t. I, p. 66, 71.
3. Voir l’article Toile peinte, t. XVI. Le rédacteur de l’article Perse (quelques
lignes seulement) affirme, comme Papillon, que les couleurs étaient appliquées
sur tissus de lin. Nous n’avons, pour notre part, jamais rencontré de toiles
peintes orientales autrement que sur tissus de coton. Il n’y en avait pas d’autres
à l’Exposition du Pavillon de Marsan.
4. L’Art de peindre et d’imprimer les toiles en grand et en petit [par Beaulieu],
Paris, 1800.
n. Lettres édifiantes, t. XXVI, 1742, p, 172 et suiv.
GAZETTE DES BEAUX-ARTS
On en fait à Patna, à Tutucorin, à Madras, à Nagapatman, à Palicot,
à Sadraspatman, en plusieurs autres régions. La prohibition rigou-
reuse qui frappait à cette époque ces charmants tissus exotiques
empêche Savary, et c’est grand dommage, d’en dire plus long.
Toutes les interdictions étaient levées depuis plusieurs années
lorsque J.-M. Papillon écrivait son précieux Traité de la gravure en
bois (1766). Mais ce maître de la taille, si bien renseigné sur l’inven-
tion des papiers peints1, ne paraît avoir eu que des données assez
vagues sur les toiles peintes, dont il recherche les traces dans l’anti-
quité la plus reculée, sans citer, naturellement, aucune de ses sources.
Les Indes, à l’en croire, auraient été le berceau de cette fabrication,
et ce seraient les conquêtes de Mahmoud le Ghaznévide (967-1030)
qui en auraient donné le goût aux Persans : « C’est à cette époque
qu’on doit fixer l’origine des belles toiles de lin, peintes et impri-
mées, de Perse, dont la finesse a quelque chose de plus attrayant
encore que celle des Indes2. » Quant aux chittes indiennes, les plus
belles se fabriquent à Seronge — lisez Sironj, Sindhia(Inde centrale) :
« Pendant la saison des pluies, qui durent quatre mois, les
ouvriers impriment leur toiles ; quand la pluie est cessée et qu’elle
a troublé l’eau de la rivière qui passe à Seronge, ils y lavent les
toiles qu’ils ont imprimées; cette eau trouble a la vertu de faire tenir
les couleurs, et elle leur donne plus de vivacité : plus ces toiles
sont lavées par la suite, plus elles deviennent belles, au lieu que
les couleurs des autres toiles peintes des Indes ne sont pas si vives,
et qu’elles s’effacent en les lavant plusieurs fois. »
A la même époque /’Encyclopédie, qui s’étend complaisamment
sur les procédés de fabrication, reste muette sur les provenances3.
Le capitaine de vaisseau Beaulieu, chargé en 1736 par Dufay, de
l’Académie des Sciences, « de s’informer de tout ce qui était relatif
à la manière de peindre les toiles », ne s’était pas montré plus expli-
cite4, non plus que le R. P. Cœurdoux dans sa relation de 17423.
1. Voir notre article : La Tradition du papier peint en France (Gazette des
Beaux-Arts, 1912, t. I, p. 131).
2. Papillon, Traité de la gravure en bois, t. I, p. 66, 71.
3. Voir l’article Toile peinte, t. XVI. Le rédacteur de l’article Perse (quelques
lignes seulement) affirme, comme Papillon, que les couleurs étaient appliquées
sur tissus de lin. Nous n’avons, pour notre part, jamais rencontré de toiles
peintes orientales autrement que sur tissus de coton. Il n’y en avait pas d’autres
à l’Exposition du Pavillon de Marsan.
4. L’Art de peindre et d’imprimer les toiles en grand et en petit [par Beaulieu],
Paris, 1800.
n. Lettres édifiantes, t. XXVI, 1742, p, 172 et suiv.