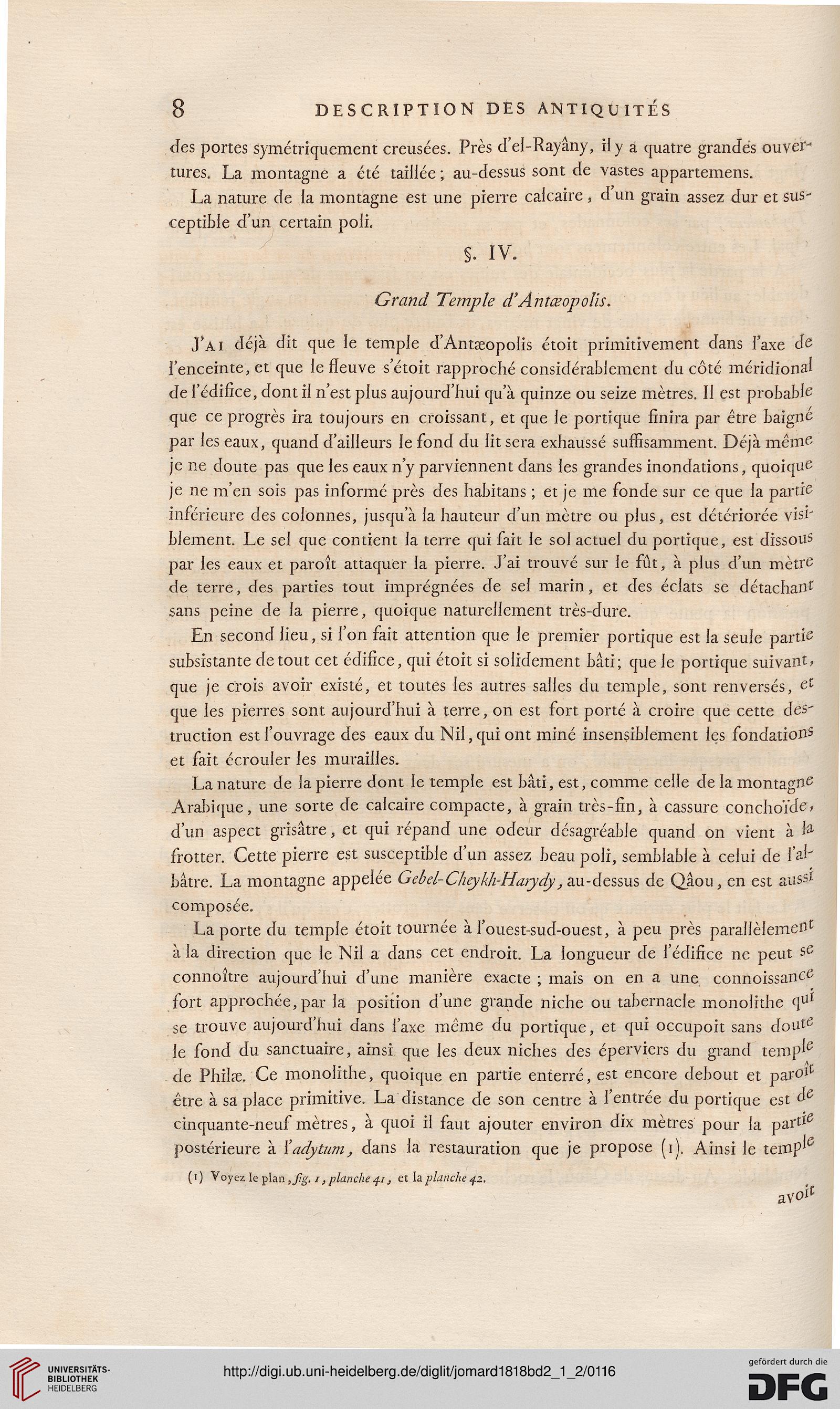8
DESCRIPTION DES ANTIQUITES
des portes symétriquement creusées. Près d'el-Rayâny, il y a quatre grandes ouver-
tures. La montagne a été taillée ; au-dessus sont de vastes appartenons.
La nature de la montagne est une pierre calcaire , d un grain assez dur et sus-
ceptible d'un certain poli.
§. IV.
Grand Temple d'Antœopolis.
J'ai déjà dit que le temple d'Antseopolis étoit primitivement dans l'axe de
l'enceinte, et que le fleuve s'étoit rapproché considérablement du côté méridional
de l'édifice, dont il n'est plus aujourd'hui qu'à quinze ou seize mètres. Il est probable
que ce progrès ira toujours en croissant, et que le portique finira par être baigne
par les eaux, quand d'ailleurs le fond du lit sera exhaussé suffisamment. Déjà même
je ne doute pas que les eaux n'y parviennent dans les grandes inondations, quoique
je ne m'en sois pas informé près des habitans ; et je me fonde sur ce que la partie
inférieure des colonnes, jusqu'à la hauteur d'un mètre ou plus, est détériorée visi-
blement. Le sel que contient la terre qui fait le sol actuel du portique, est dissous
par les eaux et paroît attaquer la pierre. J'ai trouvé sur le fût, à plus d'un mètre
de terre, des parties tout imprégnées de sel marin, et des éclats se détachant
sans peine de la pierre, quoique naturellement très-dure.
En second lieu, si l'on fait attention que le premier portique est la seule partie
subsistante de tout cet édifice, qui étoit si solidement bâti; que le portique suivant,
que je crois avoir existé, et toutes les autres salles du temple, sont renversés, et
que les pierres sont aujourd'hui à terre, on est fort porté à croire que cette des-
truction est l'ouvrage des eaux du Nil, qui ont miné insensiblement les fondations
et fait écrouler les murailles.
La nature de la pierre dont le temple est bâti, est, comme celle de la montagne
Arabique, une sorte de calcaire compacte, à grain très-fin, à cassure conchoïde,
d'un aspect grisâtre, et qui répand une odeur désagréable quand on vient à la
frotter. Cette pierre est susceptible d'un assez beau poli, semblable à celui de l'al-
bâtre. La montagne appelée Gebel-Cheykh-Harydy, au-dessus de Qâou, en est aussi
composée.
La porte du temple étoit tournée à l'ouest-sud-ouest, à peu près parallèlement
à la direction que le Nil a dans cet endroit. La longueur de l'édifice ne peut se
connoître aujourd'hui d'une manière exacte ; mais on en a une connoissance
fort approchée, par la position d'une grande niche ou tabernacle monolithe quI
se trouve aujourd'hui dans l'axe même du portique, et qui occupoit sans doute
le fond du sanctuaire, ainsi que les deux niches des éperviers du grand temp^
de Philœ. Ce monolithe, quoique en partie enterré, est encore debout et paroi1
être à sa place primitive. La distance de son centre à l'entrée du portique est â°
cinquante-neuf mètres, à quoi il faut ajouter environ dix mètres pour la parti6
postérieure à Xadytum, dans la restauration que je propose (i). Ainsi le temp^
( i ) Voyez le plan ,fg, i, planche 41, et la flanche ^2.
DESCRIPTION DES ANTIQUITES
des portes symétriquement creusées. Près d'el-Rayâny, il y a quatre grandes ouver-
tures. La montagne a été taillée ; au-dessus sont de vastes appartenons.
La nature de la montagne est une pierre calcaire , d un grain assez dur et sus-
ceptible d'un certain poli.
§. IV.
Grand Temple d'Antœopolis.
J'ai déjà dit que le temple d'Antseopolis étoit primitivement dans l'axe de
l'enceinte, et que le fleuve s'étoit rapproché considérablement du côté méridional
de l'édifice, dont il n'est plus aujourd'hui qu'à quinze ou seize mètres. Il est probable
que ce progrès ira toujours en croissant, et que le portique finira par être baigne
par les eaux, quand d'ailleurs le fond du lit sera exhaussé suffisamment. Déjà même
je ne doute pas que les eaux n'y parviennent dans les grandes inondations, quoique
je ne m'en sois pas informé près des habitans ; et je me fonde sur ce que la partie
inférieure des colonnes, jusqu'à la hauteur d'un mètre ou plus, est détériorée visi-
blement. Le sel que contient la terre qui fait le sol actuel du portique, est dissous
par les eaux et paroît attaquer la pierre. J'ai trouvé sur le fût, à plus d'un mètre
de terre, des parties tout imprégnées de sel marin, et des éclats se détachant
sans peine de la pierre, quoique naturellement très-dure.
En second lieu, si l'on fait attention que le premier portique est la seule partie
subsistante de tout cet édifice, qui étoit si solidement bâti; que le portique suivant,
que je crois avoir existé, et toutes les autres salles du temple, sont renversés, et
que les pierres sont aujourd'hui à terre, on est fort porté à croire que cette des-
truction est l'ouvrage des eaux du Nil, qui ont miné insensiblement les fondations
et fait écrouler les murailles.
La nature de la pierre dont le temple est bâti, est, comme celle de la montagne
Arabique, une sorte de calcaire compacte, à grain très-fin, à cassure conchoïde,
d'un aspect grisâtre, et qui répand une odeur désagréable quand on vient à la
frotter. Cette pierre est susceptible d'un assez beau poli, semblable à celui de l'al-
bâtre. La montagne appelée Gebel-Cheykh-Harydy, au-dessus de Qâou, en est aussi
composée.
La porte du temple étoit tournée à l'ouest-sud-ouest, à peu près parallèlement
à la direction que le Nil a dans cet endroit. La longueur de l'édifice ne peut se
connoître aujourd'hui d'une manière exacte ; mais on en a une connoissance
fort approchée, par la position d'une grande niche ou tabernacle monolithe quI
se trouve aujourd'hui dans l'axe même du portique, et qui occupoit sans doute
le fond du sanctuaire, ainsi que les deux niches des éperviers du grand temp^
de Philœ. Ce monolithe, quoique en partie enterré, est encore debout et paroi1
être à sa place primitive. La distance de son centre à l'entrée du portique est â°
cinquante-neuf mètres, à quoi il faut ajouter environ dix mètres pour la parti6
postérieure à Xadytum, dans la restauration que je propose (i). Ainsi le temp^
( i ) Voyez le plan ,fg, i, planche 41, et la flanche ^2.