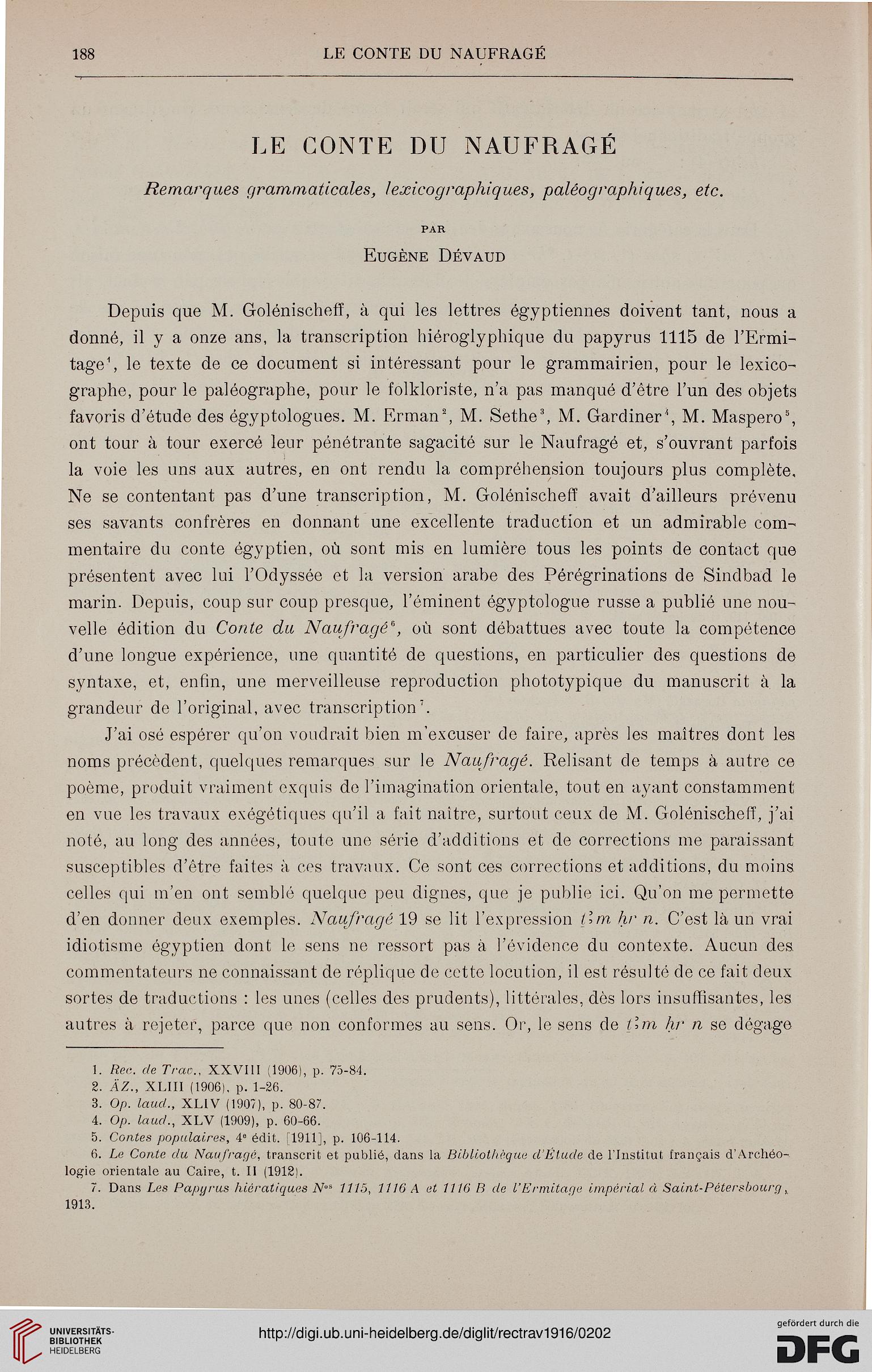188
LE CONTE DU NAUFRAGE
LE CONTE DU NAUFRAGÉ
Remarques grammaticales, lexicographiques, paléographiques, etc.
PAR
Eugène Dévaud
Depuis que M. Golénischefï, à qui les lettres égyptiennes doivent tant, nous a
donné, il y a onze ans, la transcription hiéroglyphique du papyrus 1115 de l'Ermi-
tage1, le texte de ce document si intéressant pour le grammairien, pour le lexico-
graphe, pour le paléographe, pour le folkloriste, n'a pas manqué d'être l'un des objets
favoris d'étude des égyptologues. M. Erman2, M. Sethe3, M. Gardiner1, M. Maspero5,
ont tour à tour exercé leur pénétrante sagacité sur le Naufragé et, s'ouvrant parfois
la voie les uns aux autres, en ont rendu la compréhension toujours plus complète.
Ne se contentant pas d'une transcription, M. Golénischefï avait d'ailleurs prévenu
ses savants confrères en donnant une excellente traduction et un admirable com-
mentaire du conte égyptien, où sont mis en lumière tous les points de contact que
présentent avec lui l'Odyssée et la version arabe des Pérégrinations de Sindbad le
marin. Depuis, coup sur coup presque, l'éminent égyptologue russe a publié une nou-
velle édition du Conte du Naufragé'', où sont débattues avec toute la compétence
d'une longue expérience, une quantité de questions, en particulier des questions de
syntaxe, et, enfin, une merveilleuse reproduction phototypique du manuscrit à la
grandeur de l'original, avec transcription7.
J'ai osé espérer qu'on voudrait bien m'excuser de faire, après les maîtres dont les
noms précèdent, quelques remarques sur le Naufragé. Relisant de temps à autre ce
poème, produit vraiment exquis de l'imagination orientale, tout en ayant constamment
en vue les travaux exégétiques qu'il a fait naître, surtout ceux de M. Golénischefï, j'ai
noté, au long des années, toute une série d'additions et de corrections me paraissant
susceptibles d'être faites à ces travaux. Ce sont ces corrections et additions, du moins
celles qui m'en ont semblé quelque peu dignes, que je publie ici. Qu'on me permette
d'en donner deux exemples. Naufragé 19 se lit l'expression tlm hr n. C'est là un vrai
idiotisme égyptien dont le sens ne ressort pas à l'évidence du contexte. Aucun des
commentateurs ne connaissant de réplique de cette locution, il est résulté de ce fait deux
sortes de traductions : les unes (celles des prudents), littérales, dès lors insuffisantes, les
autres à rejeter, parce que non conformes au sens. Or, le sens de tlm hr n se dégage
1. Rec. de Trac, XXVIII (1906), p. 75-84.
2. ÀZ., XLIII (1906|. p. 1-26.
3. Op. laucl., XLIV (1907), p. 80-87.
4. Op. laucl., XLV (1909), p. 60-66.
5. Contes populaires, 4e édit. [1911], p. 106-114.
6. Le Conte du Naufragé, transcrit et publié, dans la Bibliothèque d'Étude de l'Institut français d'Archéo-
logie orientale au Caire, t. Il (1912).
7. Dans Les Papyrus hiératiques N0% 1115, 1116 A et 1116 B de l'Ermitage impérial à Saint-Pétersbourg ,
1913.
LE CONTE DU NAUFRAGE
LE CONTE DU NAUFRAGÉ
Remarques grammaticales, lexicographiques, paléographiques, etc.
PAR
Eugène Dévaud
Depuis que M. Golénischefï, à qui les lettres égyptiennes doivent tant, nous a
donné, il y a onze ans, la transcription hiéroglyphique du papyrus 1115 de l'Ermi-
tage1, le texte de ce document si intéressant pour le grammairien, pour le lexico-
graphe, pour le paléographe, pour le folkloriste, n'a pas manqué d'être l'un des objets
favoris d'étude des égyptologues. M. Erman2, M. Sethe3, M. Gardiner1, M. Maspero5,
ont tour à tour exercé leur pénétrante sagacité sur le Naufragé et, s'ouvrant parfois
la voie les uns aux autres, en ont rendu la compréhension toujours plus complète.
Ne se contentant pas d'une transcription, M. Golénischefï avait d'ailleurs prévenu
ses savants confrères en donnant une excellente traduction et un admirable com-
mentaire du conte égyptien, où sont mis en lumière tous les points de contact que
présentent avec lui l'Odyssée et la version arabe des Pérégrinations de Sindbad le
marin. Depuis, coup sur coup presque, l'éminent égyptologue russe a publié une nou-
velle édition du Conte du Naufragé'', où sont débattues avec toute la compétence
d'une longue expérience, une quantité de questions, en particulier des questions de
syntaxe, et, enfin, une merveilleuse reproduction phototypique du manuscrit à la
grandeur de l'original, avec transcription7.
J'ai osé espérer qu'on voudrait bien m'excuser de faire, après les maîtres dont les
noms précèdent, quelques remarques sur le Naufragé. Relisant de temps à autre ce
poème, produit vraiment exquis de l'imagination orientale, tout en ayant constamment
en vue les travaux exégétiques qu'il a fait naître, surtout ceux de M. Golénischefï, j'ai
noté, au long des années, toute une série d'additions et de corrections me paraissant
susceptibles d'être faites à ces travaux. Ce sont ces corrections et additions, du moins
celles qui m'en ont semblé quelque peu dignes, que je publie ici. Qu'on me permette
d'en donner deux exemples. Naufragé 19 se lit l'expression tlm hr n. C'est là un vrai
idiotisme égyptien dont le sens ne ressort pas à l'évidence du contexte. Aucun des
commentateurs ne connaissant de réplique de cette locution, il est résulté de ce fait deux
sortes de traductions : les unes (celles des prudents), littérales, dès lors insuffisantes, les
autres à rejeter, parce que non conformes au sens. Or, le sens de tlm hr n se dégage
1. Rec. de Trac, XXVIII (1906), p. 75-84.
2. ÀZ., XLIII (1906|. p. 1-26.
3. Op. laucl., XLIV (1907), p. 80-87.
4. Op. laucl., XLV (1909), p. 60-66.
5. Contes populaires, 4e édit. [1911], p. 106-114.
6. Le Conte du Naufragé, transcrit et publié, dans la Bibliothèque d'Étude de l'Institut français d'Archéo-
logie orientale au Caire, t. Il (1912).
7. Dans Les Papyrus hiératiques N0% 1115, 1116 A et 1116 B de l'Ermitage impérial à Saint-Pétersbourg ,
1913.