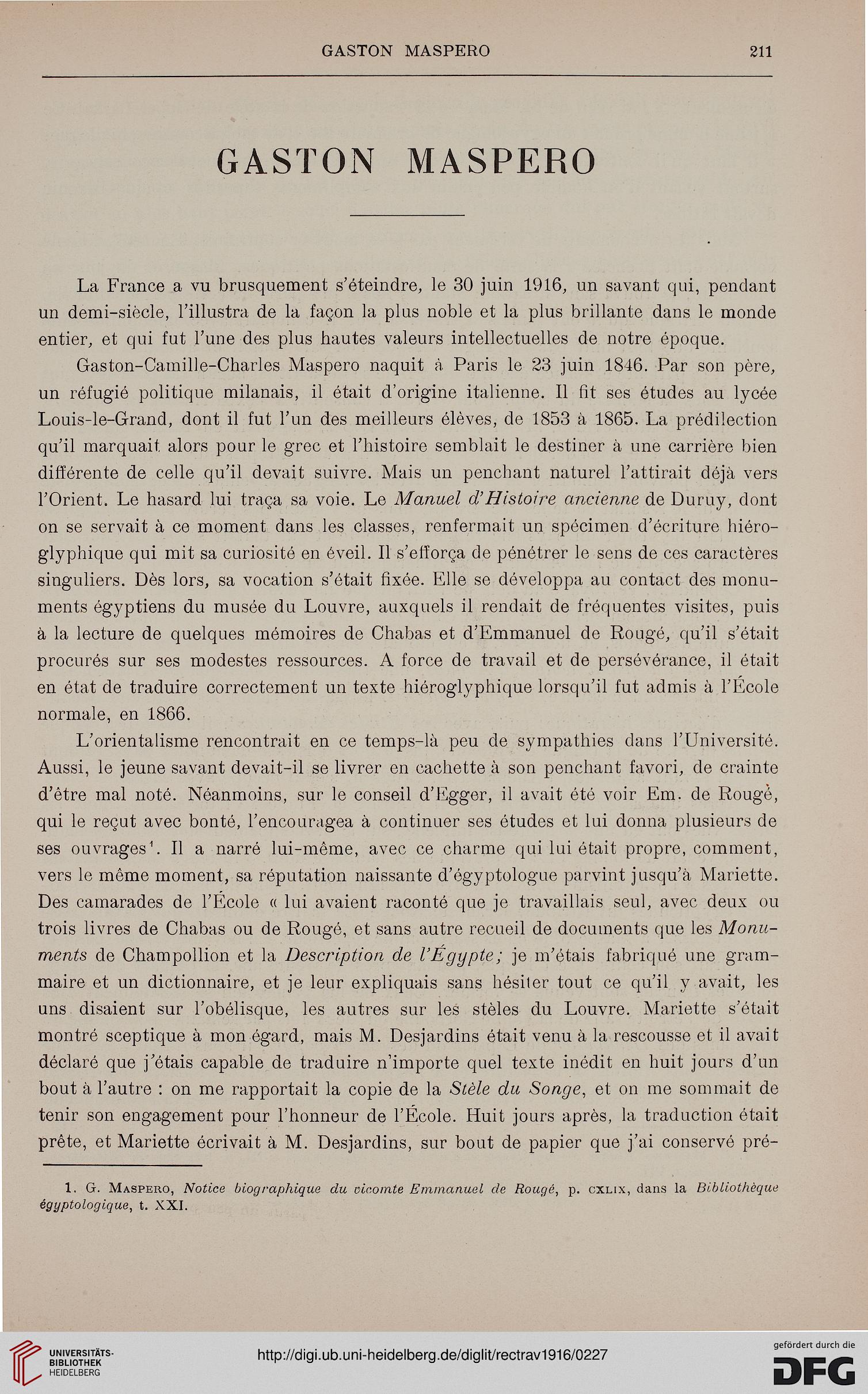GASTON MASPERO
211
GASTON MASPERO
La France a vu brusquement s'éteindre, le 30 juin 1916, un savant qui, pendant
un demi-siècle, l'illustra de la façon la plus noble et la plus brillante dans le monde
entier, et qui fut l'une des plus hautes valeurs intellectuelles de notre époque.
Gaston-Camille-Charles Maspero naquit à Paris le 23 juin 1846. Par son père,
un réfugié politique milanais, il était d'origine italienne. Il fit ses études au lycée
Louis-le-Grand, dont il fut l'un des meilleurs élèves, de 1853 à 1865. La prédilection
qu'il marquait, alors pour le grec et l'histoire semblait le destiner à une carrière bien
différente de celle qu'il devait suivre. Mais un penchant naturel l'attirait déjà vers
l'Orient. Le hasard lui traça sa voie. Le Manuel d'Histoire ancienne de Duruy, dont
on se servait à ce moment dans les classes, renfermait un spécimen d'écriture hiéro-
glyphique qui mit sa curiosité en éveil. Il s'efforça de pénétrer le sens de ces caractères
singuliers. Dès lors, sa vocation s'était fixée. Elle se développa au contact des monu-
ments égyptiens du musée du Louvre, auxquels il rendait de fréquentes visites, puis
à la lecture de quelques mémoires de Chabas et d'Emmanuel de Rongé, qu'il s'était
procurés sur ses modestes ressources. A force de travail et de persévérance, il était
en état de traduire correctement un texte hiéroglyphique lorsqu'il fut admis à l'École
normale, en 1866.
L'orientalisme rencontrait en ce temps-là peu de sympathies dans l'Université.
Aussi, le jeune savant devait-il se livrer en cachette à son penchant favori, de crainte
d'être mal noté. Néanmoins, sur le conseil d'Egger, il avait été voir Em. de Rougé,
qui le reçut avec bonté, l'encouragea à continuer ses études et lui donna plusieurs de
ses ouvrages1. Il a narré lui-même, avec ce charme qui lui était propre, comment,
vers le même moment, sa réputation naissante d'égyptologue parvint jusqu'à Mariette.
Des camarades de l'École « lui avaient raconté que je travaillais seul, avec deux ou
trois livres de Chabas ou de Rougé, et sans autre recueil de documents que les Monu-
ments de Champollion et la Description de l'Egypte; je m'étais fabriqué une gram-
maire et un dictionnaire, et je leur expliquais sans hésiter tout ce qu'il y avait, les
uns disaient sur l'obélisque, les autres sur les stèles du Louvre. Mariette s'était
montré sceptique à mon égard, mais M. Desjardins était venu à la rescousse et il avait
déclaré que j'étais capable de traduire n'importe quel texte inédit en huit jours d'un
bout à l'autre : on me rapportait la copie de la Stèle du Songe, et on me sommait de
tenir son engagement pour l'honneur de l'École. Huit jours après, la traduction était
prête, et Mariette écrivait à M. Desjardins, sur bout de papier que j'ai conservé pré-
1. G. Maspero, Notice biographique du vicomte Emmanuel de Rougé, p. cxlix, dans la Bibliothèque
égyptologique, t. XXI.
211
GASTON MASPERO
La France a vu brusquement s'éteindre, le 30 juin 1916, un savant qui, pendant
un demi-siècle, l'illustra de la façon la plus noble et la plus brillante dans le monde
entier, et qui fut l'une des plus hautes valeurs intellectuelles de notre époque.
Gaston-Camille-Charles Maspero naquit à Paris le 23 juin 1846. Par son père,
un réfugié politique milanais, il était d'origine italienne. Il fit ses études au lycée
Louis-le-Grand, dont il fut l'un des meilleurs élèves, de 1853 à 1865. La prédilection
qu'il marquait, alors pour le grec et l'histoire semblait le destiner à une carrière bien
différente de celle qu'il devait suivre. Mais un penchant naturel l'attirait déjà vers
l'Orient. Le hasard lui traça sa voie. Le Manuel d'Histoire ancienne de Duruy, dont
on se servait à ce moment dans les classes, renfermait un spécimen d'écriture hiéro-
glyphique qui mit sa curiosité en éveil. Il s'efforça de pénétrer le sens de ces caractères
singuliers. Dès lors, sa vocation s'était fixée. Elle se développa au contact des monu-
ments égyptiens du musée du Louvre, auxquels il rendait de fréquentes visites, puis
à la lecture de quelques mémoires de Chabas et d'Emmanuel de Rongé, qu'il s'était
procurés sur ses modestes ressources. A force de travail et de persévérance, il était
en état de traduire correctement un texte hiéroglyphique lorsqu'il fut admis à l'École
normale, en 1866.
L'orientalisme rencontrait en ce temps-là peu de sympathies dans l'Université.
Aussi, le jeune savant devait-il se livrer en cachette à son penchant favori, de crainte
d'être mal noté. Néanmoins, sur le conseil d'Egger, il avait été voir Em. de Rougé,
qui le reçut avec bonté, l'encouragea à continuer ses études et lui donna plusieurs de
ses ouvrages1. Il a narré lui-même, avec ce charme qui lui était propre, comment,
vers le même moment, sa réputation naissante d'égyptologue parvint jusqu'à Mariette.
Des camarades de l'École « lui avaient raconté que je travaillais seul, avec deux ou
trois livres de Chabas ou de Rougé, et sans autre recueil de documents que les Monu-
ments de Champollion et la Description de l'Egypte; je m'étais fabriqué une gram-
maire et un dictionnaire, et je leur expliquais sans hésiter tout ce qu'il y avait, les
uns disaient sur l'obélisque, les autres sur les stèles du Louvre. Mariette s'était
montré sceptique à mon égard, mais M. Desjardins était venu à la rescousse et il avait
déclaré que j'étais capable de traduire n'importe quel texte inédit en huit jours d'un
bout à l'autre : on me rapportait la copie de la Stèle du Songe, et on me sommait de
tenir son engagement pour l'honneur de l'École. Huit jours après, la traduction était
prête, et Mariette écrivait à M. Desjardins, sur bout de papier que j'ai conservé pré-
1. G. Maspero, Notice biographique du vicomte Emmanuel de Rougé, p. cxlix, dans la Bibliothèque
égyptologique, t. XXI.