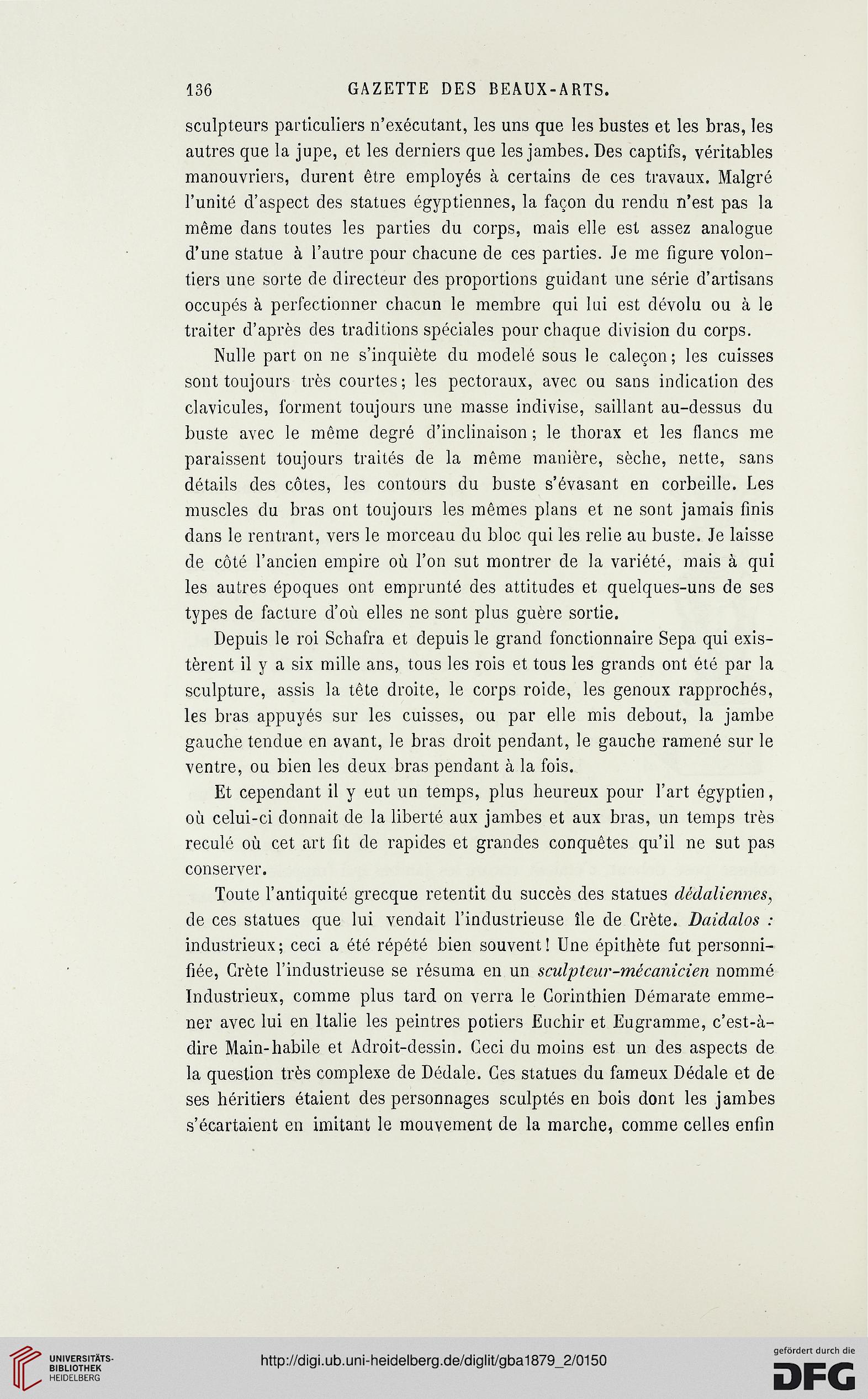136
GAZETTE DES BEAUX-ARTS.
sculpteurs particuliers n'exécutant, les uns que les bustes et les bras, les
autres que la jupe, et les derniers que les jambes. Des captifs, véritables
manouvriers, durent être employés à certains de ces travaux. Malgré
l'unité d'aspect des statues égyptiennes, la façon du rendu n'est pas la
même dans toutes les parties du corps, mais elle est assez analogue
d'une statue à l'autre pour chacune de ces parties. Je me figure volon-
tiers une sorte de directeur des proportions guidant une série d'artisans
occupés à perfectionner chacun le membre qui lui est dévolu ou à le
traiter d'après des traditions spéciales pour chaque division du corps.
Nulle part on ne s'inquiète du modelé sous le caleçon; les cuisses
sont toujours très courtes ; les pectoraux, avec ou sans indication des
clavicules, forment toujours une masse indivise, saillant au-dessus du
buste avec le même degré d'inclinaison ; le thorax et les flancs me
paraissent toujours traités de la même manière, sèche, nette, sans
détails des côtes, les contours du buste s'évasant en corbeille. Les
muscles du bras ont toujours les mêmes plans et ne sont jamais finis
dans le rentrant, vers le morceau du bloc qui les relie au buste. Je laisse
de côté l'ancien empire où l'on sut montrer de la variété, mais à qui
les autres époques ont emprunté des attitudes et quelques-uns de ses
types de facture d'où elles ne sont plus guère sortie.
Depuis le roi Schafra et depuis le grand fonctionnaire Sepa qui exis-
tèrent il y a six mille ans, tous les rois et tous les grands ont été par la
sculpture, assis la tête droite, le corps roide, les genoux rapprochés,
les bras appuyés sur les cuisses, ou par elle mis debout, la jambe
gauche tendue en avant, le bras droit pendant, le gauche ramené sur le
ventre, ou bien les deux bras pendant à la fois.
Et cependant il y eut un temps, plus heureux pour l'art égyptien,
où celui-ci donnait de la liberté aux jambes et aux bras, un temps très
reculé où cet art fit de rapides et grandes conquêtes qu'il ne sut pas
conserver.
Toute l'antiquité grecque retentit du succès des statues dédaliennes,
de ces statues que lui vendait l'industrieuse île de Crète. Daidalos :
industrieux; ceci a été répété bien souvent! Une épithète fut personni-
fiée, Crète l'industrieuse se résuma en un sculpteur-mécanicien nommé
Industrieux, comme plus tard on verra le Corinthien Démarate emme-
ner avec lui en Italie les peintres potiers Euchir et Eugramme, c'est-à-
dire Main-habile et Adroit-dessin. Ceci du moins est un des aspects de
la question très complexe de Dédale. Ces statues du fameux Dédale et de
ses héritiers étaient des personnages sculptés en bois dont les jambes
s'écartaient en imitant le mouvement de la marche, comme celles enfin
GAZETTE DES BEAUX-ARTS.
sculpteurs particuliers n'exécutant, les uns que les bustes et les bras, les
autres que la jupe, et les derniers que les jambes. Des captifs, véritables
manouvriers, durent être employés à certains de ces travaux. Malgré
l'unité d'aspect des statues égyptiennes, la façon du rendu n'est pas la
même dans toutes les parties du corps, mais elle est assez analogue
d'une statue à l'autre pour chacune de ces parties. Je me figure volon-
tiers une sorte de directeur des proportions guidant une série d'artisans
occupés à perfectionner chacun le membre qui lui est dévolu ou à le
traiter d'après des traditions spéciales pour chaque division du corps.
Nulle part on ne s'inquiète du modelé sous le caleçon; les cuisses
sont toujours très courtes ; les pectoraux, avec ou sans indication des
clavicules, forment toujours une masse indivise, saillant au-dessus du
buste avec le même degré d'inclinaison ; le thorax et les flancs me
paraissent toujours traités de la même manière, sèche, nette, sans
détails des côtes, les contours du buste s'évasant en corbeille. Les
muscles du bras ont toujours les mêmes plans et ne sont jamais finis
dans le rentrant, vers le morceau du bloc qui les relie au buste. Je laisse
de côté l'ancien empire où l'on sut montrer de la variété, mais à qui
les autres époques ont emprunté des attitudes et quelques-uns de ses
types de facture d'où elles ne sont plus guère sortie.
Depuis le roi Schafra et depuis le grand fonctionnaire Sepa qui exis-
tèrent il y a six mille ans, tous les rois et tous les grands ont été par la
sculpture, assis la tête droite, le corps roide, les genoux rapprochés,
les bras appuyés sur les cuisses, ou par elle mis debout, la jambe
gauche tendue en avant, le bras droit pendant, le gauche ramené sur le
ventre, ou bien les deux bras pendant à la fois.
Et cependant il y eut un temps, plus heureux pour l'art égyptien,
où celui-ci donnait de la liberté aux jambes et aux bras, un temps très
reculé où cet art fit de rapides et grandes conquêtes qu'il ne sut pas
conserver.
Toute l'antiquité grecque retentit du succès des statues dédaliennes,
de ces statues que lui vendait l'industrieuse île de Crète. Daidalos :
industrieux; ceci a été répété bien souvent! Une épithète fut personni-
fiée, Crète l'industrieuse se résuma en un sculpteur-mécanicien nommé
Industrieux, comme plus tard on verra le Corinthien Démarate emme-
ner avec lui en Italie les peintres potiers Euchir et Eugramme, c'est-à-
dire Main-habile et Adroit-dessin. Ceci du moins est un des aspects de
la question très complexe de Dédale. Ces statues du fameux Dédale et de
ses héritiers étaient des personnages sculptés en bois dont les jambes
s'écartaient en imitant le mouvement de la marche, comme celles enfin