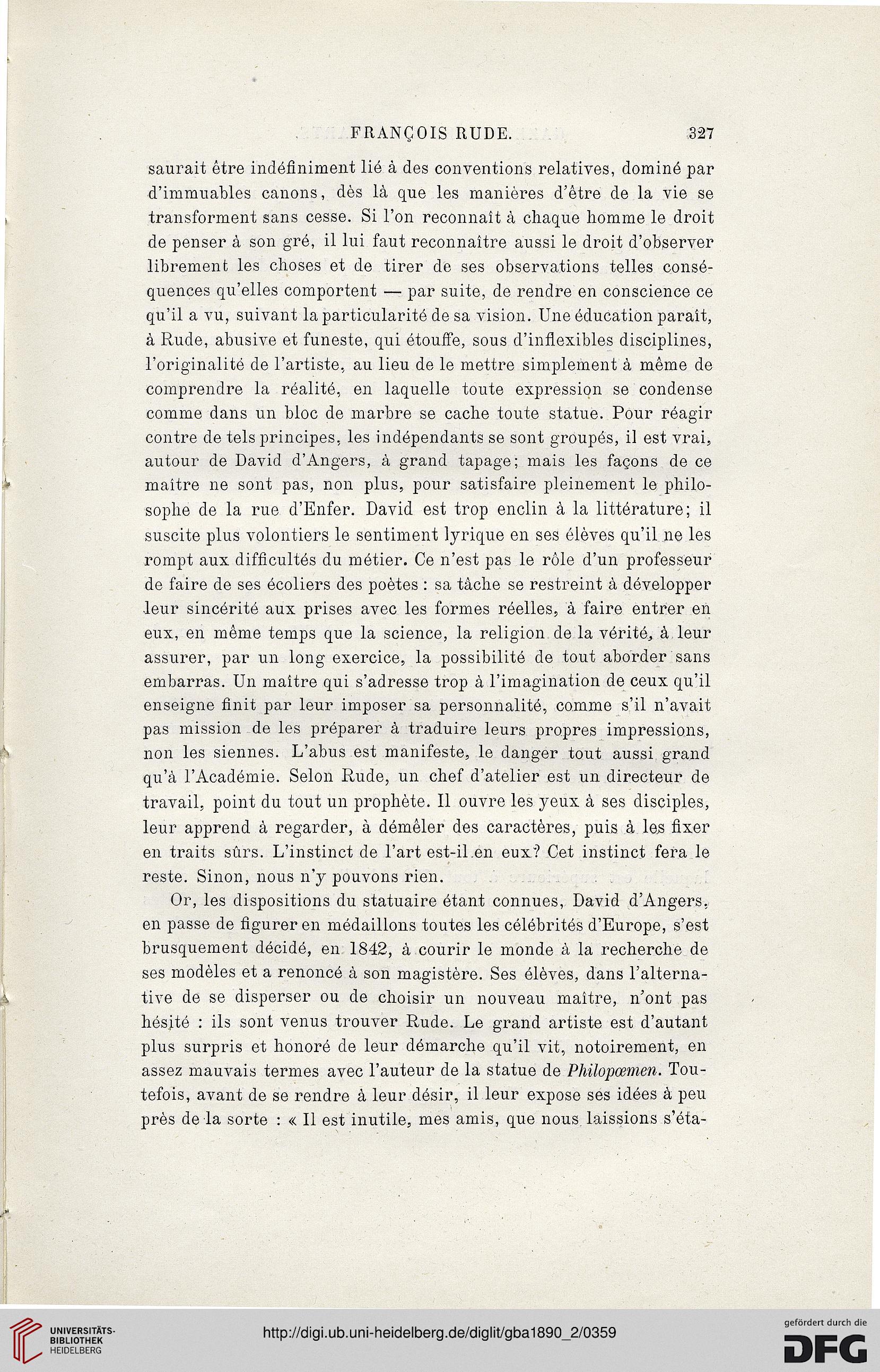FRANÇOIS RUDE.
327
saurait être indéfiniment lié à des conventions relatives, dominé par
d’immuables canons, dès là que les manières d’être de la vie se
transforment sans cesse. Si l’on reconnaît à chaque homme le droit
de penser à son gré, il lui faut reconnaître aussi le droit d’observer
librement les choses et de tirer de ses observations telles consé-
quences qu’elles comportent — par suite, de rendre en conscience ce
qu’il a vu, suivant la particularité de sa vision. Une éducation parait,
à Rude, abusive et funeste, qui étouffe, sous d’inflexibles disciplines,
l’originalité de l’artiste, au lieu de le mettre simplement à même de
comprendre la réalité, en laquelle toute expression se condense
comme dans un bloc de marbre se cache toute statue. Pour réagir
contre de tels principes, les indépendants se sont groupés, il est vrai,
autour de David d’Angers, à grand tapage; mais les façons de ce
maître ne sont pas, non plus, pour satisfaire pleinement le philo-
sophe de la rue d’Enfer. David est trop enclin à la littérature; il
suscite plus volontiers le sentiment lyrique en ses élèves qu’il ne les
rompt aux difficultés du métier. Ce n’est pas le rôle d’un professeur
de faire de ses écoliers des poètes : sa tâche se restreint à développer
leur sincérité aux prises avec les formes réelles, à faire entrer en
eux, en même temps que la science, la religion de la vérité, à leur
assurer, par un long exercice, la possibilité de tout aborder sans
embarras. Un maître qui s’adresse trop à l’imagination de ceux qu’il
enseigne finit par leur imposer sa personnalité, comme s’il n’avait
pas mission de les préparer à traduire leurs propres impressions,
non les siennes. L’abus est manifeste, le danger tout aussi grand
qu’à l’Académie. Selon Rude, un chef d’atelier est un directeur de
travail, point du tout un prophète. Il ouvre les yeux à ses disciples,
leur apprend à regarder, à démêler des caractères, puis à les fixer
en traits sûrs. L’instinct de l’art est-il en eux'? Cet instinct fera le
reste. Sinon, nous n’y pouvons rien.
Or, les dispositions du statuaire étant connues, David d’Angers,
en passe de figurer en médaillons toutes les célébrités d’Europe, s’est
brusquement décidé, en 1842, à courir le monde à la recherche de
ses modèles et a renoncé à son magistère. Ses élèves, dans l’alterna-
tive de se disperser ou de choisir un nouveau maître, n’ont pas
hésité ; ils sont venus trouver Rude. Le grand artiste est d’autant
plus surpris et honoré de leur démarche qu’il vit, notoirement, en
assez mauvais termes avec l’auteur de la statue de Philopœmen. Tou-
tefois, avant de se rendre à leur désir, il leur expose ses idées à peu
près de la sorte : « Il est inutile, mes amis, que nous laissions s’éta-
327
saurait être indéfiniment lié à des conventions relatives, dominé par
d’immuables canons, dès là que les manières d’être de la vie se
transforment sans cesse. Si l’on reconnaît à chaque homme le droit
de penser à son gré, il lui faut reconnaître aussi le droit d’observer
librement les choses et de tirer de ses observations telles consé-
quences qu’elles comportent — par suite, de rendre en conscience ce
qu’il a vu, suivant la particularité de sa vision. Une éducation parait,
à Rude, abusive et funeste, qui étouffe, sous d’inflexibles disciplines,
l’originalité de l’artiste, au lieu de le mettre simplement à même de
comprendre la réalité, en laquelle toute expression se condense
comme dans un bloc de marbre se cache toute statue. Pour réagir
contre de tels principes, les indépendants se sont groupés, il est vrai,
autour de David d’Angers, à grand tapage; mais les façons de ce
maître ne sont pas, non plus, pour satisfaire pleinement le philo-
sophe de la rue d’Enfer. David est trop enclin à la littérature; il
suscite plus volontiers le sentiment lyrique en ses élèves qu’il ne les
rompt aux difficultés du métier. Ce n’est pas le rôle d’un professeur
de faire de ses écoliers des poètes : sa tâche se restreint à développer
leur sincérité aux prises avec les formes réelles, à faire entrer en
eux, en même temps que la science, la religion de la vérité, à leur
assurer, par un long exercice, la possibilité de tout aborder sans
embarras. Un maître qui s’adresse trop à l’imagination de ceux qu’il
enseigne finit par leur imposer sa personnalité, comme s’il n’avait
pas mission de les préparer à traduire leurs propres impressions,
non les siennes. L’abus est manifeste, le danger tout aussi grand
qu’à l’Académie. Selon Rude, un chef d’atelier est un directeur de
travail, point du tout un prophète. Il ouvre les yeux à ses disciples,
leur apprend à regarder, à démêler des caractères, puis à les fixer
en traits sûrs. L’instinct de l’art est-il en eux'? Cet instinct fera le
reste. Sinon, nous n’y pouvons rien.
Or, les dispositions du statuaire étant connues, David d’Angers,
en passe de figurer en médaillons toutes les célébrités d’Europe, s’est
brusquement décidé, en 1842, à courir le monde à la recherche de
ses modèles et a renoncé à son magistère. Ses élèves, dans l’alterna-
tive de se disperser ou de choisir un nouveau maître, n’ont pas
hésité ; ils sont venus trouver Rude. Le grand artiste est d’autant
plus surpris et honoré de leur démarche qu’il vit, notoirement, en
assez mauvais termes avec l’auteur de la statue de Philopœmen. Tou-
tefois, avant de se rendre à leur désir, il leur expose ses idées à peu
près de la sorte : « Il est inutile, mes amis, que nous laissions s’éta-