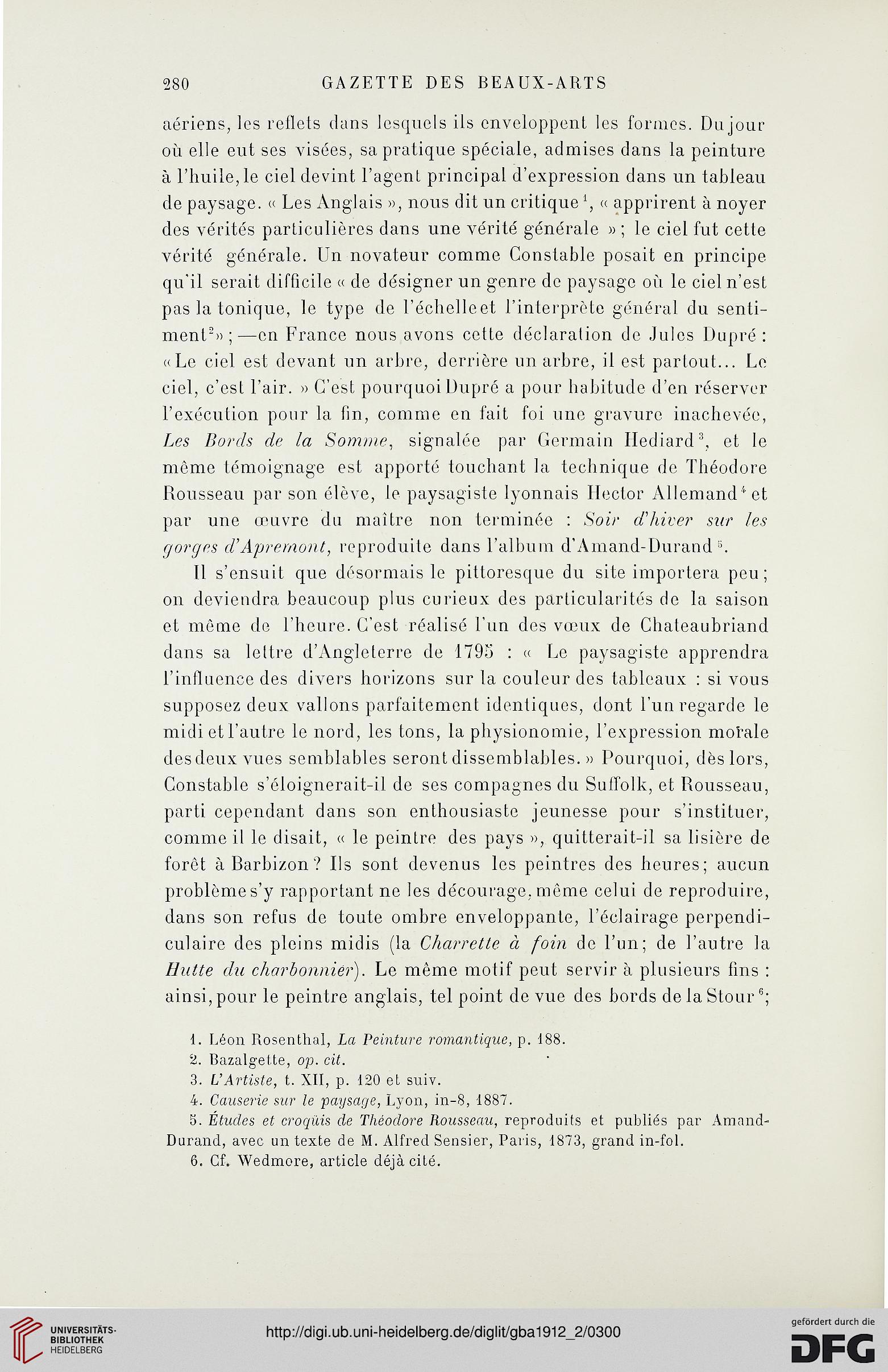280
GAZETTE DES BEAUX-ARTS
aériens, les reflets dans lesquels ils enveloppent les formes. Du jour
où elle eut ses visées, sa pratique spéciale, admises dans la peinture
à l’huile, le ciel devint l’agent principal d’expression dans un tableau
de paysage. « Les Anglais », nous dit un critique \ « apprirent à noyer
des vérités particulières dans une vérité générale » ; le ciel fut cette
vérité générale. Un novateur comme Constable posait en principe
qu'il serait difficile « de désigner un genre de paysage où le ciel n’est
pas la tonique, le type de l’échelleet l’interprète général du senti-
ment1 2»;—en France nous avons cette déclaration de Jules Dupré :
«Le ciel est devant un arbre, derrière un arbre, il est partout... Le
ciel, c’est l’air. » C’est pourquoi Dupré a pour habitude d’en réserver
l’exécution pour la fin, comme en fait foi une gravure inachevée,
Les Bords de la Somme, signalée par Germain Hediard3, et le
même témoignage est apporté touchant la technique de Théodore
Rousseau par son élève, le paysagiste lyonnais Hector Allemand4 et
par une œuvre du maître non terminée : Soir d'hiver sur les
gorges d’Apre mont, reproduite dans l’album d’Amand-Durand 5.
Il s’ensuit que désormais le pittoresque du site importera peu;
on deviendra beaucoup plus curieux des particularités de la saison
et même de l’heure. C’est réalisé l’un des vœux de Chateaubriand
dans sa lettre d’Angleterre de 1793 : « Le paysagiste apprendra
l’influence des divers horizons sur la couleur des tableaux : si vous
supposez deux vallons parfaitement identiques, dont l’un regarde le
midi et l’autre le nord, les tons, la physionomie, l’expression morale
desdeux vues semblables seront dissemblables. » Pourquoi, dès lors,
Constable s’éloignerait-il de ses compagnes du Sutîolk, et Rousseau,
parti cependant dans son enthousiaste jeunesse pour s’instituer,
comme il le disait, « le peintre des pays », quitterait-il sa lisière de
forêt à Barbizon? Ils sont devenus les peintres des heures; aucun
problèmes’y rapportant ne les décourage,même celui de reproduire,
dans son refus de toute ombre enveloppante, l’éclairage perpendi-
culaire des pleins midis (la Charrette à foin de l’un; de l’autre la
Hutte du charbonnier). Le même motif peut servir à plusieurs tins :
ainsi, pour le peintre anglais, tel point de vue des bords delaStour6;
1. Léon Rosenthal, La Peinture romantique, p. 188.
2. Bazalgette, op. cit.
3. L’Artiste, t. XII, p. 120 et suiv.
4. Causerie sur le paysage, Lyon, in-8, 1887.
3. Études et croquis de Théodore Rousseau, reproduits et publiés par Amand-
Durand, avec un texte de M. Alfred Sensier, Paris, 1873, grand in-fol.
6. Cf. Wedmore, article déjà cité.
GAZETTE DES BEAUX-ARTS
aériens, les reflets dans lesquels ils enveloppent les formes. Du jour
où elle eut ses visées, sa pratique spéciale, admises dans la peinture
à l’huile, le ciel devint l’agent principal d’expression dans un tableau
de paysage. « Les Anglais », nous dit un critique \ « apprirent à noyer
des vérités particulières dans une vérité générale » ; le ciel fut cette
vérité générale. Un novateur comme Constable posait en principe
qu'il serait difficile « de désigner un genre de paysage où le ciel n’est
pas la tonique, le type de l’échelleet l’interprète général du senti-
ment1 2»;—en France nous avons cette déclaration de Jules Dupré :
«Le ciel est devant un arbre, derrière un arbre, il est partout... Le
ciel, c’est l’air. » C’est pourquoi Dupré a pour habitude d’en réserver
l’exécution pour la fin, comme en fait foi une gravure inachevée,
Les Bords de la Somme, signalée par Germain Hediard3, et le
même témoignage est apporté touchant la technique de Théodore
Rousseau par son élève, le paysagiste lyonnais Hector Allemand4 et
par une œuvre du maître non terminée : Soir d'hiver sur les
gorges d’Apre mont, reproduite dans l’album d’Amand-Durand 5.
Il s’ensuit que désormais le pittoresque du site importera peu;
on deviendra beaucoup plus curieux des particularités de la saison
et même de l’heure. C’est réalisé l’un des vœux de Chateaubriand
dans sa lettre d’Angleterre de 1793 : « Le paysagiste apprendra
l’influence des divers horizons sur la couleur des tableaux : si vous
supposez deux vallons parfaitement identiques, dont l’un regarde le
midi et l’autre le nord, les tons, la physionomie, l’expression morale
desdeux vues semblables seront dissemblables. » Pourquoi, dès lors,
Constable s’éloignerait-il de ses compagnes du Sutîolk, et Rousseau,
parti cependant dans son enthousiaste jeunesse pour s’instituer,
comme il le disait, « le peintre des pays », quitterait-il sa lisière de
forêt à Barbizon? Ils sont devenus les peintres des heures; aucun
problèmes’y rapportant ne les décourage,même celui de reproduire,
dans son refus de toute ombre enveloppante, l’éclairage perpendi-
culaire des pleins midis (la Charrette à foin de l’un; de l’autre la
Hutte du charbonnier). Le même motif peut servir à plusieurs tins :
ainsi, pour le peintre anglais, tel point de vue des bords delaStour6;
1. Léon Rosenthal, La Peinture romantique, p. 188.
2. Bazalgette, op. cit.
3. L’Artiste, t. XII, p. 120 et suiv.
4. Causerie sur le paysage, Lyon, in-8, 1887.
3. Études et croquis de Théodore Rousseau, reproduits et publiés par Amand-
Durand, avec un texte de M. Alfred Sensier, Paris, 1873, grand in-fol.
6. Cf. Wedmore, article déjà cité.