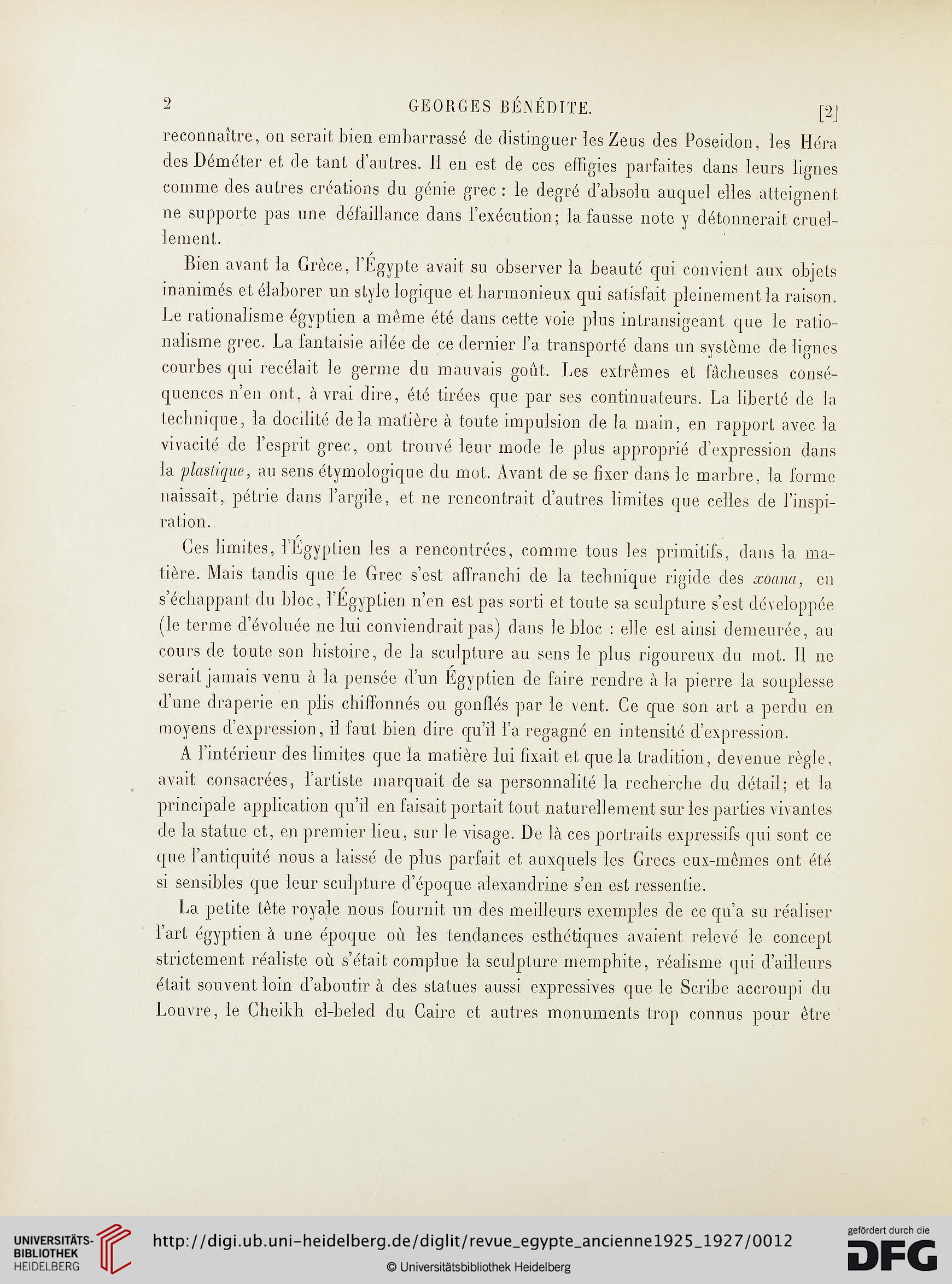2
GEORGES BÉNÉDITE. [2|
reconnaître, on serait bien embarrassé cle distinguer lesZeus des Poseidon, les Héra
cles Déméter et de tant d’autres. II en est de ces effigies parfaites clans leurs lignes
comme des autres créations du génie grec : le degré cTabsolu auquel elles atteignent
ne supporte pas une défaillance clans l’exécution; la fausse note y détonnerait cruel-
lement.
Bien avant la Grèce, l’Égvpte avait su observer la beauté qui convient aux objets
inanimés et élaborer un stvle logique et harmonieux qui satisfait pleinement la raison.
Le rationalisme égyptien a même été dans cette voie plus intransigeant que le ratio-
nalisme grec. La fantaisie ailée cle ce dernier l’a transporté dans un système de lignes
courbes qui recélait le germe du mauvais gout. Les extrêmes et fâcheuses consé-
quences n’en ont, à vrai clire, été tirées que par ses continuateurs. La liberté cle la
technique, la docilité cle la matière à toute impulsion cle la main, en rapport avec la
vivacité cle Pesprit grec, ont trouvé leur mocle le plus approprié d’expression clans
la 'plastique, au sens étymologique du mot. Avant cle se fixer dans le marbre, la forme
naissait, pétrie dans Eargile, et ne rencontrait d’autres limites que celles de Einspi-
ration.
Ges limites, l’Egyptien ies a rencontrées, comme tous les primitifs, dans la ma-
tière. Mais tanclis que le Grec s’est affrancbi de la technique rigide des xoana, en
s’échappant du bloc, l’Egyptieri n’en est pas sorti et toute sa sculpture s’est développce
(le terme cl’évoluée ne lui convienclrail;pas) dans le bloc : elle est ainsi demeurée, au
cours de toute son histoire, de la sculpture au sens le plus rigoureux du mol. II ne
serait jamais venu à la pensée d’un Egyptien cle faire rendre à la pierre la souplesse
d’une draperie en plis chiffonnés ou gonflés par le vent. Ce que son art a perclu en
moyens cl’expression, il faut bien clire qu’il l’a regagné en intensité cl’expression.
A l’intérieur des limites cjue ïa matière lui fixait et cjue la tradition, devenue règle,
avait consacrées, l’artiste marcjuait de sa personnalité la recherche clu détail; et la
principale application qu’il en faisait portait tout naturellement sur les parties vivantes
de la statue et, en premier lieu, sur le visage. De là ces portraits expressifs cjui sont ce
que l’antiquité nous a laissé cle plus parfait et auxquels les Grecs eux-mêmes ont été
si sensibles cjue leur sculpture d’épocjue alexandrine s’en est ressentie.
La petite tête royale nous fournit un cles meilleurs exemples cle ce qu’a su réaliser
l’art égyjjtien à une époque où les tenclances esthétiques avaient relevé le concept
strictement réaliste où s’était comjilue la sculpture memphite, réalisme qui cl’ailleurs
était souvent loin d’aboutir à des statues aussi expressives que le Scribe accroupi clu
Louvre, le Cheikb el-belecl du Gaire et autres monuments trop connus pour être
GEORGES BÉNÉDITE. [2|
reconnaître, on serait bien embarrassé cle distinguer lesZeus des Poseidon, les Héra
cles Déméter et de tant d’autres. II en est de ces effigies parfaites clans leurs lignes
comme des autres créations du génie grec : le degré cTabsolu auquel elles atteignent
ne supporte pas une défaillance clans l’exécution; la fausse note y détonnerait cruel-
lement.
Bien avant la Grèce, l’Égvpte avait su observer la beauté qui convient aux objets
inanimés et élaborer un stvle logique et harmonieux qui satisfait pleinement la raison.
Le rationalisme égyptien a même été dans cette voie plus intransigeant que le ratio-
nalisme grec. La fantaisie ailée cle ce dernier l’a transporté dans un système de lignes
courbes qui recélait le germe du mauvais gout. Les extrêmes et fâcheuses consé-
quences n’en ont, à vrai clire, été tirées que par ses continuateurs. La liberté cle la
technique, la docilité cle la matière à toute impulsion cle la main, en rapport avec la
vivacité cle Pesprit grec, ont trouvé leur mocle le plus approprié d’expression clans
la 'plastique, au sens étymologique du mot. Avant cle se fixer dans le marbre, la forme
naissait, pétrie dans Eargile, et ne rencontrait d’autres limites que celles de Einspi-
ration.
Ges limites, l’Egyptien ies a rencontrées, comme tous les primitifs, dans la ma-
tière. Mais tanclis que le Grec s’est affrancbi de la technique rigide des xoana, en
s’échappant du bloc, l’Egyptieri n’en est pas sorti et toute sa sculpture s’est développce
(le terme cl’évoluée ne lui convienclrail;pas) dans le bloc : elle est ainsi demeurée, au
cours de toute son histoire, de la sculpture au sens le plus rigoureux du mol. II ne
serait jamais venu à la pensée d’un Egyptien cle faire rendre à la pierre la souplesse
d’une draperie en plis chiffonnés ou gonflés par le vent. Ce que son art a perclu en
moyens cl’expression, il faut bien clire qu’il l’a regagné en intensité cl’expression.
A l’intérieur des limites cjue ïa matière lui fixait et cjue la tradition, devenue règle,
avait consacrées, l’artiste marcjuait de sa personnalité la recherche clu détail; et la
principale application qu’il en faisait portait tout naturellement sur les parties vivantes
de la statue et, en premier lieu, sur le visage. De là ces portraits expressifs cjui sont ce
que l’antiquité nous a laissé cle plus parfait et auxquels les Grecs eux-mêmes ont été
si sensibles cjue leur sculpture d’épocjue alexandrine s’en est ressentie.
La petite tête royale nous fournit un cles meilleurs exemples cle ce qu’a su réaliser
l’art égyjjtien à une époque où les tenclances esthétiques avaient relevé le concept
strictement réaliste où s’était comjilue la sculpture memphite, réalisme qui cl’ailleurs
était souvent loin d’aboutir à des statues aussi expressives que le Scribe accroupi clu
Louvre, le Cheikb el-belecl du Gaire et autres monuments trop connus pour être