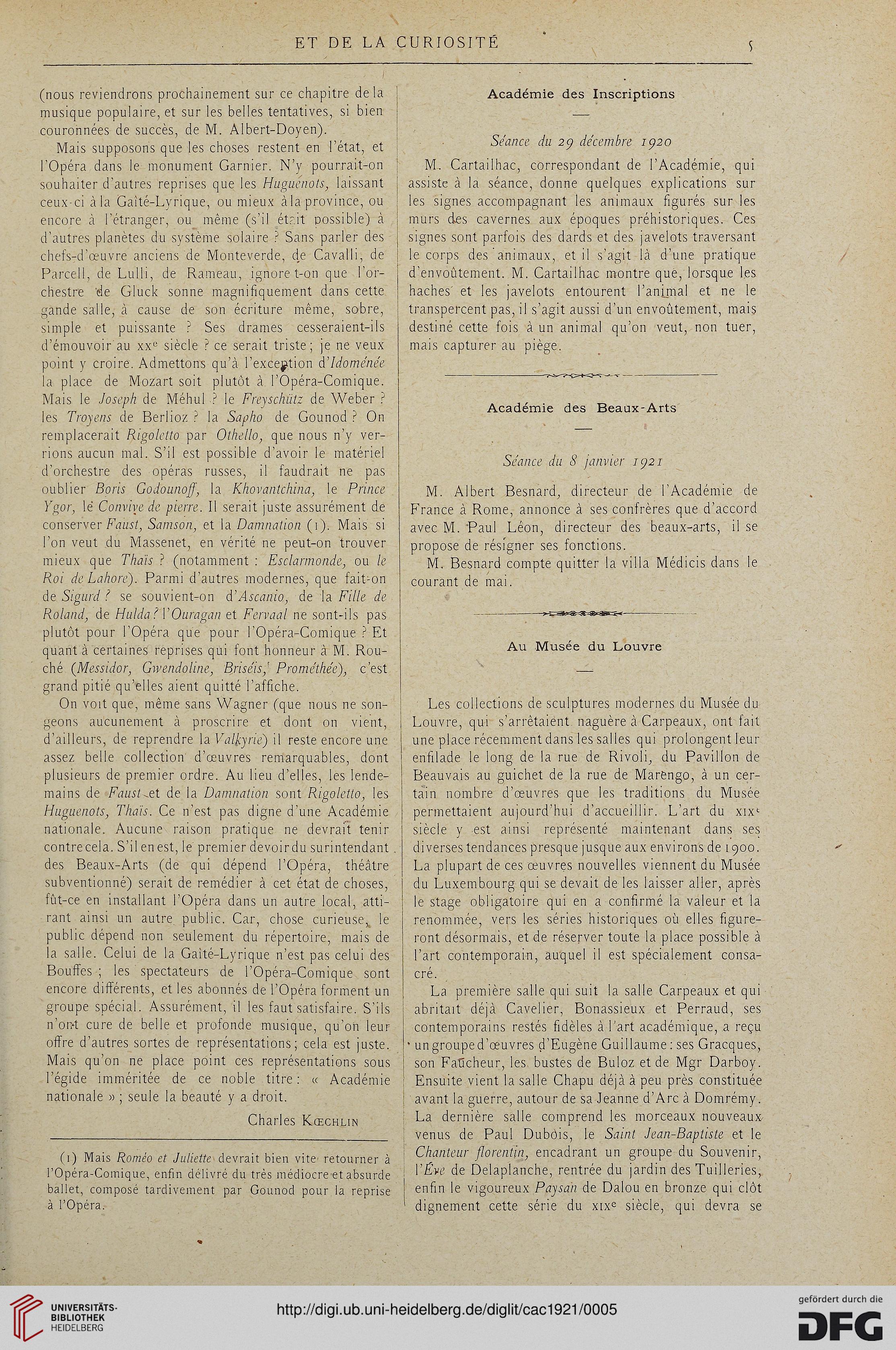ET DE LA CURIOSITÉ
(nous reviendrons prochainement sur ce chapitre delà
musique populaire, et sur les belles tentatives, si bien
couronnées de succès, de M. Albert-Doyen).
Mais supposons que les choses restent en l’état, et
l’Opéra dans le monument Garnier. N’y pourrait-on
souhaiter d’autres reprises que les Huguenots, laissant
ceux-ci à la Gaîté-Lyrique, ou mieux à la province, ou
encore à l’étranger, ou même (s’il était possible) à
d’autres planètes du système solaire ? Sans parler des
chefs-d’œuvre anciens de Monteverde, de Caval 1 i, de
Parcel!, de Lulli, de Rameau, ignore t-on que l’or-
chestre de Gluck sonne magnifiquement dans cette
gande salle, à cause de son écriture même, sobre,
simple et puissante ? Ses drames cesseraient-ils
d’émouvoir au xxu siècle ? ce serait triste; je ne veux
point y croire. Admettons qu’à l’exception d’ldoménée
la place de Mozart soit plutôt à l’Opéra-Comique.
Mais le Joseph de Méhul ? le Freyschütz de Weber ?
les Troyens de Berlioz ? la Sapho de Gounod ? On
remplacerait Rigolctto par Othello, que nous n’y ver-
rions aucun mal. S’il est possible d’avoir le matériel
d’orchestre des opéras russes, il faudrait ne pas
oublier Boris Godounoff, la Khovantchina, le Prince
Ygor, lé Convive de pierre. Il serait juste assurément de
conserver Faust, Samson, et la Damnation (i). Mais si
l’on veut du Massenet, en vérité ne peut-on trouver
mieux que Thaïs ? (notamment : Esclarmonde, ou le
Roi de Lahoré). Parmi d’autres modernes, que faiLon
de Sigurd ? se souvient-on d’Ascanio, de la Fille de
Roland, de Hulda?' Y Ouragan et Fervaal ne sont-ils pas
plutôt pour l’Opéra que pour l’Opéra-Comique ? Et
quant à certaines reprises qui font honneur à M. Rou-
ché (Messidor, Gwendoline, Briséis,' Prométhée), c’est
grand pitié qu’elles aient quitté l’affiche.
On voit que, même sans Wagner (que nous ne son-
geons aucunement à proscrire et dont on vient,
d’ailleurs, de reprendre la Valkyne) il reste encore une
assez belle collection d’œuvres remarquables, dont
plusieurs de premier ordre. Au lieu d’elles, les lende-
mains de Faust^et de la Damnation sont Rigolctto, les
Huguenots, Thaïs. Ce n’est pas digne d’une Académie
nationale. Aucune- raison pratique ne devrait tenir
contre cela. S’il en est, le premier devoir du surintendant
des Beaux-Arts (de qui dépend l’Opéra, théâtre
subventionné) serait de remédier à cet état de choses,
fût-ce en installant l’Opéra dans un autre local, atti-
rant ainsi un autre, public. Car, chose curieuse^ le
public dépend non seulement du répertoire, mais de
la salle. Celui de la Gaîté-Lyrique n’est pas celui des
Bouffes; les spectateurs de l’Opéra-Comique sont
encore différents, et les abonnés de l’Opéra forment un
groupe spécial. Assurément, il les faut satisfaire. S’ils
n’on-t cure de belle et profonde musique, qu’on leur
offre d’autres sortes de représentations; cela est juste.
Mais qu’on ne place point ces représentations sous
l’égide imméritée de ce noble titre: « Académie
nationale » ; seule la beauté y a droit.
Charles Kœchlin (i)
(i) Mais Roméo et Juliette' devrait bien vite- retourner à
l’Opéra-Comique, enfin délivré du très médiocre-et absurde
ballet, composé tardivement par Gounod pour la reprise
à l’Opéra.
S
Académie des Inscriptions
Séance du 2cy décembre ic)20
M. Cartailhac, correspondant de l’Académie, qui
assiste à la séance, donne quelques explications sur
les signes accompagnant les animaux figurés sur les
murs des cavernes aux époques préhistoriques. Ces
signes sont parfois des dards et des javelots traversant
le corps des animaux, et il s’agit là d’une pratique
d’envoûtement. M. Cartailhac montre què, lorsque les
haches et les javelots entourent l’animal et ne le
transpercent pas, il s’agit aussi d’un envoûtement, mais
destiné cette fois à un animal qu’on veut, non tuer,
mais capturer au piège.
Académie des Beaux-Arts
Séance du 8 janvier 1921
M. Albert Besnard, directeur de l’Académie de
France à Rome, annonce à ses confrères que d’accord
avec M. ‘Paul Léon, directeur des beaux-arts, il se
propose de résigner ses fonctions.
M. Besnard compte quitter la villa Médicis dans le
courant de mai.
Au Musée du Louvre
Les collections de sculptures modernes du Musée du
Louvre, qui s’arrêtaient naguère à Carpeaux, ont fait
une place récemment dans les salles qui prolongent leur
enfilade le long de la rue de Rivoli, du Pavillon de
Beauvais au guichet de la rue de Marengo, à un cer-
tain nombre d’œuvres que les traditions du Musée
permettaient aujourd’hui d’accueillir. L’art du xix1
siècle y est ainsi représenté maintenant dans ses
diverses tendances presque jusque aux environs de 1900.
La plupart de ces œuvres nouvelles viennent du Musée
du Luxembourg qui se devait de les laisser aller, après
le stage obligatoire qui en a confirmé la valeur et la
renommée, vers les séries historiques où elles figure-
ront désormais, et de réserver toute la place possible à
l’art contemporain, auquel il est spécialement consa-
cré.
La première salle qui suit la salle Carpeaux et qui
abritait déjà Cavelier, Bonassieux et Perraud, ses
contemporains restés fidèles à l’art académique, a reçu
ungrouped’œuvres d’Eugène Guillaume: ses Gracques,
son Faücheur, les bustes de Buloz et de Mgr Darboy.
Ensuite vient la salle Chapu déjà à peu près constituée
avant la guerre, autour de sa Jeanne d’Arc à Domrémy.
La dernière salle comprend les morceaux nouveaux-
venus de Paul Dubôis, le Saint Jean-Baptiste et le
Chanteur florentin, encadrant un groupe du Souvenir,
YÉve de Delaplanche, rentrée du jardin des Tu il leries,
enfin le vigoureux Paysan de Dalou en bronze qui clôt
dignement cette série du xixe siècle, qui devra se
(nous reviendrons prochainement sur ce chapitre delà
musique populaire, et sur les belles tentatives, si bien
couronnées de succès, de M. Albert-Doyen).
Mais supposons que les choses restent en l’état, et
l’Opéra dans le monument Garnier. N’y pourrait-on
souhaiter d’autres reprises que les Huguenots, laissant
ceux-ci à la Gaîté-Lyrique, ou mieux à la province, ou
encore à l’étranger, ou même (s’il était possible) à
d’autres planètes du système solaire ? Sans parler des
chefs-d’œuvre anciens de Monteverde, de Caval 1 i, de
Parcel!, de Lulli, de Rameau, ignore t-on que l’or-
chestre de Gluck sonne magnifiquement dans cette
gande salle, à cause de son écriture même, sobre,
simple et puissante ? Ses drames cesseraient-ils
d’émouvoir au xxu siècle ? ce serait triste; je ne veux
point y croire. Admettons qu’à l’exception d’ldoménée
la place de Mozart soit plutôt à l’Opéra-Comique.
Mais le Joseph de Méhul ? le Freyschütz de Weber ?
les Troyens de Berlioz ? la Sapho de Gounod ? On
remplacerait Rigolctto par Othello, que nous n’y ver-
rions aucun mal. S’il est possible d’avoir le matériel
d’orchestre des opéras russes, il faudrait ne pas
oublier Boris Godounoff, la Khovantchina, le Prince
Ygor, lé Convive de pierre. Il serait juste assurément de
conserver Faust, Samson, et la Damnation (i). Mais si
l’on veut du Massenet, en vérité ne peut-on trouver
mieux que Thaïs ? (notamment : Esclarmonde, ou le
Roi de Lahoré). Parmi d’autres modernes, que faiLon
de Sigurd ? se souvient-on d’Ascanio, de la Fille de
Roland, de Hulda?' Y Ouragan et Fervaal ne sont-ils pas
plutôt pour l’Opéra que pour l’Opéra-Comique ? Et
quant à certaines reprises qui font honneur à M. Rou-
ché (Messidor, Gwendoline, Briséis,' Prométhée), c’est
grand pitié qu’elles aient quitté l’affiche.
On voit que, même sans Wagner (que nous ne son-
geons aucunement à proscrire et dont on vient,
d’ailleurs, de reprendre la Valkyne) il reste encore une
assez belle collection d’œuvres remarquables, dont
plusieurs de premier ordre. Au lieu d’elles, les lende-
mains de Faust^et de la Damnation sont Rigolctto, les
Huguenots, Thaïs. Ce n’est pas digne d’une Académie
nationale. Aucune- raison pratique ne devrait tenir
contre cela. S’il en est, le premier devoir du surintendant
des Beaux-Arts (de qui dépend l’Opéra, théâtre
subventionné) serait de remédier à cet état de choses,
fût-ce en installant l’Opéra dans un autre local, atti-
rant ainsi un autre, public. Car, chose curieuse^ le
public dépend non seulement du répertoire, mais de
la salle. Celui de la Gaîté-Lyrique n’est pas celui des
Bouffes; les spectateurs de l’Opéra-Comique sont
encore différents, et les abonnés de l’Opéra forment un
groupe spécial. Assurément, il les faut satisfaire. S’ils
n’on-t cure de belle et profonde musique, qu’on leur
offre d’autres sortes de représentations; cela est juste.
Mais qu’on ne place point ces représentations sous
l’égide imméritée de ce noble titre: « Académie
nationale » ; seule la beauté y a droit.
Charles Kœchlin (i)
(i) Mais Roméo et Juliette' devrait bien vite- retourner à
l’Opéra-Comique, enfin délivré du très médiocre-et absurde
ballet, composé tardivement par Gounod pour la reprise
à l’Opéra.
S
Académie des Inscriptions
Séance du 2cy décembre ic)20
M. Cartailhac, correspondant de l’Académie, qui
assiste à la séance, donne quelques explications sur
les signes accompagnant les animaux figurés sur les
murs des cavernes aux époques préhistoriques. Ces
signes sont parfois des dards et des javelots traversant
le corps des animaux, et il s’agit là d’une pratique
d’envoûtement. M. Cartailhac montre què, lorsque les
haches et les javelots entourent l’animal et ne le
transpercent pas, il s’agit aussi d’un envoûtement, mais
destiné cette fois à un animal qu’on veut, non tuer,
mais capturer au piège.
Académie des Beaux-Arts
Séance du 8 janvier 1921
M. Albert Besnard, directeur de l’Académie de
France à Rome, annonce à ses confrères que d’accord
avec M. ‘Paul Léon, directeur des beaux-arts, il se
propose de résigner ses fonctions.
M. Besnard compte quitter la villa Médicis dans le
courant de mai.
Au Musée du Louvre
Les collections de sculptures modernes du Musée du
Louvre, qui s’arrêtaient naguère à Carpeaux, ont fait
une place récemment dans les salles qui prolongent leur
enfilade le long de la rue de Rivoli, du Pavillon de
Beauvais au guichet de la rue de Marengo, à un cer-
tain nombre d’œuvres que les traditions du Musée
permettaient aujourd’hui d’accueillir. L’art du xix1
siècle y est ainsi représenté maintenant dans ses
diverses tendances presque jusque aux environs de 1900.
La plupart de ces œuvres nouvelles viennent du Musée
du Luxembourg qui se devait de les laisser aller, après
le stage obligatoire qui en a confirmé la valeur et la
renommée, vers les séries historiques où elles figure-
ront désormais, et de réserver toute la place possible à
l’art contemporain, auquel il est spécialement consa-
cré.
La première salle qui suit la salle Carpeaux et qui
abritait déjà Cavelier, Bonassieux et Perraud, ses
contemporains restés fidèles à l’art académique, a reçu
ungrouped’œuvres d’Eugène Guillaume: ses Gracques,
son Faücheur, les bustes de Buloz et de Mgr Darboy.
Ensuite vient la salle Chapu déjà à peu près constituée
avant la guerre, autour de sa Jeanne d’Arc à Domrémy.
La dernière salle comprend les morceaux nouveaux-
venus de Paul Dubôis, le Saint Jean-Baptiste et le
Chanteur florentin, encadrant un groupe du Souvenir,
YÉve de Delaplanche, rentrée du jardin des Tu il leries,
enfin le vigoureux Paysan de Dalou en bronze qui clôt
dignement cette série du xixe siècle, qui devra se