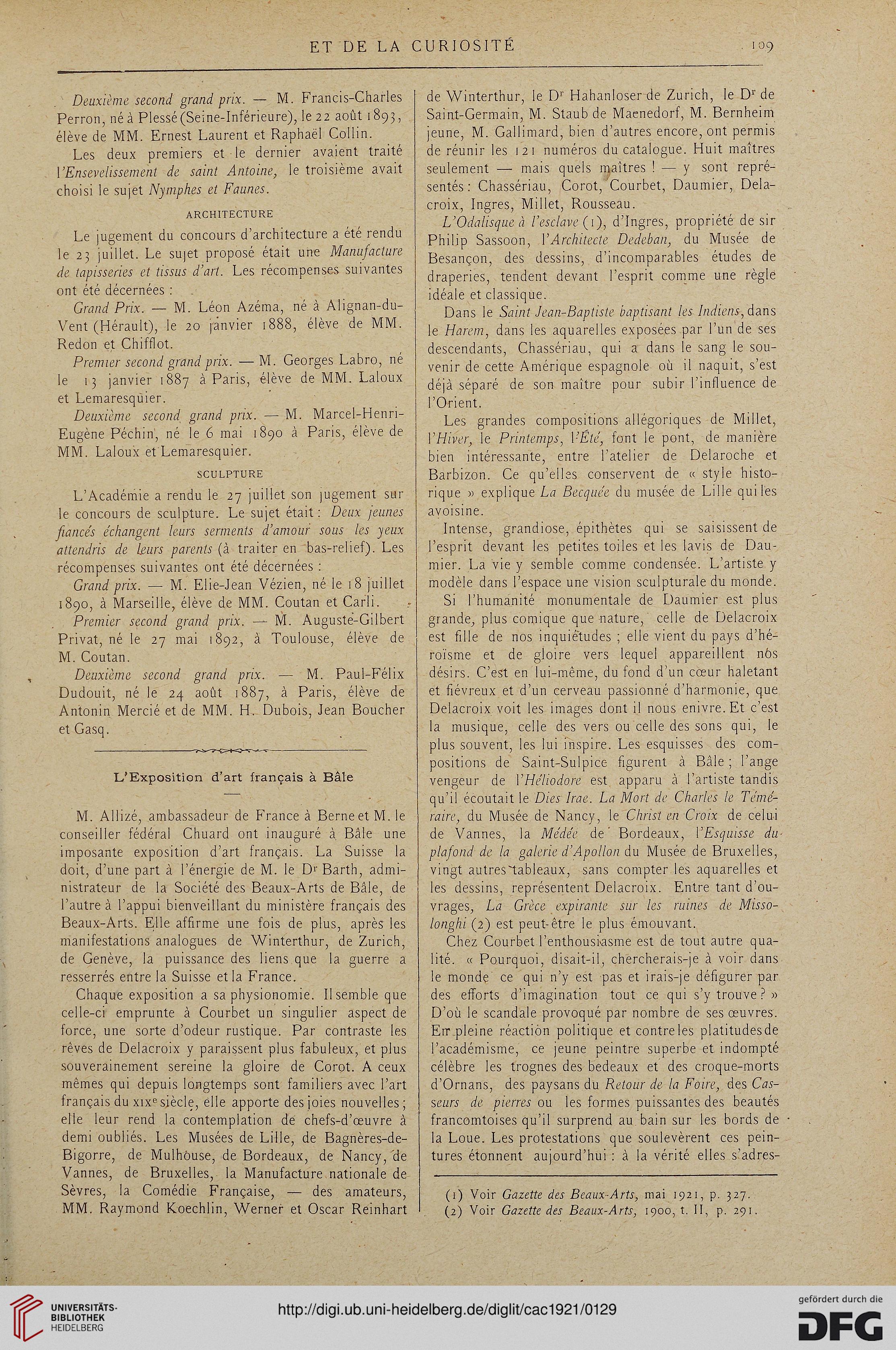ET DE LA CURIOSITÉ
109
Deuxieme second grand prix. — M. Francis-Charles
Perron, né à Plessé(Seine-Inférieure), le 22 août 1893,
élève de MM. Ernest Laurent et Raphaël Collin.
Les deux premiers et le dernier avaient traité
Y Ensevelissement de saint Antoine, le troisième avait
choisi le sujet Nymphes et Faunes.
ARCHITECTURE
Le jugement du concours d’architecture a été rendu
le 23 juillet. Le sujet proposé était une Manufacture
de tapisseries et tissus d’art. Les récompenses suivantes
ont été décernées :
Grand Prix. —- M. Léon Azéma, né à Alignan-du-
Vent (Hérault), le 20 janvier 1888, élève de MM.
Redon et Chifflot.
Premier second grand prix. — M. Georges Labro, né
le 13 janvier 1887 à Paris, élève de MM. Laloux
et Lemaresqüier.
Deuxième second grand prix. — M. Marcel-Henri-
Eugène Péchin, né le 6 mai 1890 à Paris, élève de
MM. Laloux et Lemaresqüier.
SCULPTURE
L’Académie a rendu le 27 juillet son jugement sur
le concours de sculpture. Le sujet était : Deux jeunes
fiancés échangent leurs serments d’amour sous les yeux
attendris de Durs parents (à traiter en bas-relief). Les
récompenses suivantes ont été décernées :
Grand prix. — M. Elie-Jean Vézien, né le 18 juillet
1890, à Marseille, élève de MM. Coutan et Carii.
Premier second grand prix. — M. Auguste-Gilbert
Privât, né le 27 mai 1892, à Toulouse, élève de
M. Coutan.
Deuxième second grand prix. — M. Paul-Félix
Dudouit, né le 24 août 1887, à Paris, élève de
Antonin Mercié et de MM. H.. Dubois, Jean Boucher
et Gasq.
L’Exposition d’art français à Bâle
M. Allizé, ambassadeur de France à Berne et M. le
conseiller fédéral Chuard ont inauguré à Bâle une
imposante exposition d’art français. La Suisse la
doit, d’une part à l’énergie de M. le Dr Barth, admi-
nistrateur de la Société des Beaux-Arts de Bâle, de
l’autre à l’appui bienveillant du ministère français des
Beaux-Arts. Elle affirme une fois de plus, après les
manifestations analogues de Winterthur, de Zurich,
de Genève, la puissance des liens que la guerre a
resserrés entre la Suisse et la France.
Chaque exposition a sa physionomie. Il semble que
celle-ci emprunte à Courbet un singulier aspect de
force, une sorte d’odeur rustique. Par contraste les
rêves de Delacroix y paraissent plus fabuleux, et plus
souverainement sereine la gloire de Corot. A ceux
mêmes qui depuis longtemps sont familiers avec l’art
français du xix°sjècle, elle apporte des joies nouvelles;
elle leur rend la contemplation de chefs-d’œuvre à
demi oubliés. Les Musées de Lille, de Bagnères-de-
Bigorre, de Mulhouse, de Bordeaux, de Nancy, de
Vannes, de Bruxelles, la Manufacture nationale de
Sèvres, la Comédie Française, — des amateurs,
MM. Raymond Koechlin, Werner et Oscar Reinhart
de Winterthur, le Dr Hahanloser de Zurich, le Dr de
Saint-Germain, M. Staub de Maenedorf, M. Bernheim
jeune, M. Gallimard, bien d’autres encore, ont permis
de réunir les 121 numéros du catalogue. Huit maîtres
seulement — mais quels maîtres ! — y sont repré-
sentés : Chassériau, Corot, Courbet, Daumier, Dela-
croix, Ingres, Millet, Rousseau.
L'Odalisque à l’esclave (1), d’Ingres, propriété de sir
Philip Sassoon, l’Architecte Dedeban, du Musée de
Besançon, des dessins, d’incomparables études de
draperies, tendent devant l’esprit comme une règle
idéale et classique.
Dans le Saint Jean-Baptiste baptisant les Indiens, dans
le Harem, dans les aquarelles exposées par l’un de ses
descendants, Chassériau, qui a dans le sang le sou-
venir de cette Amérique espagnole où il naquit, s’est
déjà séparé de son maître pour subir l’influence de
l’Orient.
Les grandes compositions allégoriques de Millet,
l’Hiver, le Printemps, Y Été, font le pont, de manière
bien intéressante, entre l’atelier de Delaroche et
Barbizon. Ce qu’elles conservent de « style histo-
rique « explique La Becquée du musée de Lille qui les
avoisine.
Intense, grandiose, épithètes qui se saisissent de
l’esprit devant les petites toiles et les lavis de Dau-
mier. La vie y semble comme condensée. L’artiste y
modèle dans l’espace une vision sculpturale du monde.
Si l’humanité monumentale de Daumier est plus
grande, plus comique que nature, celle de Delacroix
est fille de nos inquiétudes ; elle vient du pays d’hé-
roïsme et de gloire vers lequel appareillent nôs
désirs. C’est en lui-même, du fond d’un cœur haletant
et fiévreux et d’un cerveau passionné d’harmonie, que
Delacroix voit les images dont il nous enivre. Et c’est
la musique, celle des vers ou celle des sons qui, le
plus souvent, les lui inspire. Les esquisses des com-
positions de Saint-Sulpice figurent à Bâle ; l’ange
vengeur de 1 ’Héliodore est apparu à l’artiste tandis
qu’il écoutait le Dies Irae. La Mort de Charles le Témé-
raire, du Musée de Nancy, le Christ en Croix de celui
de Vannes, la Médée de' Bordeaux, l’Esquisse du-
plafond de la galerie d’Apollon du Musée de Bruxelles,
vingt autresAableaux, sans compter les aquarelles et
les dessins, représentent Delacroix. Entre tant d’ou-
vrages, La Grèce expirante sur les ruines de Misso-
longhi (2) est peut-être le plus émouvant.
Chez Courbet l’enthousksme est de tout autre qua-
lité. « Pourquoi, disait-il, chercherais-je à voir dans
le monde ce qui n’y est pas et irais-je défigurer par
des efforts d’imagination tout ce qui s’y trouve ? »
D’où le scandale provoqué par nombre de ses œuvres.
Etr pleine réaction politique et contreles platitudesde
l’académisme, ce jeune peintre superbe et indompté
célèbre les trognes des bedeaux et des croque-morts
d’Ornans, des paysans du Retour de la Foire, des Cas-
seurs de pierres ou les formes puissantes des beautés
francomtoises qu’il surprend au bain sur les bords de
la Loue. Les protestations que soulevèrent ces pein-
tures étonnent aujourd’hui : à la vérité elles s’adres-
(1) Voir Gazette des Beaux-Arts, mai 1921, p. 327.
(2) Voir Gazette des Beaux-Arts, 1900, t. Il, p. 291.
109
Deuxieme second grand prix. — M. Francis-Charles
Perron, né à Plessé(Seine-Inférieure), le 22 août 1893,
élève de MM. Ernest Laurent et Raphaël Collin.
Les deux premiers et le dernier avaient traité
Y Ensevelissement de saint Antoine, le troisième avait
choisi le sujet Nymphes et Faunes.
ARCHITECTURE
Le jugement du concours d’architecture a été rendu
le 23 juillet. Le sujet proposé était une Manufacture
de tapisseries et tissus d’art. Les récompenses suivantes
ont été décernées :
Grand Prix. —- M. Léon Azéma, né à Alignan-du-
Vent (Hérault), le 20 janvier 1888, élève de MM.
Redon et Chifflot.
Premier second grand prix. — M. Georges Labro, né
le 13 janvier 1887 à Paris, élève de MM. Laloux
et Lemaresqüier.
Deuxième second grand prix. — M. Marcel-Henri-
Eugène Péchin, né le 6 mai 1890 à Paris, élève de
MM. Laloux et Lemaresqüier.
SCULPTURE
L’Académie a rendu le 27 juillet son jugement sur
le concours de sculpture. Le sujet était : Deux jeunes
fiancés échangent leurs serments d’amour sous les yeux
attendris de Durs parents (à traiter en bas-relief). Les
récompenses suivantes ont été décernées :
Grand prix. — M. Elie-Jean Vézien, né le 18 juillet
1890, à Marseille, élève de MM. Coutan et Carii.
Premier second grand prix. — M. Auguste-Gilbert
Privât, né le 27 mai 1892, à Toulouse, élève de
M. Coutan.
Deuxième second grand prix. — M. Paul-Félix
Dudouit, né le 24 août 1887, à Paris, élève de
Antonin Mercié et de MM. H.. Dubois, Jean Boucher
et Gasq.
L’Exposition d’art français à Bâle
M. Allizé, ambassadeur de France à Berne et M. le
conseiller fédéral Chuard ont inauguré à Bâle une
imposante exposition d’art français. La Suisse la
doit, d’une part à l’énergie de M. le Dr Barth, admi-
nistrateur de la Société des Beaux-Arts de Bâle, de
l’autre à l’appui bienveillant du ministère français des
Beaux-Arts. Elle affirme une fois de plus, après les
manifestations analogues de Winterthur, de Zurich,
de Genève, la puissance des liens que la guerre a
resserrés entre la Suisse et la France.
Chaque exposition a sa physionomie. Il semble que
celle-ci emprunte à Courbet un singulier aspect de
force, une sorte d’odeur rustique. Par contraste les
rêves de Delacroix y paraissent plus fabuleux, et plus
souverainement sereine la gloire de Corot. A ceux
mêmes qui depuis longtemps sont familiers avec l’art
français du xix°sjècle, elle apporte des joies nouvelles;
elle leur rend la contemplation de chefs-d’œuvre à
demi oubliés. Les Musées de Lille, de Bagnères-de-
Bigorre, de Mulhouse, de Bordeaux, de Nancy, de
Vannes, de Bruxelles, la Manufacture nationale de
Sèvres, la Comédie Française, — des amateurs,
MM. Raymond Koechlin, Werner et Oscar Reinhart
de Winterthur, le Dr Hahanloser de Zurich, le Dr de
Saint-Germain, M. Staub de Maenedorf, M. Bernheim
jeune, M. Gallimard, bien d’autres encore, ont permis
de réunir les 121 numéros du catalogue. Huit maîtres
seulement — mais quels maîtres ! — y sont repré-
sentés : Chassériau, Corot, Courbet, Daumier, Dela-
croix, Ingres, Millet, Rousseau.
L'Odalisque à l’esclave (1), d’Ingres, propriété de sir
Philip Sassoon, l’Architecte Dedeban, du Musée de
Besançon, des dessins, d’incomparables études de
draperies, tendent devant l’esprit comme une règle
idéale et classique.
Dans le Saint Jean-Baptiste baptisant les Indiens, dans
le Harem, dans les aquarelles exposées par l’un de ses
descendants, Chassériau, qui a dans le sang le sou-
venir de cette Amérique espagnole où il naquit, s’est
déjà séparé de son maître pour subir l’influence de
l’Orient.
Les grandes compositions allégoriques de Millet,
l’Hiver, le Printemps, Y Été, font le pont, de manière
bien intéressante, entre l’atelier de Delaroche et
Barbizon. Ce qu’elles conservent de « style histo-
rique « explique La Becquée du musée de Lille qui les
avoisine.
Intense, grandiose, épithètes qui se saisissent de
l’esprit devant les petites toiles et les lavis de Dau-
mier. La vie y semble comme condensée. L’artiste y
modèle dans l’espace une vision sculpturale du monde.
Si l’humanité monumentale de Daumier est plus
grande, plus comique que nature, celle de Delacroix
est fille de nos inquiétudes ; elle vient du pays d’hé-
roïsme et de gloire vers lequel appareillent nôs
désirs. C’est en lui-même, du fond d’un cœur haletant
et fiévreux et d’un cerveau passionné d’harmonie, que
Delacroix voit les images dont il nous enivre. Et c’est
la musique, celle des vers ou celle des sons qui, le
plus souvent, les lui inspire. Les esquisses des com-
positions de Saint-Sulpice figurent à Bâle ; l’ange
vengeur de 1 ’Héliodore est apparu à l’artiste tandis
qu’il écoutait le Dies Irae. La Mort de Charles le Témé-
raire, du Musée de Nancy, le Christ en Croix de celui
de Vannes, la Médée de' Bordeaux, l’Esquisse du-
plafond de la galerie d’Apollon du Musée de Bruxelles,
vingt autresAableaux, sans compter les aquarelles et
les dessins, représentent Delacroix. Entre tant d’ou-
vrages, La Grèce expirante sur les ruines de Misso-
longhi (2) est peut-être le plus émouvant.
Chez Courbet l’enthousksme est de tout autre qua-
lité. « Pourquoi, disait-il, chercherais-je à voir dans
le monde ce qui n’y est pas et irais-je défigurer par
des efforts d’imagination tout ce qui s’y trouve ? »
D’où le scandale provoqué par nombre de ses œuvres.
Etr pleine réaction politique et contreles platitudesde
l’académisme, ce jeune peintre superbe et indompté
célèbre les trognes des bedeaux et des croque-morts
d’Ornans, des paysans du Retour de la Foire, des Cas-
seurs de pierres ou les formes puissantes des beautés
francomtoises qu’il surprend au bain sur les bords de
la Loue. Les protestations que soulevèrent ces pein-
tures étonnent aujourd’hui : à la vérité elles s’adres-
(1) Voir Gazette des Beaux-Arts, mai 1921, p. 327.
(2) Voir Gazette des Beaux-Arts, 1900, t. Il, p. 291.