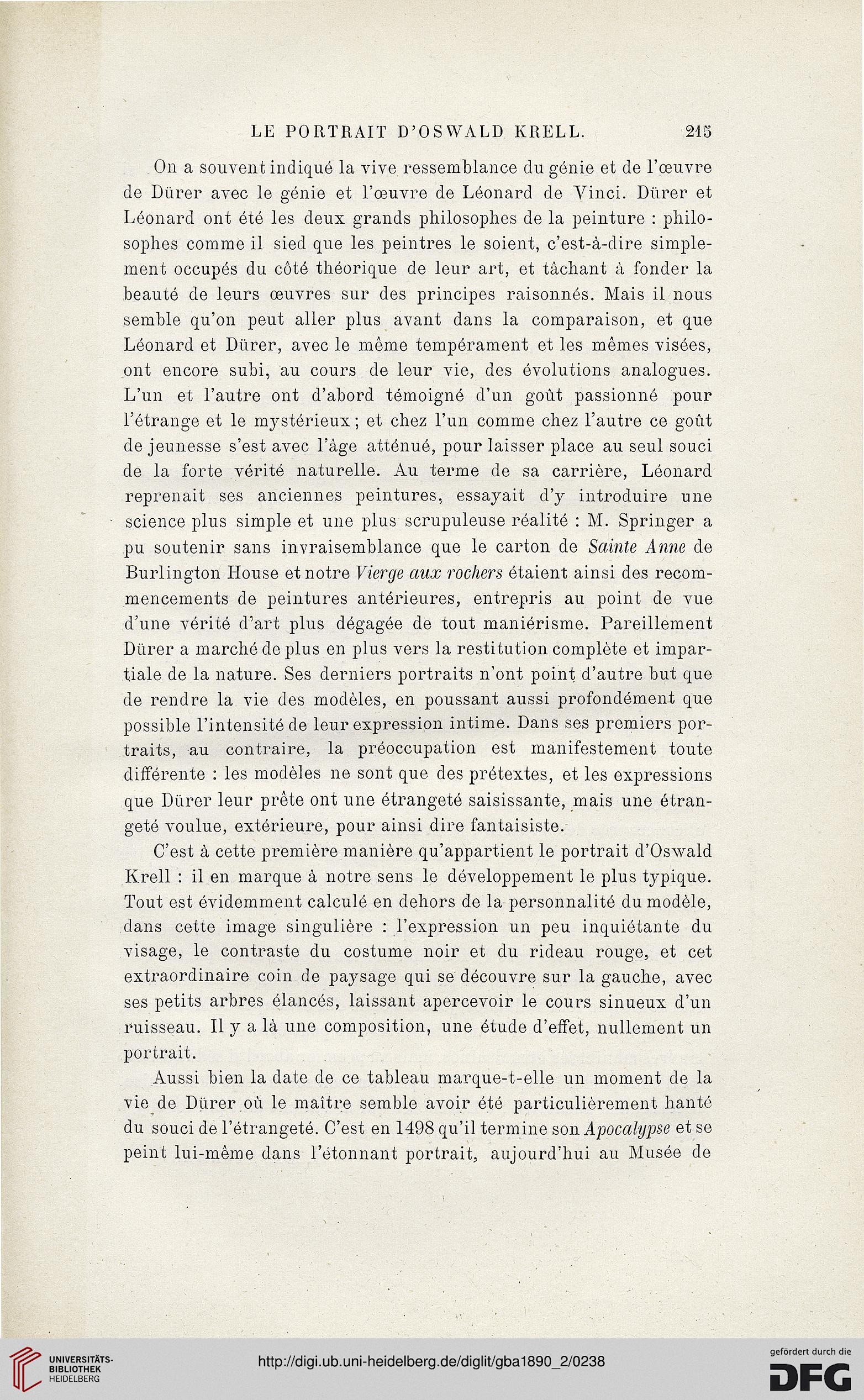LE PORTRAIT D’OSYVALD KRELL.
215
On a souvent indiqué la vive ressemblance du génie et de l’œuvre
de Dürer avec le génie et l’œuvre de Léonard de Vinci. Dürer et
Léonard ont été les deux grands philosophes de la peinture : philo-
sophes comme il sied que les peintres le soient, c’est-à-dire simple-
ment occupés du côté théorique de leur art, et tâchant à fonder la
beauté de leurs œuvres sur des principes raisonnés. Mais il nous
semble qu’on peut aller plus avant dans la comparaison, et que
Léonard et Durer, avec le même tempérament et les mêmes visées,
ont encore subi, au cours de leur vie, des évolutions analogues.
L’un et l’autre ont d’abord témoigné d’un goût passionné pour
l’étrange et le mystérieux ; et chez l’un comme chez l’autre ce goût
de jeunesse s’est avec l’âge atténué, pour laisser place au seul souci
de la forte vérité naturelle. Au terme de sa carrière, Léonard
reprenait ses anciennes peintures, essayait d’y introduire une
science plus simple et une plus scrupuleuse réalité : M. Springer a
pu soutenir sans invraisemblance que le carton de Sainte Anne de
Burlington House et notre Vierge aux rochers étaient ainsi des l’ecom-
mencements de peintures antérieures, entrepris au point de vue
d’une vérité d’art plus dégagée de tout maniérisme. Pareillement
Dürer a marché de plus en plus vers la restitution complète et impar-
tiale de la nature. Ses derniers portraits n’ont point d’autre but que
de rendre la vie des modèles, en poussant aussi profondément que
possible l’intensité de leur expression intime. Dans ses premiers por-
traits, au contraire, la préoccupation est manifestement toute
différente : les modèles ne sont que des prétextes, et les expressions
que Durer leur prête ont une étrangeté saisissante, mais une étran-
geté voulue, extérieure, pour ainsi dire fantaisiste.
C’est à cette première manière qu’appartient le portrait d’Oswald
Ivrell : il en marque à notre sens le développement le plus typique.
Tout est évidemment calculé en dehors de la personnalité du modèle,
dans cette image singulière : l’expression un peu inquiétante du
visage, le contraste du costume noir et du rideau rouge, et cet
extraordinaire coin de paysage qui se découvre sur la gauche, avec
ses petits arbres élancés, laissant apercevoir le cours sinueux d’un
ruisseau. Il y a là une composition, une étude d’effet, nullement un
portrait.
Aussi bien la date de ce tableau marque-t-elle un moment de la
vie de Durer où le maître semble avoir été particulièrement hanté
du souci de l’étrangeté. C’est en 1498 qu’il termine son Apocalypse et se
peint lui-même dans l’étonnant portrait, aujourd’hui au Musée de
215
On a souvent indiqué la vive ressemblance du génie et de l’œuvre
de Dürer avec le génie et l’œuvre de Léonard de Vinci. Dürer et
Léonard ont été les deux grands philosophes de la peinture : philo-
sophes comme il sied que les peintres le soient, c’est-à-dire simple-
ment occupés du côté théorique de leur art, et tâchant à fonder la
beauté de leurs œuvres sur des principes raisonnés. Mais il nous
semble qu’on peut aller plus avant dans la comparaison, et que
Léonard et Durer, avec le même tempérament et les mêmes visées,
ont encore subi, au cours de leur vie, des évolutions analogues.
L’un et l’autre ont d’abord témoigné d’un goût passionné pour
l’étrange et le mystérieux ; et chez l’un comme chez l’autre ce goût
de jeunesse s’est avec l’âge atténué, pour laisser place au seul souci
de la forte vérité naturelle. Au terme de sa carrière, Léonard
reprenait ses anciennes peintures, essayait d’y introduire une
science plus simple et une plus scrupuleuse réalité : M. Springer a
pu soutenir sans invraisemblance que le carton de Sainte Anne de
Burlington House et notre Vierge aux rochers étaient ainsi des l’ecom-
mencements de peintures antérieures, entrepris au point de vue
d’une vérité d’art plus dégagée de tout maniérisme. Pareillement
Dürer a marché de plus en plus vers la restitution complète et impar-
tiale de la nature. Ses derniers portraits n’ont point d’autre but que
de rendre la vie des modèles, en poussant aussi profondément que
possible l’intensité de leur expression intime. Dans ses premiers por-
traits, au contraire, la préoccupation est manifestement toute
différente : les modèles ne sont que des prétextes, et les expressions
que Durer leur prête ont une étrangeté saisissante, mais une étran-
geté voulue, extérieure, pour ainsi dire fantaisiste.
C’est à cette première manière qu’appartient le portrait d’Oswald
Ivrell : il en marque à notre sens le développement le plus typique.
Tout est évidemment calculé en dehors de la personnalité du modèle,
dans cette image singulière : l’expression un peu inquiétante du
visage, le contraste du costume noir et du rideau rouge, et cet
extraordinaire coin de paysage qui se découvre sur la gauche, avec
ses petits arbres élancés, laissant apercevoir le cours sinueux d’un
ruisseau. Il y a là une composition, une étude d’effet, nullement un
portrait.
Aussi bien la date de ce tableau marque-t-elle un moment de la
vie de Durer où le maître semble avoir été particulièrement hanté
du souci de l’étrangeté. C’est en 1498 qu’il termine son Apocalypse et se
peint lui-même dans l’étonnant portrait, aujourd’hui au Musée de