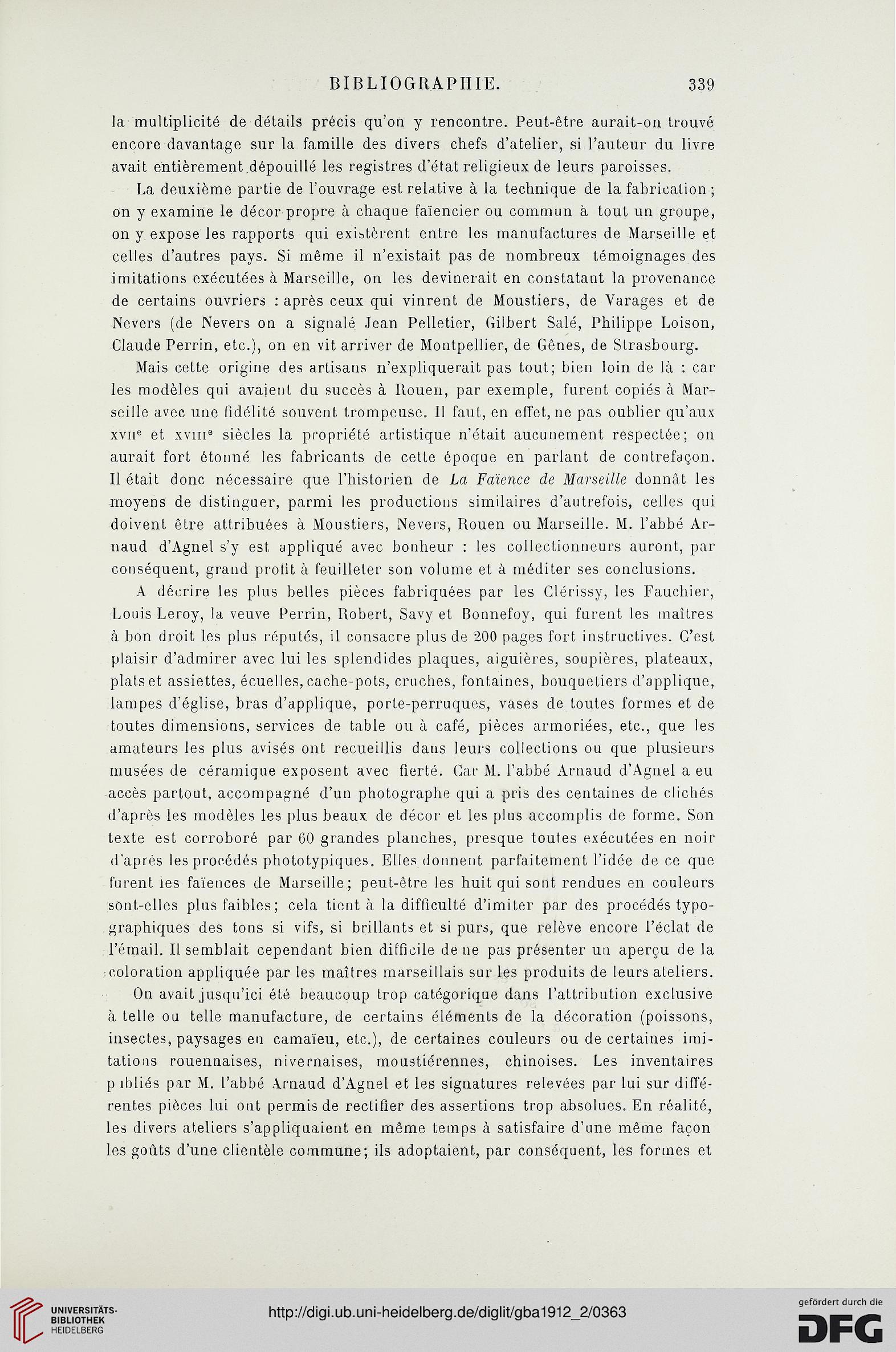BIBLIOGRAPHIE.
339
la multiplicité de détails précis qu’on y rencontre. Peut-être aurait-on trouvé
encore davantage sur la famille des divers chefs d’atelier, si l’auteur du livre
avait entièrement dépouillé les registres d’état religieux de leurs paroisses.
La deuxième partie de l’ouvrage est relative à la technique de la fabrication;
on y examine le décor propre à chaque faïencier ou commun à tout un groupe,
on y expose les rapports qui existèrent entre les manufactures de Marseille et
celles d’autres pays. Si même il n’existait pas de nombreux témoignages des
imitations exécutées à Marseille, on les devinerait en constatant la provenance
de certains ouvriers : après ceux qui vinrent de Moustiers, de Varages et de
Nevers (de Nevers on a signalé Jean Pelletier, Gilbert Salé, Philippe Loison,
Claude Perrin, etc.), on en vit arriver de Montpellier, de Gênes, de Strasbourg.
Mais cette origine des artisans n’expliquerait pas tout; bien loin de là : car
les modèles qui avaient du succès à Rouen, par exemple, furent copiés à Mar-
seille avec une fidélité souvent trompeuse. Il faut, en effet, ne pas oublier qu’aux
xvne et xvme siècles la propriété artistique n’était aucunement respectée; on
aurait fort étonné les fabricants de cette époque en parlant de contrefaçon.
Il était donc nécessaire que l’historien de La Faïence de Marseille donnât les
moyens de distinguer, parmi les productions similaires d’autrefois, celles qui
doivent être attribuées à Moustiers, Nevers, Rouen ou Marseille. M. l’abbé Ar-
naud d’Agnel s’y est appliqué avec bonheur : les collectionneurs auront, par
conséquent, grand prolit à feuilleter son volume et à méditer ses conclusions.
A décrire les plus belles pièces fabriquées par les Clérissy, les Fauchier,
Louis Leroy, la veuve Perrin, Robert, Savy et Bonnefoy, qui furent les maîtres
à bon droit les plus réputés, il consacre plus de 200 pages fort instructives. C’est
plaisir d’admirer avec lui les splendides plaques, aiguières, soupières, plateaux,
plats et assiettes, écuelles, cache-pots, cruches, fontaines, bouqueliers d’applique,
lampes d’église, bras d’applique, porte-perruques, vases de toutes formes et de
toutes dimensions, services de table ou à café, pièces armoriées, etc., que les
amateurs les plus avisés ont recueillis dans leurs collections ou que plusieurs
musées de céramique exposent avec fierté. Car M. l’abbé Arnaud d’Agnel a eu
accès partout, accompagné d’un photographe qui a pris des centaines de clichés
d’après les modèles les plus beaux de décor et les plus accomplis de forme. Son
texte est corroboré par 60 grandes planches, presque toutes exécutées en noir
d'après les procédés phototypiques. Elles donnent parfaitement l’idée de ce que
furent les faïences de Marseille; peut-être les huit qui sont rendues en couleurs
sont-elles plus faibles; cela tient à la difficulté d’imiter par des procédés typo-
graphiques des tons si vifs, si brillants et si purs, que relève encore l’éclat de
l’émail. Il semblait cependant bien difficile de ne pas présenter un aperçu de la
coloration appliquée par les maîtres marseillais sur les produits de leurs ateliers.
On avait jusqu’ici été beaucoup trop catégorique dans l’attribution exclusive
à telle ou telle manufacture, de certains éléments de la décoration (poissons,
insectes, paysages eu camaïeu, etc.), de certaines couleurs ou de certaines imi-
tations rouennaises, nivernaises, moustiérennes, chinoises. Les inventaires
p îbliés par M. l’abbé Arnaud d’Agnel et les signatures relevées par lui sur diffé-
rentes pièces lui ont permis de rectifier des assertions trop absolues. En réalité,
les divers ateliers s’appliquaient en même temps à satisfaire d’une même façon
les goûts d’une clientèle commune; ils adoptaient, par conséquent, les formes et
339
la multiplicité de détails précis qu’on y rencontre. Peut-être aurait-on trouvé
encore davantage sur la famille des divers chefs d’atelier, si l’auteur du livre
avait entièrement dépouillé les registres d’état religieux de leurs paroisses.
La deuxième partie de l’ouvrage est relative à la technique de la fabrication;
on y examine le décor propre à chaque faïencier ou commun à tout un groupe,
on y expose les rapports qui existèrent entre les manufactures de Marseille et
celles d’autres pays. Si même il n’existait pas de nombreux témoignages des
imitations exécutées à Marseille, on les devinerait en constatant la provenance
de certains ouvriers : après ceux qui vinrent de Moustiers, de Varages et de
Nevers (de Nevers on a signalé Jean Pelletier, Gilbert Salé, Philippe Loison,
Claude Perrin, etc.), on en vit arriver de Montpellier, de Gênes, de Strasbourg.
Mais cette origine des artisans n’expliquerait pas tout; bien loin de là : car
les modèles qui avaient du succès à Rouen, par exemple, furent copiés à Mar-
seille avec une fidélité souvent trompeuse. Il faut, en effet, ne pas oublier qu’aux
xvne et xvme siècles la propriété artistique n’était aucunement respectée; on
aurait fort étonné les fabricants de cette époque en parlant de contrefaçon.
Il était donc nécessaire que l’historien de La Faïence de Marseille donnât les
moyens de distinguer, parmi les productions similaires d’autrefois, celles qui
doivent être attribuées à Moustiers, Nevers, Rouen ou Marseille. M. l’abbé Ar-
naud d’Agnel s’y est appliqué avec bonheur : les collectionneurs auront, par
conséquent, grand prolit à feuilleter son volume et à méditer ses conclusions.
A décrire les plus belles pièces fabriquées par les Clérissy, les Fauchier,
Louis Leroy, la veuve Perrin, Robert, Savy et Bonnefoy, qui furent les maîtres
à bon droit les plus réputés, il consacre plus de 200 pages fort instructives. C’est
plaisir d’admirer avec lui les splendides plaques, aiguières, soupières, plateaux,
plats et assiettes, écuelles, cache-pots, cruches, fontaines, bouqueliers d’applique,
lampes d’église, bras d’applique, porte-perruques, vases de toutes formes et de
toutes dimensions, services de table ou à café, pièces armoriées, etc., que les
amateurs les plus avisés ont recueillis dans leurs collections ou que plusieurs
musées de céramique exposent avec fierté. Car M. l’abbé Arnaud d’Agnel a eu
accès partout, accompagné d’un photographe qui a pris des centaines de clichés
d’après les modèles les plus beaux de décor et les plus accomplis de forme. Son
texte est corroboré par 60 grandes planches, presque toutes exécutées en noir
d'après les procédés phototypiques. Elles donnent parfaitement l’idée de ce que
furent les faïences de Marseille; peut-être les huit qui sont rendues en couleurs
sont-elles plus faibles; cela tient à la difficulté d’imiter par des procédés typo-
graphiques des tons si vifs, si brillants et si purs, que relève encore l’éclat de
l’émail. Il semblait cependant bien difficile de ne pas présenter un aperçu de la
coloration appliquée par les maîtres marseillais sur les produits de leurs ateliers.
On avait jusqu’ici été beaucoup trop catégorique dans l’attribution exclusive
à telle ou telle manufacture, de certains éléments de la décoration (poissons,
insectes, paysages eu camaïeu, etc.), de certaines couleurs ou de certaines imi-
tations rouennaises, nivernaises, moustiérennes, chinoises. Les inventaires
p îbliés par M. l’abbé Arnaud d’Agnel et les signatures relevées par lui sur diffé-
rentes pièces lui ont permis de rectifier des assertions trop absolues. En réalité,
les divers ateliers s’appliquaient en même temps à satisfaire d’une même façon
les goûts d’une clientèle commune; ils adoptaient, par conséquent, les formes et