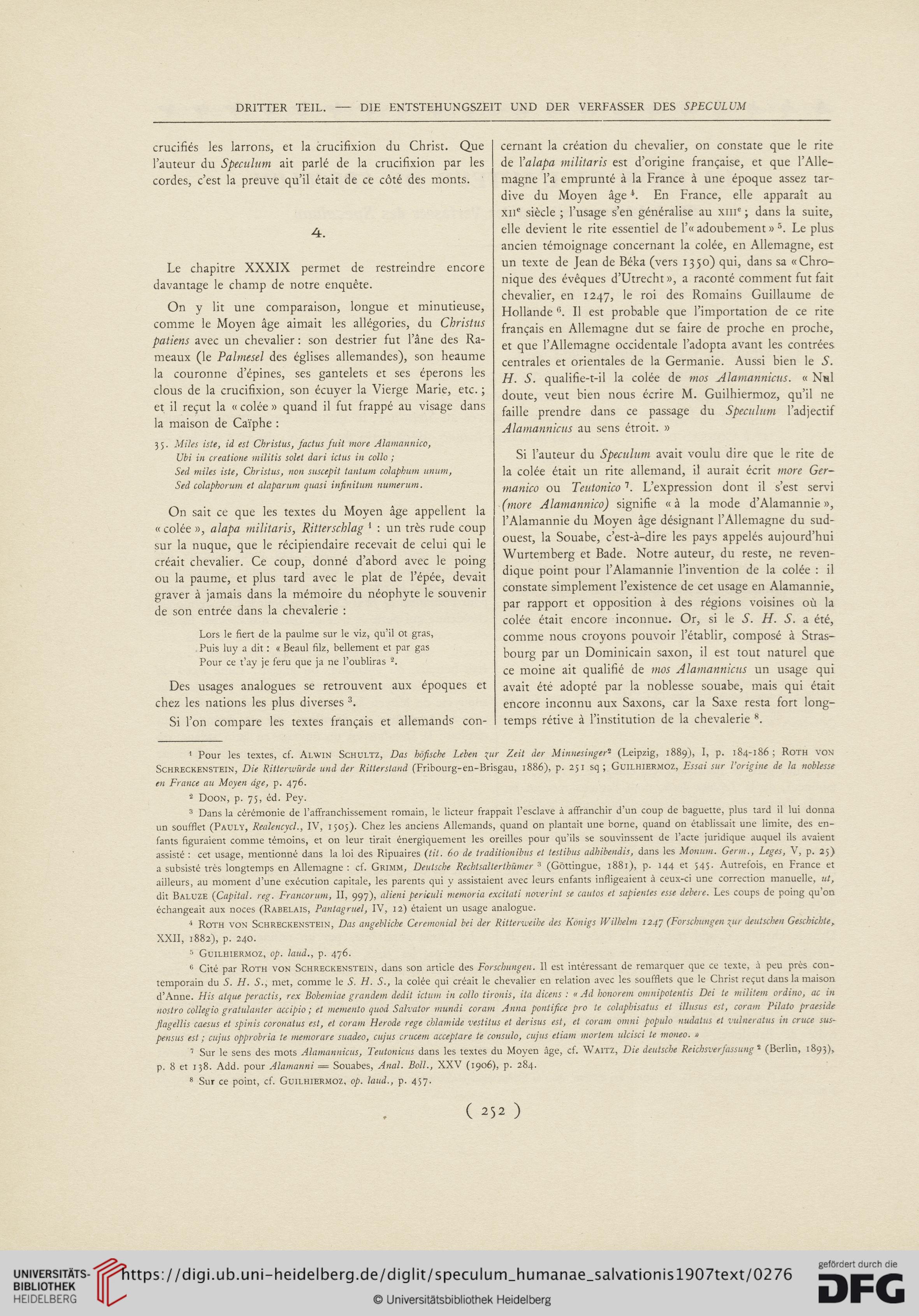DRITTER TEIL.
DIE ENTSTEHUNGSZEIT UND DER VERFASSER DES SPECULUM
crucifiés les larrons, et la crucifixion du Christ. Que
l’auteur du Speculum ait parlé de la crucifixion par les
cordes, c’est la preuve qu’il était de ce côté des monts.
4.
Le chapitre XXXIX permet de restreindre encore
davantage le champ de notre enquête.
On y lit une comparaison, longue et minutieuse,
comme le Moyen âge aimait les allégories, du Christus
patiens avec un chevalier : son destrier fut l’âne des Ra-
meaux (le Palmesel des églises allemandes), son heaume
la couronne d’épines, ses gantelets et ses éperons les
clous de la crucifixion, son écuyer la Vierge Marie, etc. ;
et il reçut la « colée » quand il fut frappé au visage dans
la maison de Caïphe :
35. Miles iste, id est Christus, factus fuit more Alamannico,
Ubi in creatione militis solet dari ictus in collo ;
Sed miles iste, Christus, non suscepit tantum colaphum unum,
Sed colaphorum et alaparum quasi infinitum numerum.
On sait ce que les textes du Moyen âge appellent la
« colée », alapa militaris, Ritterschlag 1 : un très rude coup
sur la nuque, que le récipiendaire recevait de celui qui le
créait chevalier. Ce coup, donné d’abord avec le poing
ou la paume, et plus tard avec le plat de l’épée, devait
graver à jamais dans la mémoire du néophyte le souvenir
de son entrée dans la chevalerie :
Lors le fiert de la paulme sur le viz, qu’il ot gras,
Puis luy a dit : « Beaul filz, bellement et par gas
Pour ce t’ay je féru que ja ne l’oubliras 2.
Des usages analogues se retrouvent aux époques et
chez les nations les plus diverses 3 4.
Si l’on compare les textes français et allemands con-
cernant la création du chevalier, on constate que le rite
de (alapa militaris est d’origine française, et que l’Alle-
magne l’a emprunté à la France à une époque assez tar-
dive du Moyen âgei. En France, elle apparaît au
xne siècle ; l’usage s’en généralise au xme ; dans la suite,
elle devient le rite essentiel de 1’« adoubement » 5. Le plus
ancien témoignage concernant la colée, en Allemagne, est
un texte de Jean de Béka (vers 1350) qui, dans sa «Chro-
nique des évêques d’Utrecht», a raconté comment fut fait
chevalier, en 1247, le roi des Romains Guillaume de
Hollande 6. Il est probable que l’importation de ce rite
français en Allemagne dut se faire de proche en proche,
et que l’Allemagne occidentale l’adopta avant les contrées
centrales et orientales de la Germanie. Aussi bien le S.
H. S. qualifie-t-il la colée de mos Alamannicus. « Nul
doute, veut bien nous écrire M. Guilhiermoz, qu’il ne
faille prendre dans ce passage du Speculum l’adjectif
Alamannicus au sens étroit. »
Si l’auteur du Speculum avait voulu dire que le rite de
la colée était un rite allemand, il aurait écrit more Ger-
manico ou Teutonico7. L’expression dont il s’est servi
(more Alamannico) signifie «à la mode d’Alamannie »,
l’Alamannie du Moyen âge désignant l’Allemagne du sud-
ouest, la Souabe, c’est-à-dire les pays appelés aujourd’hui
Wurtemberg et Bade. Notre auteur, du reste, ne reven-
dique point pour l’Alamannie l’invention de la colée : il
constate simplement l’existence de cet usage en Alamannie,
par rapport et opposition à des régions voisines où la
colée était encore inconnue. Or, si le 5. H. S. a été,
comme nous croyons pouvoir l’établir, composé à Stras-
bourg par un Dominicain saxon, il est tout naturel que
ce moine ait qualifié de mos Alamannicus un usage qui
avait été adopté par la noblesse souabe, mais qui était
encore inconnu aux Saxons, car la Saxe resta fort long-
temps rétive à l’institution de la chevalerie 8.
1 Pour les textes, cf. Alwin Schultz, Das höfische Leben ^ur Zeit der Minnesinger^ (Leipzig, 1889), I, p. 184-186; Roth von
Schreckenstein, Die Ritterwürde und der Rittersland (Fribourg-en-Brisgau, 1886), p. 251 sq ; Guilhiermoz, Essai sur l’origine de la noblesse
en France au Moyen âge, p. 476.
2 Doon, p. 75, éd. Pey.
3 Dans la cérémonie de l’affranchissement romain, le licteur frappait l’esclave à affranchir d’un coup de baguette, plus tard il lui donna
un soufflet (Pauly, Realencycl., IV, 1505). Chez les anciens Allemands, quand on plantait une borne, quand on établissait une limite, des en-
fants figuraient comme témoins, et on leur tirait énergiquement les oreilles pour qu’ils se souvinssent de l’acte juridique auquel ils avaient
assisté : cet usage, mentionné dans la loi des Ripuaires (tit. 60 de traditionibus et testibus adhibendis, dans les Monum. Germ., Leges, V, p. 25)
a subsisté très longtemps en Allemagne : cf. Grimm, Deutsche Rechtsalterthümer 3 (Gôttingue, 1881), p. 144 et 545. Autrefois, en France et
ailleurs, au moment d’une exécution capitale, les parents qui y assistaient avec leurs enfants infligeaient à ceux-ci une correction manuelle, ut,
dit Baluze (Capital, reg. Francorum, II, 997), alieni periculi memoria excitati noverint se cautos et sapientes esse debere. Les coups de poing qu’on
échangeait aux noces (Rabelais, Pantagruel, IV, 12) étaient un usage analogue.
4 Roth von Schreckenstein, Das angebliche Cérémonial bei der Ritterweihe des Königs Wilhelm 1247 (Forschungen ^ur deutschen Geschichte,
XXII, 1882), p. 240.
5 Guilhiermoz, op. laud., p. 476.
6 Cité par Roth von Schreckenstein, dans son article des Forschungen. Il est intéressant de remarquer que ce texte, à peu près con-
temporain du 5. H. S., met, comme le 5. H. S., la colée qui créait le chevalier en relation avec les soufflets que le Christ reçut dans la maison
d’Anne. His atque peractis, rex Bohemiae grandem dedit ictum in collo tironis, ita dicens : « Ad honorem omnipotentis Dei te militem ordino, ac in
nostro collegio gratulantor accipio ; et memento quod Salvator mundi coram Anna pontifice pro te colaphisatus et illusus est, coram Pilato praeside
flagellis caesus et spinis coronatus est, et coram Herode rege chlamide vestitus et derisus est, et coram omni populo nudatus et vulneratus in crtice sus-
pensus est ; cujus opprobria te memorare suadeo, cujus crucem acceptare te consulo, cujus etiam mortem ulcisci te moneo. »
7 Sur le sens des mots Alamannicus, Teutonicus dans les textes du Moyen âge, cf. Waitz, Die deutsche Reichsverfassung 2 (Berlin, 1893),
p. 8 et 138. Add. pour Alamanni — Souabes, Anal. Boll., XXV (1906), p. 284.
8 Sur ce point, cf. Guilhiermoz, op. laud., p. 457.
( 2)2 )
DIE ENTSTEHUNGSZEIT UND DER VERFASSER DES SPECULUM
crucifiés les larrons, et la crucifixion du Christ. Que
l’auteur du Speculum ait parlé de la crucifixion par les
cordes, c’est la preuve qu’il était de ce côté des monts.
4.
Le chapitre XXXIX permet de restreindre encore
davantage le champ de notre enquête.
On y lit une comparaison, longue et minutieuse,
comme le Moyen âge aimait les allégories, du Christus
patiens avec un chevalier : son destrier fut l’âne des Ra-
meaux (le Palmesel des églises allemandes), son heaume
la couronne d’épines, ses gantelets et ses éperons les
clous de la crucifixion, son écuyer la Vierge Marie, etc. ;
et il reçut la « colée » quand il fut frappé au visage dans
la maison de Caïphe :
35. Miles iste, id est Christus, factus fuit more Alamannico,
Ubi in creatione militis solet dari ictus in collo ;
Sed miles iste, Christus, non suscepit tantum colaphum unum,
Sed colaphorum et alaparum quasi infinitum numerum.
On sait ce que les textes du Moyen âge appellent la
« colée », alapa militaris, Ritterschlag 1 : un très rude coup
sur la nuque, que le récipiendaire recevait de celui qui le
créait chevalier. Ce coup, donné d’abord avec le poing
ou la paume, et plus tard avec le plat de l’épée, devait
graver à jamais dans la mémoire du néophyte le souvenir
de son entrée dans la chevalerie :
Lors le fiert de la paulme sur le viz, qu’il ot gras,
Puis luy a dit : « Beaul filz, bellement et par gas
Pour ce t’ay je féru que ja ne l’oubliras 2.
Des usages analogues se retrouvent aux époques et
chez les nations les plus diverses 3 4.
Si l’on compare les textes français et allemands con-
cernant la création du chevalier, on constate que le rite
de (alapa militaris est d’origine française, et que l’Alle-
magne l’a emprunté à la France à une époque assez tar-
dive du Moyen âgei. En France, elle apparaît au
xne siècle ; l’usage s’en généralise au xme ; dans la suite,
elle devient le rite essentiel de 1’« adoubement » 5. Le plus
ancien témoignage concernant la colée, en Allemagne, est
un texte de Jean de Béka (vers 1350) qui, dans sa «Chro-
nique des évêques d’Utrecht», a raconté comment fut fait
chevalier, en 1247, le roi des Romains Guillaume de
Hollande 6. Il est probable que l’importation de ce rite
français en Allemagne dut se faire de proche en proche,
et que l’Allemagne occidentale l’adopta avant les contrées
centrales et orientales de la Germanie. Aussi bien le S.
H. S. qualifie-t-il la colée de mos Alamannicus. « Nul
doute, veut bien nous écrire M. Guilhiermoz, qu’il ne
faille prendre dans ce passage du Speculum l’adjectif
Alamannicus au sens étroit. »
Si l’auteur du Speculum avait voulu dire que le rite de
la colée était un rite allemand, il aurait écrit more Ger-
manico ou Teutonico7. L’expression dont il s’est servi
(more Alamannico) signifie «à la mode d’Alamannie »,
l’Alamannie du Moyen âge désignant l’Allemagne du sud-
ouest, la Souabe, c’est-à-dire les pays appelés aujourd’hui
Wurtemberg et Bade. Notre auteur, du reste, ne reven-
dique point pour l’Alamannie l’invention de la colée : il
constate simplement l’existence de cet usage en Alamannie,
par rapport et opposition à des régions voisines où la
colée était encore inconnue. Or, si le 5. H. S. a été,
comme nous croyons pouvoir l’établir, composé à Stras-
bourg par un Dominicain saxon, il est tout naturel que
ce moine ait qualifié de mos Alamannicus un usage qui
avait été adopté par la noblesse souabe, mais qui était
encore inconnu aux Saxons, car la Saxe resta fort long-
temps rétive à l’institution de la chevalerie 8.
1 Pour les textes, cf. Alwin Schultz, Das höfische Leben ^ur Zeit der Minnesinger^ (Leipzig, 1889), I, p. 184-186; Roth von
Schreckenstein, Die Ritterwürde und der Rittersland (Fribourg-en-Brisgau, 1886), p. 251 sq ; Guilhiermoz, Essai sur l’origine de la noblesse
en France au Moyen âge, p. 476.
2 Doon, p. 75, éd. Pey.
3 Dans la cérémonie de l’affranchissement romain, le licteur frappait l’esclave à affranchir d’un coup de baguette, plus tard il lui donna
un soufflet (Pauly, Realencycl., IV, 1505). Chez les anciens Allemands, quand on plantait une borne, quand on établissait une limite, des en-
fants figuraient comme témoins, et on leur tirait énergiquement les oreilles pour qu’ils se souvinssent de l’acte juridique auquel ils avaient
assisté : cet usage, mentionné dans la loi des Ripuaires (tit. 60 de traditionibus et testibus adhibendis, dans les Monum. Germ., Leges, V, p. 25)
a subsisté très longtemps en Allemagne : cf. Grimm, Deutsche Rechtsalterthümer 3 (Gôttingue, 1881), p. 144 et 545. Autrefois, en France et
ailleurs, au moment d’une exécution capitale, les parents qui y assistaient avec leurs enfants infligeaient à ceux-ci une correction manuelle, ut,
dit Baluze (Capital, reg. Francorum, II, 997), alieni periculi memoria excitati noverint se cautos et sapientes esse debere. Les coups de poing qu’on
échangeait aux noces (Rabelais, Pantagruel, IV, 12) étaient un usage analogue.
4 Roth von Schreckenstein, Das angebliche Cérémonial bei der Ritterweihe des Königs Wilhelm 1247 (Forschungen ^ur deutschen Geschichte,
XXII, 1882), p. 240.
5 Guilhiermoz, op. laud., p. 476.
6 Cité par Roth von Schreckenstein, dans son article des Forschungen. Il est intéressant de remarquer que ce texte, à peu près con-
temporain du 5. H. S., met, comme le 5. H. S., la colée qui créait le chevalier en relation avec les soufflets que le Christ reçut dans la maison
d’Anne. His atque peractis, rex Bohemiae grandem dedit ictum in collo tironis, ita dicens : « Ad honorem omnipotentis Dei te militem ordino, ac in
nostro collegio gratulantor accipio ; et memento quod Salvator mundi coram Anna pontifice pro te colaphisatus et illusus est, coram Pilato praeside
flagellis caesus et spinis coronatus est, et coram Herode rege chlamide vestitus et derisus est, et coram omni populo nudatus et vulneratus in crtice sus-
pensus est ; cujus opprobria te memorare suadeo, cujus crucem acceptare te consulo, cujus etiam mortem ulcisci te moneo. »
7 Sur le sens des mots Alamannicus, Teutonicus dans les textes du Moyen âge, cf. Waitz, Die deutsche Reichsverfassung 2 (Berlin, 1893),
p. 8 et 138. Add. pour Alamanni — Souabes, Anal. Boll., XXV (1906), p. 284.
8 Sur ce point, cf. Guilhiermoz, op. laud., p. 457.
( 2)2 )