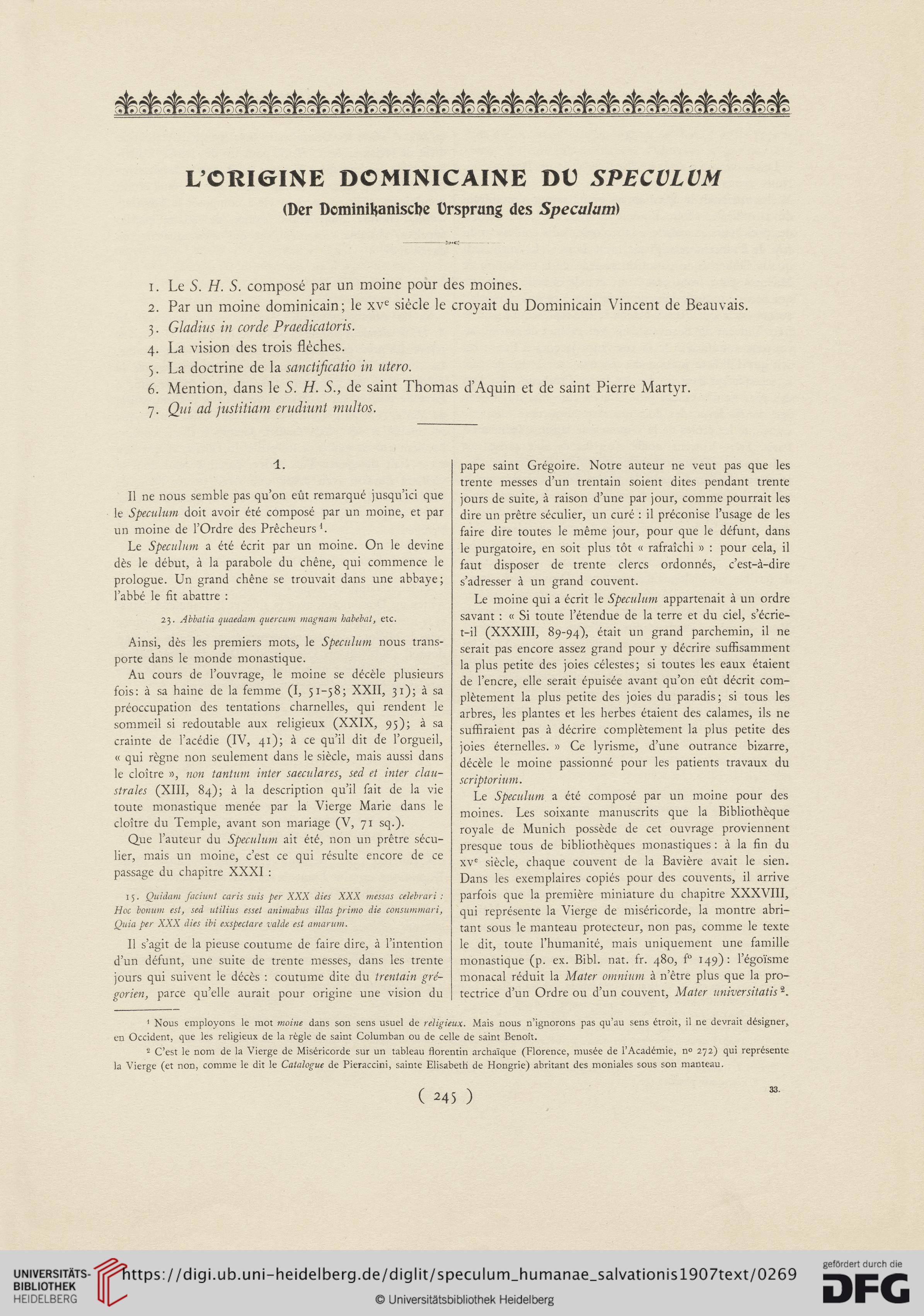L’ORIGINE DOMINICAINE DU SPECVLVM
(Der Dominicanische Ursprung des Speculum}
1.
2.
3-
4-
5-
6.
7-
Le S. H. S. composé par un moine pour des moines.
Par un moine dominicain; le xve siècle le croyait du Dominicain Vincent de Beauvais.
Gladius in corde Praedicatoris.
La vision des trois flèches.
La doctrine de la sanctificatio in utero.
Mention, dans le S. H. S., de saint Thomas d’Aquin et de saint Pierre Martyr.
Qui ad justitiam erudiunt multos.
1.
Il ne nous semble pas qu’on eût remarqué jusqu’ici que
le Speculum doit avoir été composé par un moine, et par
un moine de l’Ordre des Prêcheurs1.
Le Spéculum a été écrit par un moine. On le devine
dès le début, à la parabole du chêne, qui commence le
prologue. Un grand chêne se trouvait dans une abbaye;
l’abbé le fit abattre :
23. Abbatia quaedam quercum magnam habebat, etc.
Ainsi, dès les premiers mots, le Spéculum nous trans-
porte dans le monde monastique.
Au cours de l’ouvrage, le moine se décèle plusieurs
fois: à sa haine de la femme (I, 51-58; XXII, 31); à sa
préoccupation des tentations charnelles, qui rendent le
sommeil si redoutable aux religieux (XXIX, 95); à sa
crainte de l’acédie (IV, 41); à ce qu’il dit de l’orgueil,
« qui règne non seulement dans le siècle, mais aussi dans
le cloître », non tantum inter saeculares, sed et inter clau-
strales (XIII, 84); à la description qu’il fait de la vie
toute monastique menée par la Vierge Marie dans le
cloître du Temple, avant son mariage (V, 71 sq.).
Que l’auteur du Speculum ait été, non un prêtre sécu-
lier, mais un moine, c’est ce qui résulte encore de ce
passage du chapitre XXXI :
15. Quidam faciunt caris suis per XXX dies XXX messas celebrari :
Hoc bonum est, sed utilius esset animdbus illas primo die consummari,
Quia per XXX dies ibi exspectare valde est amarum.
Il s’agit de la pieuse coutume de faire dire, à l’intention
d’un défunt, une suite de trente messes, dans les trente
jours qui suivent le décès : coutume dite du trentain gré-
gorien, parce qu’elle aurait pour origine une vision du
pape saint Grégoire. Notre auteur ne veut pas que les
trente messes d’un trentain soient dites pendant trente
jours de suite, à raison d’une par jour, comme pourrait les
dire un prêtre séculier, un curé : il préconise l’usage de les
faire dire toutes le même jour, pour que le défunt, dans
le purgatoire, en soit plus tôt « rafraîchi » : pour cela, il
faut disposer de trente clercs ordonnés, c’est-à-dire
s’adresser à un grand couvent.
Le moine qui a écrit le Speculum appartenait à un ordre
savant : « Si toute l’étendue de la terre et du ciel, s’écrie-
t-il (XXXIII, 89-94), était un grand parchemin, il ne
serait pas encore assez grand pour y décrire suffisamment
la plus petite des joies célestes; si toutes les eaux étaient
de l’encre, elle serait épuisée avant qu’on eût décrit com-
plètement la plus petite des joies du paradis; si tous les
arbres, les plantes et les herbes étaient des calantes, ils ne
suffiraient pas à décrire complètement la plus petite des
joies éternelles. » Ce lyrisme, d’une outrance bizarre,
décèle le moine passionné pour les patients travaux du
scriptorium.
Le Speculum, a été composé par un moine pour des
moines. Les soixante manuscrits que la Bibliothèque
royale de Munich possède de cet ouvrage proviennent
presque tous de bibliothèques monastiques : à la fin du
xve siècle, chaque couvent de la Bavière avait le sien.
Dans les exemplaires copiés pour des couvents, il arrive
parfois que la première miniature du chapitre XXXVIII,
qui représente la Vierge de miséricorde, la montre abri-
tant sous le manteau protecteur, non pas, comme le texte
le dit, toute l’humanité, mais uniquement une famille
monastique (p. ex. Bibi. nat. fr. 480, f° 149): l’égoïsme
monacal réduit la Mater omnium à n’être plus que la pro-
tectrice d’un Ordre ou d’un couvent, Mater universitatis2.
1 Nous employons le mot moine dans son sens usuel de religieux. Mais nous n’ignorons pas qu’au sens étroit, il ne devrait désigner,
en Occident, que les religieux de la règle de saint Columban ou de celle de saint Benoît.
2 C’est le nom de la Vierge de Miséricorde sur un tableau florentin archaïque (Florence, musée de l’Académie, n° 272) qui représente
la Vierge (et non, comme le dit le Catalogue de Pieraccini, sainte Elisabeth de Hongrie) abritant des moniales sous son manteau.
( 245 )
33.
(Der Dominicanische Ursprung des Speculum}
1.
2.
3-
4-
5-
6.
7-
Le S. H. S. composé par un moine pour des moines.
Par un moine dominicain; le xve siècle le croyait du Dominicain Vincent de Beauvais.
Gladius in corde Praedicatoris.
La vision des trois flèches.
La doctrine de la sanctificatio in utero.
Mention, dans le S. H. S., de saint Thomas d’Aquin et de saint Pierre Martyr.
Qui ad justitiam erudiunt multos.
1.
Il ne nous semble pas qu’on eût remarqué jusqu’ici que
le Speculum doit avoir été composé par un moine, et par
un moine de l’Ordre des Prêcheurs1.
Le Spéculum a été écrit par un moine. On le devine
dès le début, à la parabole du chêne, qui commence le
prologue. Un grand chêne se trouvait dans une abbaye;
l’abbé le fit abattre :
23. Abbatia quaedam quercum magnam habebat, etc.
Ainsi, dès les premiers mots, le Spéculum nous trans-
porte dans le monde monastique.
Au cours de l’ouvrage, le moine se décèle plusieurs
fois: à sa haine de la femme (I, 51-58; XXII, 31); à sa
préoccupation des tentations charnelles, qui rendent le
sommeil si redoutable aux religieux (XXIX, 95); à sa
crainte de l’acédie (IV, 41); à ce qu’il dit de l’orgueil,
« qui règne non seulement dans le siècle, mais aussi dans
le cloître », non tantum inter saeculares, sed et inter clau-
strales (XIII, 84); à la description qu’il fait de la vie
toute monastique menée par la Vierge Marie dans le
cloître du Temple, avant son mariage (V, 71 sq.).
Que l’auteur du Speculum ait été, non un prêtre sécu-
lier, mais un moine, c’est ce qui résulte encore de ce
passage du chapitre XXXI :
15. Quidam faciunt caris suis per XXX dies XXX messas celebrari :
Hoc bonum est, sed utilius esset animdbus illas primo die consummari,
Quia per XXX dies ibi exspectare valde est amarum.
Il s’agit de la pieuse coutume de faire dire, à l’intention
d’un défunt, une suite de trente messes, dans les trente
jours qui suivent le décès : coutume dite du trentain gré-
gorien, parce qu’elle aurait pour origine une vision du
pape saint Grégoire. Notre auteur ne veut pas que les
trente messes d’un trentain soient dites pendant trente
jours de suite, à raison d’une par jour, comme pourrait les
dire un prêtre séculier, un curé : il préconise l’usage de les
faire dire toutes le même jour, pour que le défunt, dans
le purgatoire, en soit plus tôt « rafraîchi » : pour cela, il
faut disposer de trente clercs ordonnés, c’est-à-dire
s’adresser à un grand couvent.
Le moine qui a écrit le Speculum appartenait à un ordre
savant : « Si toute l’étendue de la terre et du ciel, s’écrie-
t-il (XXXIII, 89-94), était un grand parchemin, il ne
serait pas encore assez grand pour y décrire suffisamment
la plus petite des joies célestes; si toutes les eaux étaient
de l’encre, elle serait épuisée avant qu’on eût décrit com-
plètement la plus petite des joies du paradis; si tous les
arbres, les plantes et les herbes étaient des calantes, ils ne
suffiraient pas à décrire complètement la plus petite des
joies éternelles. » Ce lyrisme, d’une outrance bizarre,
décèle le moine passionné pour les patients travaux du
scriptorium.
Le Speculum, a été composé par un moine pour des
moines. Les soixante manuscrits que la Bibliothèque
royale de Munich possède de cet ouvrage proviennent
presque tous de bibliothèques monastiques : à la fin du
xve siècle, chaque couvent de la Bavière avait le sien.
Dans les exemplaires copiés pour des couvents, il arrive
parfois que la première miniature du chapitre XXXVIII,
qui représente la Vierge de miséricorde, la montre abri-
tant sous le manteau protecteur, non pas, comme le texte
le dit, toute l’humanité, mais uniquement une famille
monastique (p. ex. Bibi. nat. fr. 480, f° 149): l’égoïsme
monacal réduit la Mater omnium à n’être plus que la pro-
tectrice d’un Ordre ou d’un couvent, Mater universitatis2.
1 Nous employons le mot moine dans son sens usuel de religieux. Mais nous n’ignorons pas qu’au sens étroit, il ne devrait désigner,
en Occident, que les religieux de la règle de saint Columban ou de celle de saint Benoît.
2 C’est le nom de la Vierge de Miséricorde sur un tableau florentin archaïque (Florence, musée de l’Académie, n° 272) qui représente
la Vierge (et non, comme le dit le Catalogue de Pieraccini, sainte Elisabeth de Hongrie) abritant des moniales sous son manteau.
( 245 )
33.