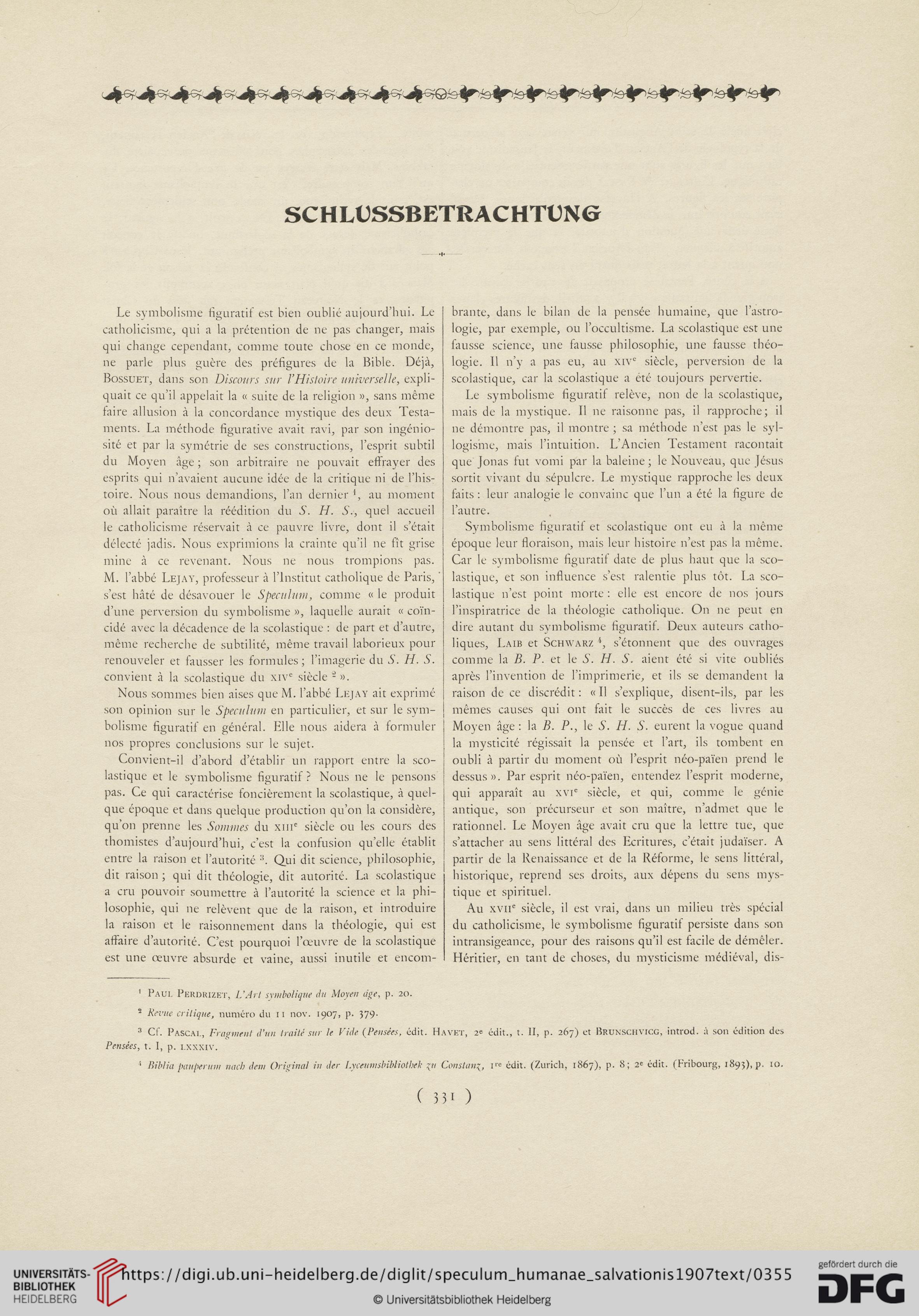SCHWSSBETRACHTUN6
Le symbolisme figuratif est bien oublié aujourd’hui. Le
catholicisme, qui a la prétention de ne pas changer, mais
qui change cependant, comme toute chose en ce monde,
ne parle plus guère des préfigures de la Bible. Déjà,
Bossuet, dans son Discours sur THistoire universelle, expli-
quait ce qu’il appelait la « suite de la religion », sans même
faire allusion à la concordance mystique des deux Testa-
ments. La méthode figurative avait ravi, par son ingénio-
sité et par la symétrie de ses constructions, l’esprit subtil
du Moyen âge ; son arbitraire ne pouvait effrayer des
esprits qui n’avaient aucune idée de la critique ni de l’his-
toire. Nous nous demandions, l’an dernier ', au moment
où allait paraître la réédition du 5. H. S., quel accueil
le catholicisme réservait à ce pauvre livre, dont il s’était
délecté jadis. Nous exprimions la crainte qu’il ne fît grise
mine à ce revenant. Nous ne nous trompions pas.
M. l’abbé Lejay, professeur à l’institut catholique de Paris,
s’est hâté de désavouer le Speculum, comme « le produit
d’une perversion du symbolisme », laquelle aurait « coïn-
cidé avec la décadence de la scolastique : de part et d’autre,
même recherche de subtilité, même travail laborieux pour
renouveler et fausser les formules ; l’imagerie du 5. H. S.
convient à la scolastique du xive siècle - ».
Nous sommes bien aises que M. l’abbé Lejay ait exprimé
son opinion sur le Speculum en particulier, et sur le sym-
bolisme figuratif en général. Elle nous aidera à formuler
nos propres conclusions sur le sujet.
Convient-il d’abord d’établir un rapport entre la sco-
lastique et le symbolisme figuratif ? Nous ne le pensons
pas. Ce qui caractérise foncièrement la scolastique, à quel-
que époque et dans quelque production qu’on la considère,
qu’on prenne les Sommes du xme siècle ou les cours des
thomistes d’aujourd’hui, c’est la confusion qu’elle établit
entre la raison et l’autorité 1 2 3. Qui dit science, philosophie,
dit raison ; qui dit théologie, dit autorité. La scolastique
a cru pouvoir soumettre à l’autorité la science et la phi-
losophie, qui ne relèvent que de la raison, et introduire
la raison et le raisonnement dans la théologie, qui est
affaire d’autorité. C’est pourquoi l’œuvre de la scolastique
est une œuvre absurde et vaine, aussi inutile et encom-
brante, dans le bilan de la pensée humaine, que l’astro-
logie, par exemple, ou l’occultisme. La scolastique est une
fausse science, une fausse philosophie, une fausse théo-
logie. Il n’y a pas eu, au xive siècle, perversion de la
scolastique, car la scolastique a été toujours pervertie.
Le symbolisme figuratif relève, non de la scolastique,
mais de la mystique. Il ne raisonne pas, il rapproche; il
ne démontre pas, il montre ; sa méthode n’est pas le syl-
logisme, mais l’intuition. L’Ancien Testament racontait
que Jonas fut vomi par la baleine ; le Nouveau, que Jésus
sortit vivant du sépulcre. Le mystique rapproche les deux
faits : leur analogie le convainc que l’un a été la figure de
l’autre.
Symbolisme figuratif et scolastique ont eu à la même
époque leur floraison, mais leur histoire n’est pas la même.
Car le symbolisme figuratif date de plus haut que la sco-
lastique, et son influence s’est ralentie plus tôt. La sco-
lastique n’est point morte : elle est encore de nos jours
l’inspiratrice de la théologie catholique. On ne peut en
dire autant du symbolisme figuratif. Deux auteurs catho-
liques, Laib et Schwarz 4, s’étonnent que des ouvrages
comme la B. P. et le 5. H. S. aient été si vite oubliés
après l’invention de l’imprimerie, et ils se demandent la
raison de ce discrédit : « Il s’explique, disent-ils, par les
mêmes causes qui ont fait le succès de ces livres au
Moyen âge : la B. P., le 5. H. S. eurent la vogue quand
la mysticité régissait la pensée et l’art, ils tombent en
oubli à partir du moment où l’esprit néo-païen prend le
dessus». Par esprit néo-païen, entendez l’esprit moderne,
qui apparaît au XVIe siècle, et qui, comme le génie
antique, son précurseur et son maître, n’admet que le
rationnel. Le Moyen âge avait cru que la lettre tue, que
s’attacher au sens littéral des Ecritures, c’était judaïser. A
partir de la Renaissance et de la Réforme, le sens littéral,
historique, reprend ses droits, aux dépens du sens mys-
tique et spirituel.
Au xvne siècle, il est vrai, dans un milieu très spécial
du catholicisme, le symbolisme figuratif persiste dans son
intransigeance, pour des raisons qu’il est facile de démêler.
Héritier, en tant de choses, du mysticisme médiéval, dis-
1 Paul Perdrizet, L'Art symbolique du Moyen dge, p. 20.
2 Revue critique, numéro du 11 nov. 1907, p. 379.
3 Cf. Pascal, Fragment d’un traité sur le Vide {Pensées, édit. Havet, 2= édit., t. II, p. 267) et Brunschvicg, introd. à son édition des
Pensées, t. I, p. i.xxxiv.
'■ Biblia pauperum nach dem Original in der Lyceumsbibliothek gu Constant, ire édit. (Zurich, 1867), p. 8; 2« édit. (Fribourg, 1893), p. 10.
Le symbolisme figuratif est bien oublié aujourd’hui. Le
catholicisme, qui a la prétention de ne pas changer, mais
qui change cependant, comme toute chose en ce monde,
ne parle plus guère des préfigures de la Bible. Déjà,
Bossuet, dans son Discours sur THistoire universelle, expli-
quait ce qu’il appelait la « suite de la religion », sans même
faire allusion à la concordance mystique des deux Testa-
ments. La méthode figurative avait ravi, par son ingénio-
sité et par la symétrie de ses constructions, l’esprit subtil
du Moyen âge ; son arbitraire ne pouvait effrayer des
esprits qui n’avaient aucune idée de la critique ni de l’his-
toire. Nous nous demandions, l’an dernier ', au moment
où allait paraître la réédition du 5. H. S., quel accueil
le catholicisme réservait à ce pauvre livre, dont il s’était
délecté jadis. Nous exprimions la crainte qu’il ne fît grise
mine à ce revenant. Nous ne nous trompions pas.
M. l’abbé Lejay, professeur à l’institut catholique de Paris,
s’est hâté de désavouer le Speculum, comme « le produit
d’une perversion du symbolisme », laquelle aurait « coïn-
cidé avec la décadence de la scolastique : de part et d’autre,
même recherche de subtilité, même travail laborieux pour
renouveler et fausser les formules ; l’imagerie du 5. H. S.
convient à la scolastique du xive siècle - ».
Nous sommes bien aises que M. l’abbé Lejay ait exprimé
son opinion sur le Speculum en particulier, et sur le sym-
bolisme figuratif en général. Elle nous aidera à formuler
nos propres conclusions sur le sujet.
Convient-il d’abord d’établir un rapport entre la sco-
lastique et le symbolisme figuratif ? Nous ne le pensons
pas. Ce qui caractérise foncièrement la scolastique, à quel-
que époque et dans quelque production qu’on la considère,
qu’on prenne les Sommes du xme siècle ou les cours des
thomistes d’aujourd’hui, c’est la confusion qu’elle établit
entre la raison et l’autorité 1 2 3. Qui dit science, philosophie,
dit raison ; qui dit théologie, dit autorité. La scolastique
a cru pouvoir soumettre à l’autorité la science et la phi-
losophie, qui ne relèvent que de la raison, et introduire
la raison et le raisonnement dans la théologie, qui est
affaire d’autorité. C’est pourquoi l’œuvre de la scolastique
est une œuvre absurde et vaine, aussi inutile et encom-
brante, dans le bilan de la pensée humaine, que l’astro-
logie, par exemple, ou l’occultisme. La scolastique est une
fausse science, une fausse philosophie, une fausse théo-
logie. Il n’y a pas eu, au xive siècle, perversion de la
scolastique, car la scolastique a été toujours pervertie.
Le symbolisme figuratif relève, non de la scolastique,
mais de la mystique. Il ne raisonne pas, il rapproche; il
ne démontre pas, il montre ; sa méthode n’est pas le syl-
logisme, mais l’intuition. L’Ancien Testament racontait
que Jonas fut vomi par la baleine ; le Nouveau, que Jésus
sortit vivant du sépulcre. Le mystique rapproche les deux
faits : leur analogie le convainc que l’un a été la figure de
l’autre.
Symbolisme figuratif et scolastique ont eu à la même
époque leur floraison, mais leur histoire n’est pas la même.
Car le symbolisme figuratif date de plus haut que la sco-
lastique, et son influence s’est ralentie plus tôt. La sco-
lastique n’est point morte : elle est encore de nos jours
l’inspiratrice de la théologie catholique. On ne peut en
dire autant du symbolisme figuratif. Deux auteurs catho-
liques, Laib et Schwarz 4, s’étonnent que des ouvrages
comme la B. P. et le 5. H. S. aient été si vite oubliés
après l’invention de l’imprimerie, et ils se demandent la
raison de ce discrédit : « Il s’explique, disent-ils, par les
mêmes causes qui ont fait le succès de ces livres au
Moyen âge : la B. P., le 5. H. S. eurent la vogue quand
la mysticité régissait la pensée et l’art, ils tombent en
oubli à partir du moment où l’esprit néo-païen prend le
dessus». Par esprit néo-païen, entendez l’esprit moderne,
qui apparaît au XVIe siècle, et qui, comme le génie
antique, son précurseur et son maître, n’admet que le
rationnel. Le Moyen âge avait cru que la lettre tue, que
s’attacher au sens littéral des Ecritures, c’était judaïser. A
partir de la Renaissance et de la Réforme, le sens littéral,
historique, reprend ses droits, aux dépens du sens mys-
tique et spirituel.
Au xvne siècle, il est vrai, dans un milieu très spécial
du catholicisme, le symbolisme figuratif persiste dans son
intransigeance, pour des raisons qu’il est facile de démêler.
Héritier, en tant de choses, du mysticisme médiéval, dis-
1 Paul Perdrizet, L'Art symbolique du Moyen dge, p. 20.
2 Revue critique, numéro du 11 nov. 1907, p. 379.
3 Cf. Pascal, Fragment d’un traité sur le Vide {Pensées, édit. Havet, 2= édit., t. II, p. 267) et Brunschvicg, introd. à son édition des
Pensées, t. I, p. i.xxxiv.
'■ Biblia pauperum nach dem Original in der Lyceumsbibliothek gu Constant, ire édit. (Zurich, 1867), p. 8; 2« édit. (Fribourg, 1893), p. 10.