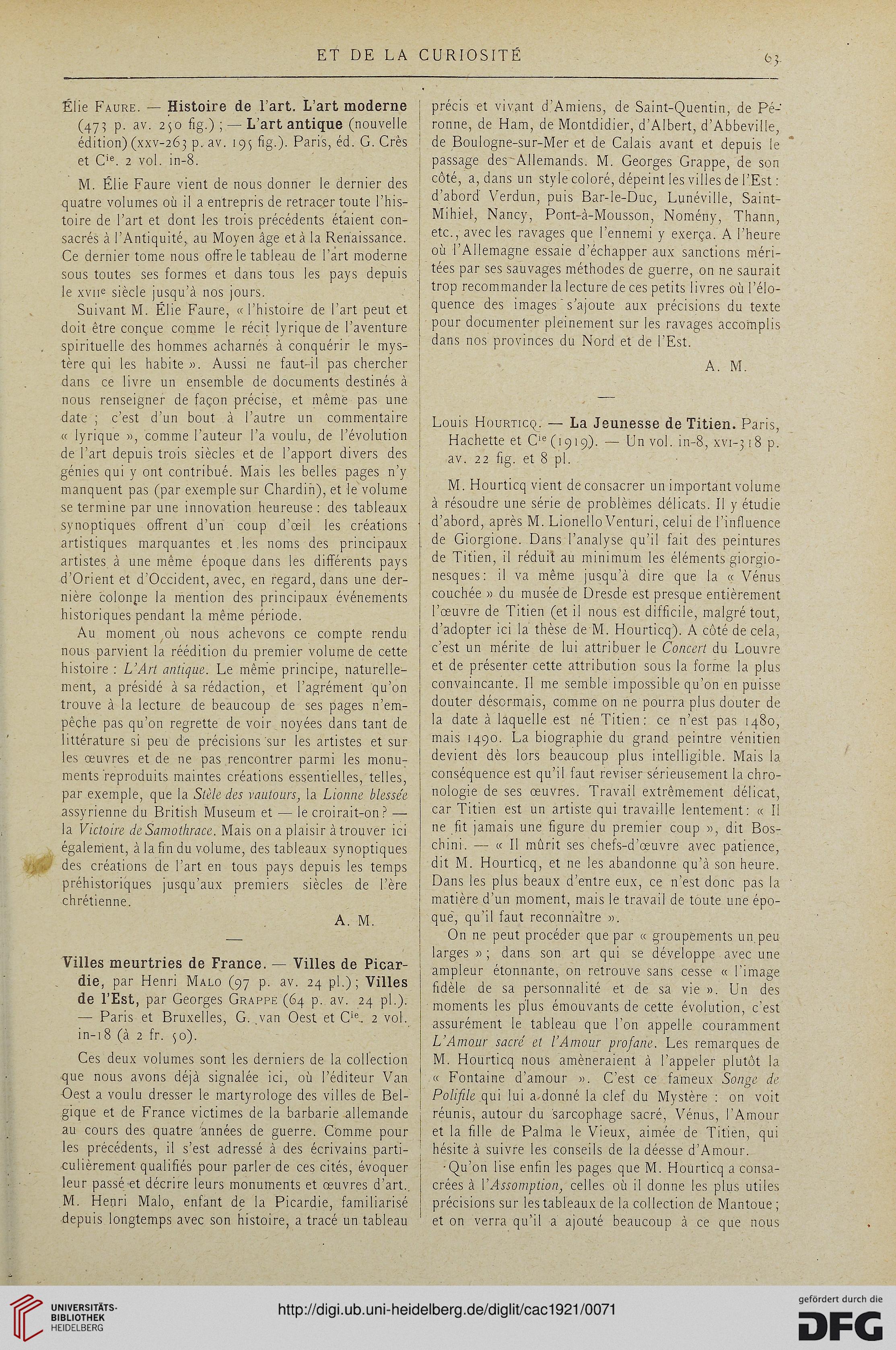ET DE LA CURIOSITÉ
H
Élie Faure. — Histoire de l’art. L’art moderne
(473 p. av. 250 fig.) ; — L’art antique (nouvelle
édition) (xxv-263 p. av. 195 fig.). Paris, éd. G. Crès :
et Cie. 2 vol. in-8.
M. Élie Faure vient de nous donner le dernier des
quatre volumes où il a entrepris de retracer toute l’his-
toire de l’art et dont les trois précédents étaient con-
sacrés à l’Antiquité, au Moyen âge et à la Renaissance.
Ce dernier tome nous offre le tableau de l’art moderne
sous toutes ses formes et dans tous les pays depuis
le xvne siècle jusqu’à nos jours.
Suivant M. Élie Faure, « l’histoire de l’art peut et
doit être conçue comme le récit lyrique de l’aventure |
spirituelle des hommes acharnés à conquérir le mys-
tère qui les habite ». Aussi ne faut-il pas chercher
dans ce livre un ensemble de documents destinés à
nous renseigner de façon précise, et même pas une
date ; c’est d’un bout à l’autre un commentaire
« lyrique », comme l’auteur l’a voulu, de l’évolution
de l’art depuis trois siècles et de l’apport divers des
génies qui y ont contribué. Mais les belles pages n’y
manquent pas (par exemple sur Chardin), et le volume
se termine par une innovation heureuse : des tableaux
synoptiques offrent d’un coup d’œil les créations
artistiques marquantes et.les noms des principaux .
artistes à une même époque dans les différents pays
d’Orient et d’Occident, avec, en regard, dans une der-
nière colonpe la mention des principaux événements
historiques pendant la même période.
Au moment où nous achevons ce compte rendu
nous parvient la réédition du premier volume de cette
histoire : L’Art antique. Le même principe, naturelle-
ment, a présidé à sa rédaction, et l’agrément qu’on
trouve à la lecture de beaucoup de ses pages n’em-
pêche pas qu’on regrette de voir,noyées dans tant de
littérature si peu de précisions sur les artistes et sur
les œuvres et de ne pas rencontrer parmi les monu7
ments reproduits maintes créations essentielles, telles,
par exemple, que la Stèle des vautours, la Lionne blessée
assyrienne du British Muséum et — le croirait-on? —-
la Victoire de Samothrace. Mais on a plaisir à trouver ici
également, à la fin du volume, des tableaux synoptiques
des créations de l’art en tous pays depuis les temps
préhistoriques jusqu’aux premiers siècles de l.’ère
chrétienne.
A. M.
Villes meurtries de France. — Villes de Picar-
die, par Henri Malo (97 p. av. 24 pl.) ; Villes
de l’Est, par Georges Grappe (64 p. av. 24 pl.).
— Paris et Bruxelles, G. .van Oest et Cie, 2 vol.
in-i8 (à 2 fr. 30).
Ces deux volumes sont les derniers de la collection
que nous avons déjà signalée ici, où l’éditeur Van
Oest a voulu dresser le martyrologe des villes de Bel-
gique et de France victimes de la barbarie allemande
au cours des quatre années de guerre. Comme pour
les précédents, il s’est adressé à des écrivains parti- j
culièrement qualifiés pour parler de ces cités, évoquer
leur passé-et décrire leurs monuments et œuvres d’art..
M. Henri Malo, enfant de la Picardie, familiarisé j
depuis longtemps avec son histoire, a tracé un tableau ;
précis et vivant d'Amiens, de Saint-Quentin, de Pé-
ronne, de Ham, de Montdidier, d’Albert, d’Abbeville,
de Boulogne-sur-Mer et de Calais avant et depuis le
passage des'Allemands. M. Georges Grappe, de son
côté, a, dans un style coloré, dépeint les villes de l’Est :
d’abord Verdun, puis Bar-le-Duc, Lunéville, Saint-
Mihiel-, Nancy, Porrt-à-Mousson, Nomény, Thann,
etc., avec les ravages que l’ennemi y exerça. A l’heure
où l’Allemagne essaie d’échapper aux sanctions méri-
tées par ses sauvages méthodes de guerre, on ne saurait
trop recommander la lecture de ces petits livres où l’élo-
quence des images ‘ s’ajoute aux précisions du texte
pour documenter pleinement sur les ravages accomplis
dans nos provinces du Nord et de l’Est.
A. M.
Louis Hourticq. — La Jeunesse de Titien. Paris,
Hachette et Cie (1919). — Un vol. in-8, xvi-318 p.
av. 22 fig. et 8 pl. .
M. Hourticq vient de consacrer un important volume
à résoudre une série de problèmes délicats. Il y étudie
d’abord, après M. Lionello Venturi, celui de l’influence
de Giorgione. Dans l’analyse qu’il fait des peintures
de Titien, il réduit au minimum les éléments giorgio-
nesques: il va même jusqu’à dire que la « Vénus
couchée » du musée de Dresde est presque entièrement
l’œuvre de Titien (et il nous est difficile, malgré tout,
d’adopter ici la thèse de M. Hourticq). A côté de cela,
c’est un mérite de lui attribuer le Concert du Louvre
et de présenter cette attribution sous la forme la plus
convaincante. Il me semble impossible qu’on en puisse
douter désormais, comme on ne pourra plus douter de
la date à laquelle est né Titien: ce n’est pas 1480,
mais 1490. La biographie du grand peintre vénitien
devient dès lors beaucoup plus intelligible. Mais la
conséquence est qu’il faut reviser sérieusement la chro-
nologie de ses œuvres. Travail extrêmement délicat,
car Titien est un artiste qui travaille lentement: « Il
ne fit jamais une figure du premier coup », dit Bos-
chini. — « Il mûrit ses chefs-d’œuvre avec patience,
dit M. Hourticq, et ne les abandonne qu’à son heure.
Dans les plus beaux d’entre eux, ce n’est donc pas la
matière d’un moment, mais le travail de toute une épo-
que', qu’il faut reconnaître ».
On ne peut procéder que par « groupements un peu
larges»; dans son art qui se développe avec une
ampleur étonnante, on retrouve sans cesse « l’image
fidèle de sa personnalité et de sa vie ». Un des
moments les plus émouvants de cette évolution, c’est
assurément le tableau que l’on appelle couramment
L’Amour sacré et l’Amour profane. Les remarques de
M. Hourticq nous amèneraient à l'appeler plutôt la
.« Fontaine d’amour ». C’est ce fameux Songe de
Polifile qui lui a-donné la clef du Mystère : on voit
réunis, autour du sarcophage sacré, Vénus, l’Amour
et la fille de Palma le Vieux, aimée de Titien, qui
hésite à suivre les conseils de la déesse d’Amour.
•Qu’on lise enfin les pages que M. Hourticq a consa-
crées à VAssomption, celles où il donne les plus utiles
précisions sur les tableaux de la collection de Mantoue ;
et on verra qu’il a ajouté beaucoup à ce que nous
H
Élie Faure. — Histoire de l’art. L’art moderne
(473 p. av. 250 fig.) ; — L’art antique (nouvelle
édition) (xxv-263 p. av. 195 fig.). Paris, éd. G. Crès :
et Cie. 2 vol. in-8.
M. Élie Faure vient de nous donner le dernier des
quatre volumes où il a entrepris de retracer toute l’his-
toire de l’art et dont les trois précédents étaient con-
sacrés à l’Antiquité, au Moyen âge et à la Renaissance.
Ce dernier tome nous offre le tableau de l’art moderne
sous toutes ses formes et dans tous les pays depuis
le xvne siècle jusqu’à nos jours.
Suivant M. Élie Faure, « l’histoire de l’art peut et
doit être conçue comme le récit lyrique de l’aventure |
spirituelle des hommes acharnés à conquérir le mys-
tère qui les habite ». Aussi ne faut-il pas chercher
dans ce livre un ensemble de documents destinés à
nous renseigner de façon précise, et même pas une
date ; c’est d’un bout à l’autre un commentaire
« lyrique », comme l’auteur l’a voulu, de l’évolution
de l’art depuis trois siècles et de l’apport divers des
génies qui y ont contribué. Mais les belles pages n’y
manquent pas (par exemple sur Chardin), et le volume
se termine par une innovation heureuse : des tableaux
synoptiques offrent d’un coup d’œil les créations
artistiques marquantes et.les noms des principaux .
artistes à une même époque dans les différents pays
d’Orient et d’Occident, avec, en regard, dans une der-
nière colonpe la mention des principaux événements
historiques pendant la même période.
Au moment où nous achevons ce compte rendu
nous parvient la réédition du premier volume de cette
histoire : L’Art antique. Le même principe, naturelle-
ment, a présidé à sa rédaction, et l’agrément qu’on
trouve à la lecture de beaucoup de ses pages n’em-
pêche pas qu’on regrette de voir,noyées dans tant de
littérature si peu de précisions sur les artistes et sur
les œuvres et de ne pas rencontrer parmi les monu7
ments reproduits maintes créations essentielles, telles,
par exemple, que la Stèle des vautours, la Lionne blessée
assyrienne du British Muséum et — le croirait-on? —-
la Victoire de Samothrace. Mais on a plaisir à trouver ici
également, à la fin du volume, des tableaux synoptiques
des créations de l’art en tous pays depuis les temps
préhistoriques jusqu’aux premiers siècles de l.’ère
chrétienne.
A. M.
Villes meurtries de France. — Villes de Picar-
die, par Henri Malo (97 p. av. 24 pl.) ; Villes
de l’Est, par Georges Grappe (64 p. av. 24 pl.).
— Paris et Bruxelles, G. .van Oest et Cie, 2 vol.
in-i8 (à 2 fr. 30).
Ces deux volumes sont les derniers de la collection
que nous avons déjà signalée ici, où l’éditeur Van
Oest a voulu dresser le martyrologe des villes de Bel-
gique et de France victimes de la barbarie allemande
au cours des quatre années de guerre. Comme pour
les précédents, il s’est adressé à des écrivains parti- j
culièrement qualifiés pour parler de ces cités, évoquer
leur passé-et décrire leurs monuments et œuvres d’art..
M. Henri Malo, enfant de la Picardie, familiarisé j
depuis longtemps avec son histoire, a tracé un tableau ;
précis et vivant d'Amiens, de Saint-Quentin, de Pé-
ronne, de Ham, de Montdidier, d’Albert, d’Abbeville,
de Boulogne-sur-Mer et de Calais avant et depuis le
passage des'Allemands. M. Georges Grappe, de son
côté, a, dans un style coloré, dépeint les villes de l’Est :
d’abord Verdun, puis Bar-le-Duc, Lunéville, Saint-
Mihiel-, Nancy, Porrt-à-Mousson, Nomény, Thann,
etc., avec les ravages que l’ennemi y exerça. A l’heure
où l’Allemagne essaie d’échapper aux sanctions méri-
tées par ses sauvages méthodes de guerre, on ne saurait
trop recommander la lecture de ces petits livres où l’élo-
quence des images ‘ s’ajoute aux précisions du texte
pour documenter pleinement sur les ravages accomplis
dans nos provinces du Nord et de l’Est.
A. M.
Louis Hourticq. — La Jeunesse de Titien. Paris,
Hachette et Cie (1919). — Un vol. in-8, xvi-318 p.
av. 22 fig. et 8 pl. .
M. Hourticq vient de consacrer un important volume
à résoudre une série de problèmes délicats. Il y étudie
d’abord, après M. Lionello Venturi, celui de l’influence
de Giorgione. Dans l’analyse qu’il fait des peintures
de Titien, il réduit au minimum les éléments giorgio-
nesques: il va même jusqu’à dire que la « Vénus
couchée » du musée de Dresde est presque entièrement
l’œuvre de Titien (et il nous est difficile, malgré tout,
d’adopter ici la thèse de M. Hourticq). A côté de cela,
c’est un mérite de lui attribuer le Concert du Louvre
et de présenter cette attribution sous la forme la plus
convaincante. Il me semble impossible qu’on en puisse
douter désormais, comme on ne pourra plus douter de
la date à laquelle est né Titien: ce n’est pas 1480,
mais 1490. La biographie du grand peintre vénitien
devient dès lors beaucoup plus intelligible. Mais la
conséquence est qu’il faut reviser sérieusement la chro-
nologie de ses œuvres. Travail extrêmement délicat,
car Titien est un artiste qui travaille lentement: « Il
ne fit jamais une figure du premier coup », dit Bos-
chini. — « Il mûrit ses chefs-d’œuvre avec patience,
dit M. Hourticq, et ne les abandonne qu’à son heure.
Dans les plus beaux d’entre eux, ce n’est donc pas la
matière d’un moment, mais le travail de toute une épo-
que', qu’il faut reconnaître ».
On ne peut procéder que par « groupements un peu
larges»; dans son art qui se développe avec une
ampleur étonnante, on retrouve sans cesse « l’image
fidèle de sa personnalité et de sa vie ». Un des
moments les plus émouvants de cette évolution, c’est
assurément le tableau que l’on appelle couramment
L’Amour sacré et l’Amour profane. Les remarques de
M. Hourticq nous amèneraient à l'appeler plutôt la
.« Fontaine d’amour ». C’est ce fameux Songe de
Polifile qui lui a-donné la clef du Mystère : on voit
réunis, autour du sarcophage sacré, Vénus, l’Amour
et la fille de Palma le Vieux, aimée de Titien, qui
hésite à suivre les conseils de la déesse d’Amour.
•Qu’on lise enfin les pages que M. Hourticq a consa-
crées à VAssomption, celles où il donne les plus utiles
précisions sur les tableaux de la collection de Mantoue ;
et on verra qu’il a ajouté beaucoup à ce que nous