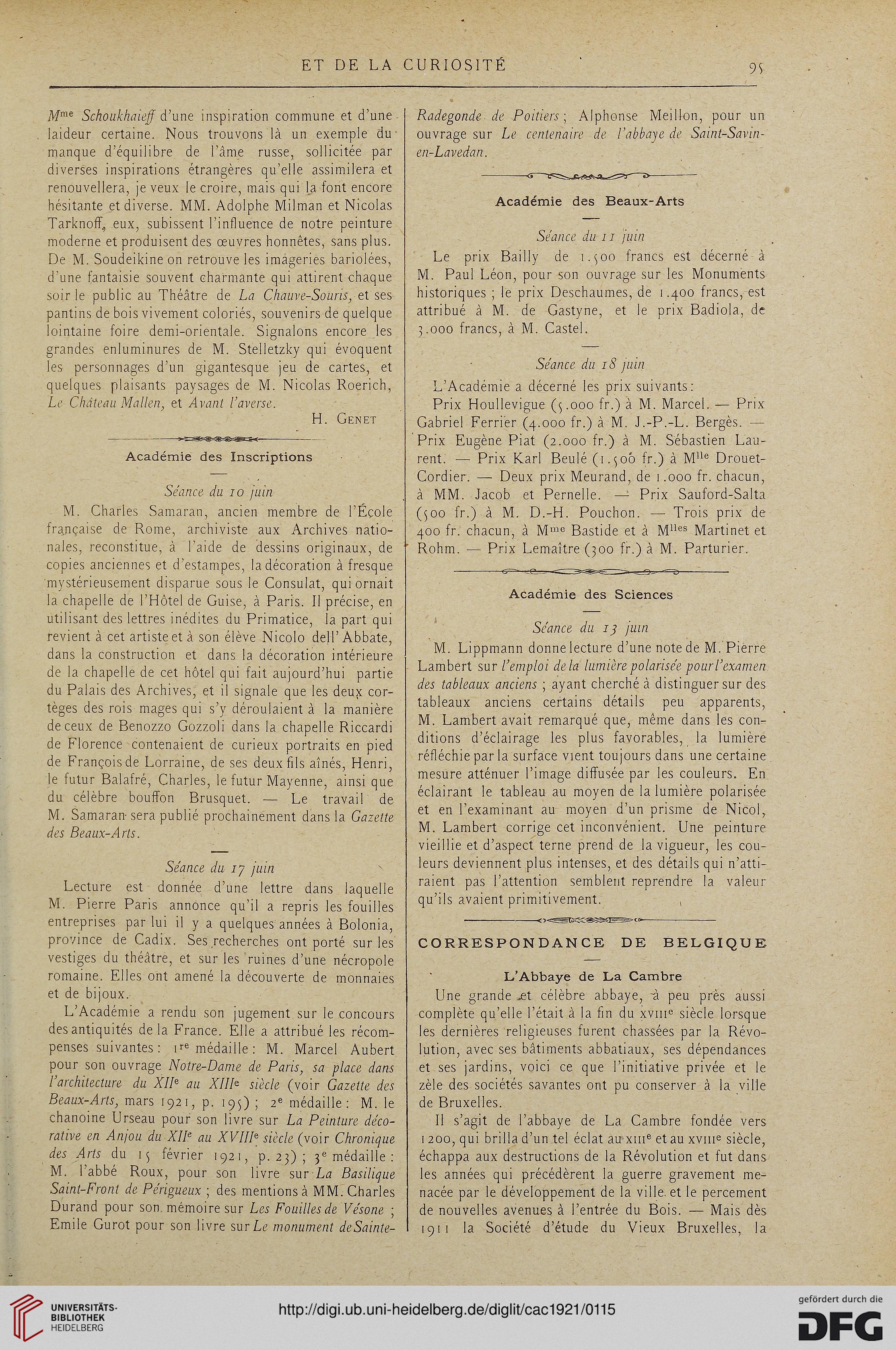ET DE LA CURIOSITÉ
91
Mme Schoukhaieff d’une inspiration commune et d’une
laideur certaine. Nous trouvons là un exemple du-
manque d’équilibre de Pâme russe, sollicitée par
diverses inspirations étrangères qu’elle assimilera et
renouvellera, je veux le croire, mais qui la font encore
hésitante et diverse. MM. Adolphe Milman et Nicolas
Tarknoff, eux, subissent l’influence de notre peinture
moderne et produisent des œuvres honnêtes, sans plus.
De M. Soudeikine on retrouve les imageries bariolées,
d’une fantaisie souvent charmante qui attirent chaque
soir le public au Théâtre de La Chauve-Souris, et ses
pantins de bois vivement coloriés, souvenirs de quelque
lointaine foire demi-orientale. Signalons encore les
grandes enluminures de M. Stelletzky qui évoquent
les personnages d’un gigantesque jeu de cartes, et
quelques plaisants paysages de M. Nicolas Roerich,
Le Château Malien, et Avant l’averse.
H. Genet
Académie des Inscriptions
Séance du io juin
M. Charles Samaran, ancien membre de l’Éçole
française de Rome, archiviste aux Archives natio-
nales, reconstitue, à l’aide de dessins originaux, de
copies anciennes et d’estampes, la décoration à fresque
mystérieusement disparue sous le Consulat, qui ornait
la chapelle de l’Hôtel de Guise, à Paris. Il précise, en
utilisant des lettres inédites du Primatice, la part qui
revient à cet artiste et à son élève Nicolo de)P Abbate,
dans la construction et dans la décoration intérieure
de la chapelle de cet hôtel qui fait aujourd’hui partie
du Palais des Archives, et il signale que les deux cor-
tèges des rois mages qui s’y déroulaient à la manière
de ceux de Benozzo Gozzoli dans la chapelle Riccardi
de Florence contenaient de curieux portraits en pied
de François de Lorraine, de ses deux fils aînés, Henri,
le futur Balafré, Charles, le futur Mayenne, ainsi que
du célèbre bouffon Brusquet. — Le travail de
M. Samaran-sera publié prochainement dans la Gazette
des Beaux-Arts.
Séance du iy juin
Lecture est donnée d’une lettre dans laquelle
M. Pierre Paris annonce qu’il a repris les fouilles
entreprises par lui il y a quelques années à Bolonia,
province de Cadix. Ses recherches ont porté sur les
vestiges du théâtre, et sur les ruines d’une nécropole
romaine. Elles ont amené la découverte de monnaies
et de bijoux.
L’Académie a rendu son jugement sur le concours
des antiquités de la France. Elle a attribué les récom-
penses suivantes : ire médaille : M. Marcel Aubert
pour son ouvrage Notre-Dame de Paris, sa place dans
l’architecture du XIIe au XIIIe siècle (voir Gazette des
Beaux-Arts, mars 1921, p. 195) ; 2e médaille: M. le
chanoine Urseau pour son livre sur La Peinture déco-
rative en Anjou du XIIe au XVIIIe siècle (voir Chronique
des Arts du 15 février 1921, p. 23) ; 3e médaille :
M. l'abbé Roux, pour son livre sur Lu Basilique
Saint-Front de Périgueux ; des mentions à MM. Charles
Durand pour son mémoire sur Les Fouilles de Vésone ;
Emile Gurot pour son livre sur Le monument deSainte-
Radegonde de Poitiers; Alphonse Meilion, pour un
ouvrage sur Le centenaire de l’abbaye de Saint-Savin-
en-Lavedan.
Académie des Beaux-Arts
Séance du 11 juin
Le prix Bailly de 1.300 francs est décerné à
M. Paul Léon, pour son ouvrage sur les Monuments
historiques ; le prix Deschaumes, de 1.400 francs, est
attribué à M. de Gastyne, et le prix Badiola, de
3.000 francs, à M. Castel.
Séance du 18 juin
L’Académie a décerné les prix suivants:
Prix Houllevigue (3.000 fr.) à M. Marcel. — Prix
Gabriel Ferrier (4.000 fr.) à M. J.-P.-L. Bergès. —
Prix Eugène Piaf (2.000 fr.) à M. Sébastien Lau-
rent. — Prix Karl Beulé (1.300 fr.) à Mlle Drouet-
Cordier. — Deux prix Meurand, de 1.000 fr. chacun,
à MM. Jacob et Pernelle. — Prix Sauford-Salta
(300 fr.) à M. D.-H. Pouchon. — Trois prix de
400 fr. chacun, à Mme Bastide et à Mlles Martinet et
Rohm. — Prix Lemaître (300 fr.) à M. Parturier.
Académie des Sciences
Séance du 1 y juin
M. Lippmann donne lecture d’une note de M. Pierre
Lambert sur l’emploi delà lumière polarisée pour l’examen
des tableaux anciens ; ayant cherché à distinguer sur des
tableaux anciens certains détails peu apparents,
M. Lambert avait remarqué que, même dans les con-
ditions d’éclairage les plus favorables, la lumière
réfléchie par la surface vient toujours dans une certaine
mesure atténuer l’image diffusée par les couleurs. En
éclairant le tableau au moyen de la lumière polarisée
et en l’examinant au moyen d’un prisme de Nicol,
M. Lambert corrige cet inconvénient. Une peinture
vieillie et d’aspect terne prend de la vigueur, les cou-
leurs deviennent plus intenses, et des détails qui n’atti-
raient pas l’attention semblent reprendre la valeur
qu’ils avaient primitivement.
CORRESPONDANCE DE BELGIQUE
L’Abbaye de La Cambre
Une grande œt célèbre abbaye, -à peu près aussi
complète qu’elle l’était à la fin du xvnIe siècle lorsque
les dernières religieuses furent chassées par la Révo-
lution, avec ses bâtiments abbatiaux, ses dépendances
et ses jardins, voici ce que l’initiative privée et le
zèle des sociétés savantes ont pu conserver à la ville
de Bruxelles.
Il s’agit de l’abbaye de La Cambre fondée vers
1 200, qui brilla d’un tel éclat an-xiiR et au xvme siècle,
échappa aux destructions de la Révolution et fut dans
les années qui précédèrent la guerre gravement me-
nacée par le développement de la ville, et le percement
de nouvelles avenues à l’entrée du Bois. — Mais dès
1911 la Société d’étude du Vieux Bruxelles, la
91
Mme Schoukhaieff d’une inspiration commune et d’une
laideur certaine. Nous trouvons là un exemple du-
manque d’équilibre de Pâme russe, sollicitée par
diverses inspirations étrangères qu’elle assimilera et
renouvellera, je veux le croire, mais qui la font encore
hésitante et diverse. MM. Adolphe Milman et Nicolas
Tarknoff, eux, subissent l’influence de notre peinture
moderne et produisent des œuvres honnêtes, sans plus.
De M. Soudeikine on retrouve les imageries bariolées,
d’une fantaisie souvent charmante qui attirent chaque
soir le public au Théâtre de La Chauve-Souris, et ses
pantins de bois vivement coloriés, souvenirs de quelque
lointaine foire demi-orientale. Signalons encore les
grandes enluminures de M. Stelletzky qui évoquent
les personnages d’un gigantesque jeu de cartes, et
quelques plaisants paysages de M. Nicolas Roerich,
Le Château Malien, et Avant l’averse.
H. Genet
Académie des Inscriptions
Séance du io juin
M. Charles Samaran, ancien membre de l’Éçole
française de Rome, archiviste aux Archives natio-
nales, reconstitue, à l’aide de dessins originaux, de
copies anciennes et d’estampes, la décoration à fresque
mystérieusement disparue sous le Consulat, qui ornait
la chapelle de l’Hôtel de Guise, à Paris. Il précise, en
utilisant des lettres inédites du Primatice, la part qui
revient à cet artiste et à son élève Nicolo de)P Abbate,
dans la construction et dans la décoration intérieure
de la chapelle de cet hôtel qui fait aujourd’hui partie
du Palais des Archives, et il signale que les deux cor-
tèges des rois mages qui s’y déroulaient à la manière
de ceux de Benozzo Gozzoli dans la chapelle Riccardi
de Florence contenaient de curieux portraits en pied
de François de Lorraine, de ses deux fils aînés, Henri,
le futur Balafré, Charles, le futur Mayenne, ainsi que
du célèbre bouffon Brusquet. — Le travail de
M. Samaran-sera publié prochainement dans la Gazette
des Beaux-Arts.
Séance du iy juin
Lecture est donnée d’une lettre dans laquelle
M. Pierre Paris annonce qu’il a repris les fouilles
entreprises par lui il y a quelques années à Bolonia,
province de Cadix. Ses recherches ont porté sur les
vestiges du théâtre, et sur les ruines d’une nécropole
romaine. Elles ont amené la découverte de monnaies
et de bijoux.
L’Académie a rendu son jugement sur le concours
des antiquités de la France. Elle a attribué les récom-
penses suivantes : ire médaille : M. Marcel Aubert
pour son ouvrage Notre-Dame de Paris, sa place dans
l’architecture du XIIe au XIIIe siècle (voir Gazette des
Beaux-Arts, mars 1921, p. 195) ; 2e médaille: M. le
chanoine Urseau pour son livre sur La Peinture déco-
rative en Anjou du XIIe au XVIIIe siècle (voir Chronique
des Arts du 15 février 1921, p. 23) ; 3e médaille :
M. l'abbé Roux, pour son livre sur Lu Basilique
Saint-Front de Périgueux ; des mentions à MM. Charles
Durand pour son mémoire sur Les Fouilles de Vésone ;
Emile Gurot pour son livre sur Le monument deSainte-
Radegonde de Poitiers; Alphonse Meilion, pour un
ouvrage sur Le centenaire de l’abbaye de Saint-Savin-
en-Lavedan.
Académie des Beaux-Arts
Séance du 11 juin
Le prix Bailly de 1.300 francs est décerné à
M. Paul Léon, pour son ouvrage sur les Monuments
historiques ; le prix Deschaumes, de 1.400 francs, est
attribué à M. de Gastyne, et le prix Badiola, de
3.000 francs, à M. Castel.
Séance du 18 juin
L’Académie a décerné les prix suivants:
Prix Houllevigue (3.000 fr.) à M. Marcel. — Prix
Gabriel Ferrier (4.000 fr.) à M. J.-P.-L. Bergès. —
Prix Eugène Piaf (2.000 fr.) à M. Sébastien Lau-
rent. — Prix Karl Beulé (1.300 fr.) à Mlle Drouet-
Cordier. — Deux prix Meurand, de 1.000 fr. chacun,
à MM. Jacob et Pernelle. — Prix Sauford-Salta
(300 fr.) à M. D.-H. Pouchon. — Trois prix de
400 fr. chacun, à Mme Bastide et à Mlles Martinet et
Rohm. — Prix Lemaître (300 fr.) à M. Parturier.
Académie des Sciences
Séance du 1 y juin
M. Lippmann donne lecture d’une note de M. Pierre
Lambert sur l’emploi delà lumière polarisée pour l’examen
des tableaux anciens ; ayant cherché à distinguer sur des
tableaux anciens certains détails peu apparents,
M. Lambert avait remarqué que, même dans les con-
ditions d’éclairage les plus favorables, la lumière
réfléchie par la surface vient toujours dans une certaine
mesure atténuer l’image diffusée par les couleurs. En
éclairant le tableau au moyen de la lumière polarisée
et en l’examinant au moyen d’un prisme de Nicol,
M. Lambert corrige cet inconvénient. Une peinture
vieillie et d’aspect terne prend de la vigueur, les cou-
leurs deviennent plus intenses, et des détails qui n’atti-
raient pas l’attention semblent reprendre la valeur
qu’ils avaient primitivement.
CORRESPONDANCE DE BELGIQUE
L’Abbaye de La Cambre
Une grande œt célèbre abbaye, -à peu près aussi
complète qu’elle l’était à la fin du xvnIe siècle lorsque
les dernières religieuses furent chassées par la Révo-
lution, avec ses bâtiments abbatiaux, ses dépendances
et ses jardins, voici ce que l’initiative privée et le
zèle des sociétés savantes ont pu conserver à la ville
de Bruxelles.
Il s’agit de l’abbaye de La Cambre fondée vers
1 200, qui brilla d’un tel éclat an-xiiR et au xvme siècle,
échappa aux destructions de la Révolution et fut dans
les années qui précédèrent la guerre gravement me-
nacée par le développement de la ville, et le percement
de nouvelles avenues à l’entrée du Bois. — Mais dès
1911 la Société d’étude du Vieux Bruxelles, la