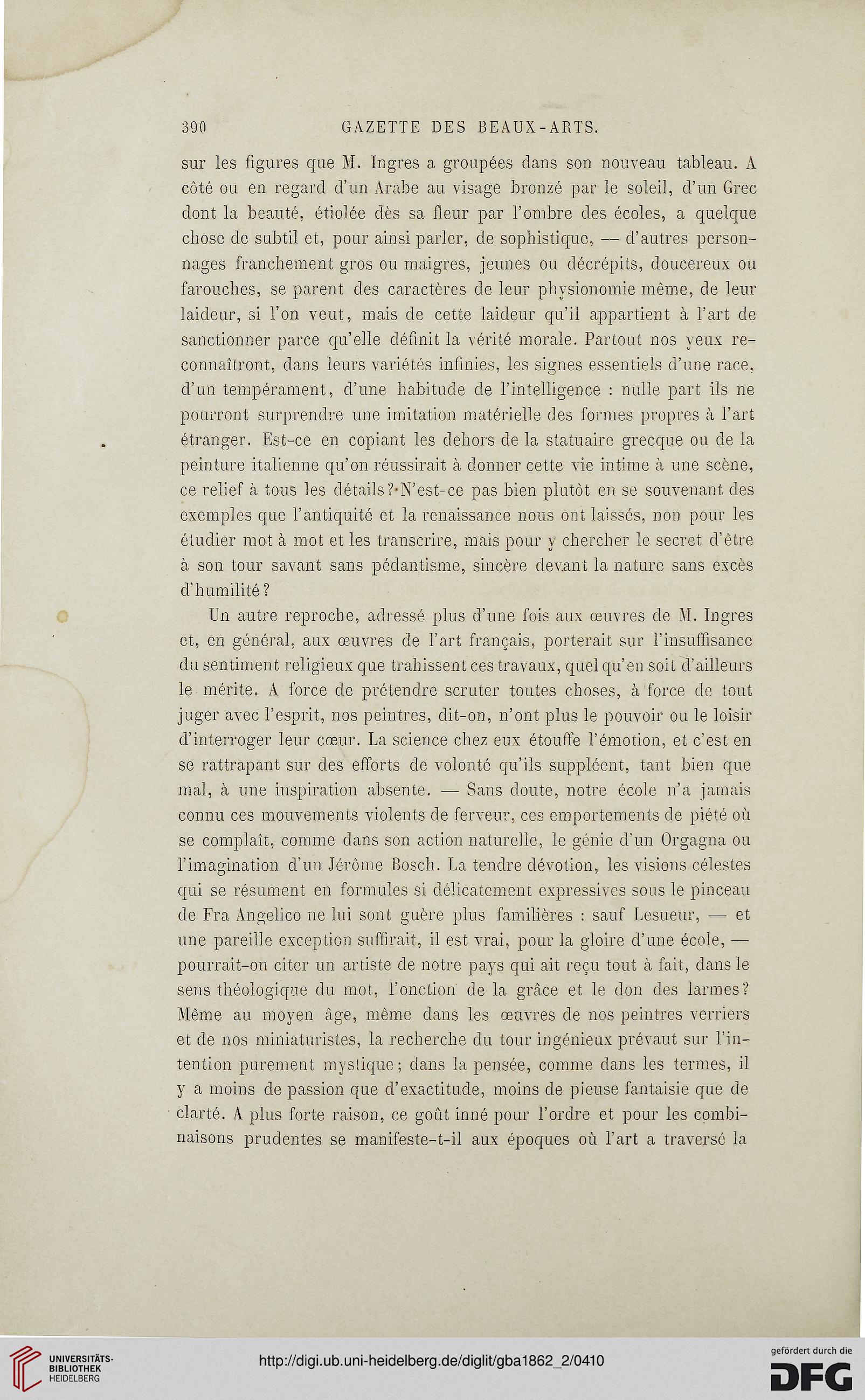390
GAZETTE DES BEAUX - ARTS.
sur les figures que M. Ingres a groupées dans son nouveau tableau. A
côté ou en regard d'un Arabe au visage bronzé par le soleil, d'un Grec
dont la beauté, étiolée dès sa fleur par l'ombre des écoles, a quelque
chose de subtil et, pour ainsi parler, de sophistique, — d'autres person-
nages franchement gros ou maigres, jeunes ou décrépits, doucereux ou
farouches, se parent des caractères de leur physionomie même, de leur
laideur, si l'on veut, mais de cette laideur qu'il appartient à l'art de
sanctionner parce qu'elle définit la vérité morale. Partout nos yeux re-
connaîtront, dans leurs variétés infinies, les signes essentiels d'une race,
d'un tempérament, d'une habitude de l'intelligence : nulle part ils ne
pourront surprendre une imitation matérielle des formes propres à l'art
étranger. Est-ce en copiant les dehors de la statuaire grecque ou de la
peinture italienne qu'on réussirait à donner cette vie intime à une scène,
ce relief à tous les détails ?*N'est-ce pas bien plutôt en se souvenant des
exemples que l'antiquité et la renaissance nous ont laissés, non pour les
étudier mot à mot et les transcrire, mais pour y chercher le secret d'être
à son tour savant sans pédantisme, sincère devant la nature sans excès
d'humilité ?
Un autre reproche, adressé plus d'une fois aux œuvres de M. Ingres
et, en général, aux œuvres de l'art français, porterait sur l'insuffisance
du sentiment religieux que trahissent ces travaux, quel qu'en soit d'ailleurs
le mérite. A force de prétendre scruter toutes choses, à force de tout
juger avec l'esprit, nos peintres, dit-on, n'ont plus le pouvoir ou le loisir
d'interroger leur cœur. La science chez eux étouffe l'émotion, et c'est en
se rattrapant sur des efforts de volonté qu'ils suppléent, tant bien que
mal, à une inspiration absente. — Sans doute, notre école n'a jamais
connu ces mouvements violents de ferveur, ces emportements de piété où
se complaît, comme dans son action naturelle, le génie d'un Orgagna ou
l'imagination d'un Jérôme Bosch. La tendre dévotion, les visions célestes
qui se résument en formules si délicatement expressives sous le pinceau
de Fra Angelico ne lui sont guère plus familières : sauf Lesueur, — et
une pareille exception suffirait, il est vrai, pour la gloire d'une école, —
pourrait-on citer un artiste de notre pays qui ait reçu tout à fait, dans le
sens théologique du mot, l'onction de la grâce et le don des larmes?
Même au moyen âge, même dans les œuvres de nos peintres verriers
et de nos miniaturistes, la recherche du tour ingénieux prévaut sur l'in-
tention purement mystique; dans la pensée, comme dans les termes, il
y a moins de passion que d'exactitude, moins de pieuse fantaisie que de
clarté. A plus forte raison, ce goût inné pour l'ordre et pour les combi-
naisons prudentes se manifeste-t-il aux époques où l'art a traversé la
GAZETTE DES BEAUX - ARTS.
sur les figures que M. Ingres a groupées dans son nouveau tableau. A
côté ou en regard d'un Arabe au visage bronzé par le soleil, d'un Grec
dont la beauté, étiolée dès sa fleur par l'ombre des écoles, a quelque
chose de subtil et, pour ainsi parler, de sophistique, — d'autres person-
nages franchement gros ou maigres, jeunes ou décrépits, doucereux ou
farouches, se parent des caractères de leur physionomie même, de leur
laideur, si l'on veut, mais de cette laideur qu'il appartient à l'art de
sanctionner parce qu'elle définit la vérité morale. Partout nos yeux re-
connaîtront, dans leurs variétés infinies, les signes essentiels d'une race,
d'un tempérament, d'une habitude de l'intelligence : nulle part ils ne
pourront surprendre une imitation matérielle des formes propres à l'art
étranger. Est-ce en copiant les dehors de la statuaire grecque ou de la
peinture italienne qu'on réussirait à donner cette vie intime à une scène,
ce relief à tous les détails ?*N'est-ce pas bien plutôt en se souvenant des
exemples que l'antiquité et la renaissance nous ont laissés, non pour les
étudier mot à mot et les transcrire, mais pour y chercher le secret d'être
à son tour savant sans pédantisme, sincère devant la nature sans excès
d'humilité ?
Un autre reproche, adressé plus d'une fois aux œuvres de M. Ingres
et, en général, aux œuvres de l'art français, porterait sur l'insuffisance
du sentiment religieux que trahissent ces travaux, quel qu'en soit d'ailleurs
le mérite. A force de prétendre scruter toutes choses, à force de tout
juger avec l'esprit, nos peintres, dit-on, n'ont plus le pouvoir ou le loisir
d'interroger leur cœur. La science chez eux étouffe l'émotion, et c'est en
se rattrapant sur des efforts de volonté qu'ils suppléent, tant bien que
mal, à une inspiration absente. — Sans doute, notre école n'a jamais
connu ces mouvements violents de ferveur, ces emportements de piété où
se complaît, comme dans son action naturelle, le génie d'un Orgagna ou
l'imagination d'un Jérôme Bosch. La tendre dévotion, les visions célestes
qui se résument en formules si délicatement expressives sous le pinceau
de Fra Angelico ne lui sont guère plus familières : sauf Lesueur, — et
une pareille exception suffirait, il est vrai, pour la gloire d'une école, —
pourrait-on citer un artiste de notre pays qui ait reçu tout à fait, dans le
sens théologique du mot, l'onction de la grâce et le don des larmes?
Même au moyen âge, même dans les œuvres de nos peintres verriers
et de nos miniaturistes, la recherche du tour ingénieux prévaut sur l'in-
tention purement mystique; dans la pensée, comme dans les termes, il
y a moins de passion que d'exactitude, moins de pieuse fantaisie que de
clarté. A plus forte raison, ce goût inné pour l'ordre et pour les combi-
naisons prudentes se manifeste-t-il aux époques où l'art a traversé la