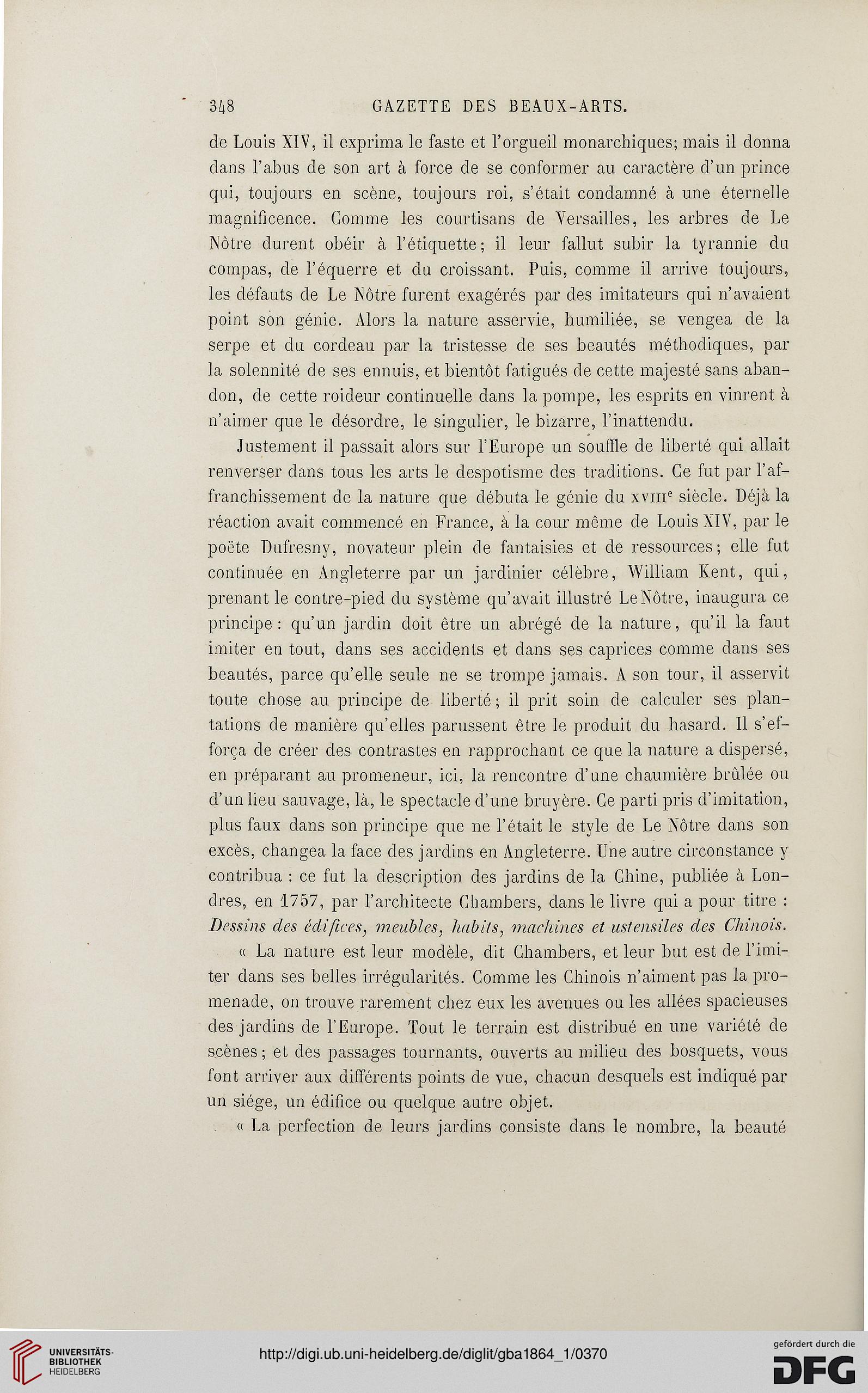GAZETTE DES BEAUX-ARTS.
3^,8
de Louis XIV, il exprima le faste et l’orgueil monarchiques; mais il donna
dans l’abus de son art à force de se conformer au caractère d’un prince
qui, toujours en scène, toujours roi, s’était condamné à une éternelle
magnificence. Comme les courtisans de Versailles, les arbres de Le
Nôtre durent obéir à l’étiquette; il leur fallut subir la tyrannie du
compas, de l’équerre et du croissant. Puis, comme il arrive toujours,
les défauts de Le Nôtre furent exagérés par des imitateurs qui n’avaient
point son génie. Alors la nature asservie, humiliée, se vengea de la
serpe et du cordeau par la tristesse de ses beautés méthodiques, par
la solennité de ses ennuis, et bientôt fatigués de cette majesté sans aban-
don, de cette roideur continuelle dans la pompe, les esprits en vinrent à
n’aimer que le désordre, le singulier, le bizarre, l’inattendu.
Justement il passait alors sur l’Europe un souille de liberté qui allait
renverser dans tous les arts le despotisme des traditions. Ce fut par l’af-
franchissement de la nature que débuta le génie du xvme siècle. Déjà la
réaction avait commencé en France, à la cour même de Louis XIV, par le
poète Dufresny, novateur plein de fantaisies et de ressources; elle fut
continuée en Angleterre par un jardinier célèbre, William Kent, qui,
prenant le contre-pied du système qu’avait illustré Le Nôtre, inaugura ce
principe: qu’un jardin doit être un abrégé de la nature, qu’il la faut
imiter en tout, dans ses accidents et dans ses caprices comme dans ses
beautés, parce qu’elle seule ne se trompe jamais. À son tour, il asservit
toute chose au principe de liberté ; il prit soin de calculer ses plan-
tations de manière qu’elles parussent être le produit du hasard. Il s’ef-
força de créer des contrastes en rapprochant ce que la nature a dispersé,
en préparant au promeneur, ici, la rencontre d’une chaumière brûlée ou
d’un lieu sauvage, là, le spectacle d’une bruyère. Ce parti pris d’imitation,
plus faux dans son principe que ne l’était le style de Le Nôtre dans son
excès, changea la face des jardins en Angleterre. Une autre circonstance y
contribua : ce fut la description des jardins de la Chine, publiée à Lon-
dres, en 1757, par l’architecte Chambers, dans le livre qui a pour titre :
Dessins des édifices, meubles, habits, machines et ustensiles des Chinois.
« La nature est leur modèle, dit Chambers, et leur but est de Limi-
ter dans ses belles irrégularités. Comme les Chinois n’aiment pas la pro-
menade, on trouve rarement chez eux les avenues ou les allées spacieuses
des jardins de l’Europe. Tout le terrain est distribué en une variété de
scènes; et des passages tournants, ouverts au milieu des bosquets, vous
font arriver aux différents points de vue, chacun desquels est indiqué par
un siège, un édifice ou quelque autre objet.
« La perfection de leurs jardins consiste dans le nombre, la beauté
3^,8
de Louis XIV, il exprima le faste et l’orgueil monarchiques; mais il donna
dans l’abus de son art à force de se conformer au caractère d’un prince
qui, toujours en scène, toujours roi, s’était condamné à une éternelle
magnificence. Comme les courtisans de Versailles, les arbres de Le
Nôtre durent obéir à l’étiquette; il leur fallut subir la tyrannie du
compas, de l’équerre et du croissant. Puis, comme il arrive toujours,
les défauts de Le Nôtre furent exagérés par des imitateurs qui n’avaient
point son génie. Alors la nature asservie, humiliée, se vengea de la
serpe et du cordeau par la tristesse de ses beautés méthodiques, par
la solennité de ses ennuis, et bientôt fatigués de cette majesté sans aban-
don, de cette roideur continuelle dans la pompe, les esprits en vinrent à
n’aimer que le désordre, le singulier, le bizarre, l’inattendu.
Justement il passait alors sur l’Europe un souille de liberté qui allait
renverser dans tous les arts le despotisme des traditions. Ce fut par l’af-
franchissement de la nature que débuta le génie du xvme siècle. Déjà la
réaction avait commencé en France, à la cour même de Louis XIV, par le
poète Dufresny, novateur plein de fantaisies et de ressources; elle fut
continuée en Angleterre par un jardinier célèbre, William Kent, qui,
prenant le contre-pied du système qu’avait illustré Le Nôtre, inaugura ce
principe: qu’un jardin doit être un abrégé de la nature, qu’il la faut
imiter en tout, dans ses accidents et dans ses caprices comme dans ses
beautés, parce qu’elle seule ne se trompe jamais. À son tour, il asservit
toute chose au principe de liberté ; il prit soin de calculer ses plan-
tations de manière qu’elles parussent être le produit du hasard. Il s’ef-
força de créer des contrastes en rapprochant ce que la nature a dispersé,
en préparant au promeneur, ici, la rencontre d’une chaumière brûlée ou
d’un lieu sauvage, là, le spectacle d’une bruyère. Ce parti pris d’imitation,
plus faux dans son principe que ne l’était le style de Le Nôtre dans son
excès, changea la face des jardins en Angleterre. Une autre circonstance y
contribua : ce fut la description des jardins de la Chine, publiée à Lon-
dres, en 1757, par l’architecte Chambers, dans le livre qui a pour titre :
Dessins des édifices, meubles, habits, machines et ustensiles des Chinois.
« La nature est leur modèle, dit Chambers, et leur but est de Limi-
ter dans ses belles irrégularités. Comme les Chinois n’aiment pas la pro-
menade, on trouve rarement chez eux les avenues ou les allées spacieuses
des jardins de l’Europe. Tout le terrain est distribué en une variété de
scènes; et des passages tournants, ouverts au milieu des bosquets, vous
font arriver aux différents points de vue, chacun desquels est indiqué par
un siège, un édifice ou quelque autre objet.
« La perfection de leurs jardins consiste dans le nombre, la beauté