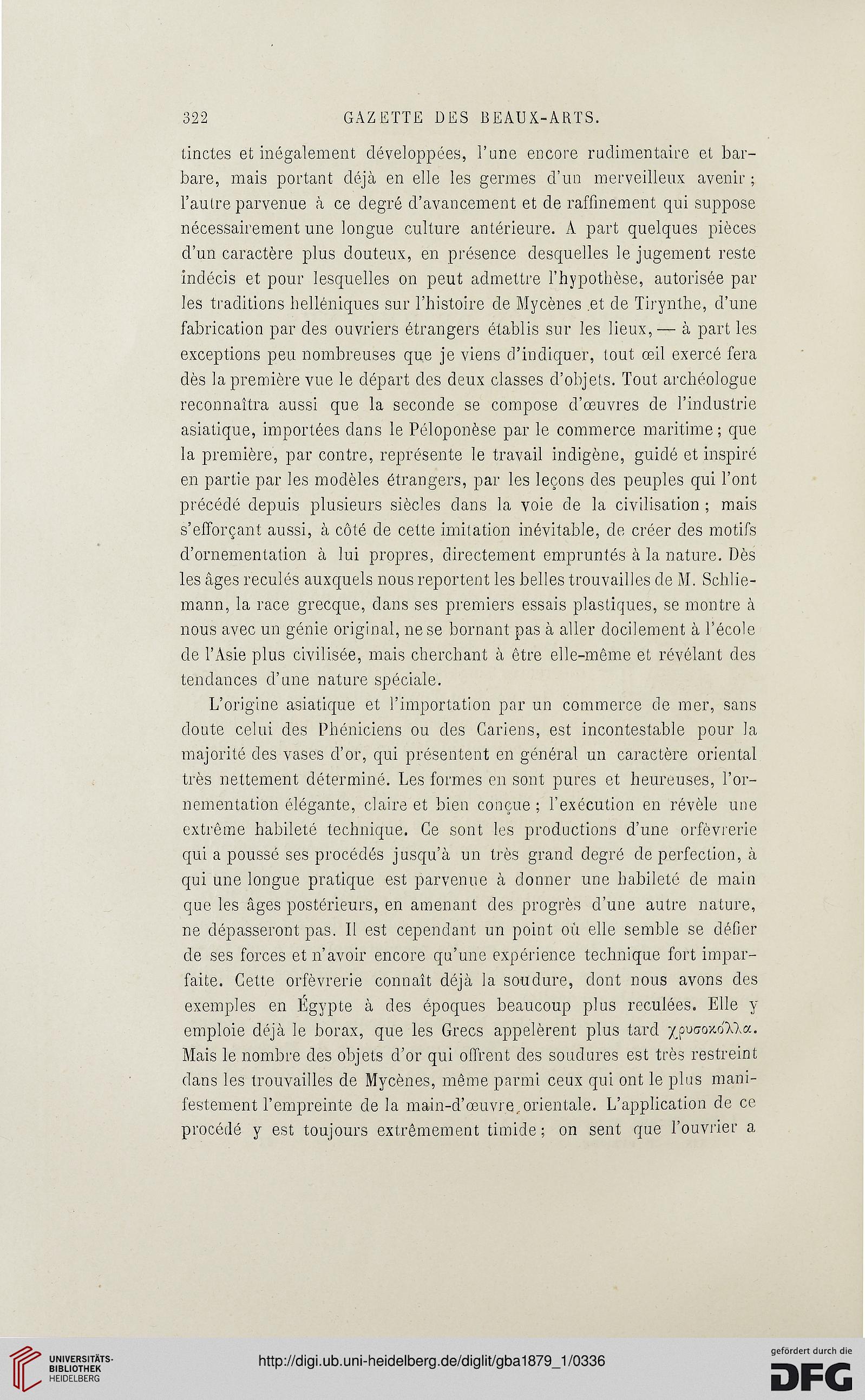322
GAZETTE DES BEAUX-ARTS.
tinctes et inégalement développées, l’une encore rudimentaire et bar-
bare, mais portant déjà en elle les germes d’un merveilleux avenir ;
l’autre parvenue à ce degré d’avancement et de raffinement qui suppose
nécessairement une longue culture antérieure. À part quelques pièces
d’un caractère plus douteux, en présence desquelles le jugement reste
Indécis et pour lesquelles on peut admettre l’hypothèse, autorisée par
les traditions helléniques sur l’histoire de Mycènes et de Tirynthe, d’une
fabrication par des ouvriers étrangers établis sur les lieux,— à part les
exceptions peu nombreuses que je viens d’indiquer, tout œil exercé fera
dès la première vue le départ des deux classes d’objets. Tout archéologue
reconnaîtra aussi que la seconde se compose d’œuvres de l’industrie
asiatique, importées dans le Péloponèse par le commerce maritime ; que
la première, par contre, représente le travail indigène, guidé et inspiré
en partie par les modèles étrangers, par les leçons des peuples qui l’ont
précédé depuis plusieurs siècles dans la voie de la civilisation ; mais
s’efforçant aussi, à côté de cette imitation inévitable, de créer des motifs
d’ornementation à lui propres, directement empruntés à la nature. Dès
les âges reculés auxquels nous reportent les belles trouvailles de 11. Schlie-
mann, la race grecque, dans ses premiers essais plastiques, se montre à
nous avec un génie original, ne se bornant pas à aller docilement à l’école
de l’Asie plus civilisée, mais cherchant à être elle-même et révélant des
tendances d’une nature spéciale.
L’origine asiatique et l’importation par un commerce de mer, sans
doute celui des Phéniciens ou des Gariens, est incontestable pour la
majorité des vases d’or, qui présentent en général un caractère oriental
très nettement déterminé. Les formes en sont pures et heureuses, l’or-
nementation élégante, claire et bien conçue ; l’exécution en révèle une
extrême habileté technique. Ce sont les productions d’une orfèvrerie
qui a poussé ses procédés jusqu’à un très grand degré de perfection, à
qui une longue pratique est parvenue à donner une habileté de main
que les âges postérieurs, en amenant des progrès d’une autre nature,
ne dépasseront pas. Il est cependant un point où elle semble se défier
de ses forces et n’avoir encore qu’une expérience technique fort impar-
faite. Cette orfèvrerie connaît déjà la soudure, dont nous avons des
exemples en Égypte à des époques beaucoup plus reculées. Elle y
emploie déjà le borax, que les Grecs appelèrent plus tard
Mais le nombre des objets d’or qui offrent des soudures est très restreint
dans les trouvailles de Mycènes, même parmi ceux qui ont le plus mani-
festement l’empreinte de la main-d’œuvre,orientale. L’application de ce
procédé y est toujours extrêmement timide ; on sent que l’ouvrier a
GAZETTE DES BEAUX-ARTS.
tinctes et inégalement développées, l’une encore rudimentaire et bar-
bare, mais portant déjà en elle les germes d’un merveilleux avenir ;
l’autre parvenue à ce degré d’avancement et de raffinement qui suppose
nécessairement une longue culture antérieure. À part quelques pièces
d’un caractère plus douteux, en présence desquelles le jugement reste
Indécis et pour lesquelles on peut admettre l’hypothèse, autorisée par
les traditions helléniques sur l’histoire de Mycènes et de Tirynthe, d’une
fabrication par des ouvriers étrangers établis sur les lieux,— à part les
exceptions peu nombreuses que je viens d’indiquer, tout œil exercé fera
dès la première vue le départ des deux classes d’objets. Tout archéologue
reconnaîtra aussi que la seconde se compose d’œuvres de l’industrie
asiatique, importées dans le Péloponèse par le commerce maritime ; que
la première, par contre, représente le travail indigène, guidé et inspiré
en partie par les modèles étrangers, par les leçons des peuples qui l’ont
précédé depuis plusieurs siècles dans la voie de la civilisation ; mais
s’efforçant aussi, à côté de cette imitation inévitable, de créer des motifs
d’ornementation à lui propres, directement empruntés à la nature. Dès
les âges reculés auxquels nous reportent les belles trouvailles de 11. Schlie-
mann, la race grecque, dans ses premiers essais plastiques, se montre à
nous avec un génie original, ne se bornant pas à aller docilement à l’école
de l’Asie plus civilisée, mais cherchant à être elle-même et révélant des
tendances d’une nature spéciale.
L’origine asiatique et l’importation par un commerce de mer, sans
doute celui des Phéniciens ou des Gariens, est incontestable pour la
majorité des vases d’or, qui présentent en général un caractère oriental
très nettement déterminé. Les formes en sont pures et heureuses, l’or-
nementation élégante, claire et bien conçue ; l’exécution en révèle une
extrême habileté technique. Ce sont les productions d’une orfèvrerie
qui a poussé ses procédés jusqu’à un très grand degré de perfection, à
qui une longue pratique est parvenue à donner une habileté de main
que les âges postérieurs, en amenant des progrès d’une autre nature,
ne dépasseront pas. Il est cependant un point où elle semble se défier
de ses forces et n’avoir encore qu’une expérience technique fort impar-
faite. Cette orfèvrerie connaît déjà la soudure, dont nous avons des
exemples en Égypte à des époques beaucoup plus reculées. Elle y
emploie déjà le borax, que les Grecs appelèrent plus tard
Mais le nombre des objets d’or qui offrent des soudures est très restreint
dans les trouvailles de Mycènes, même parmi ceux qui ont le plus mani-
festement l’empreinte de la main-d’œuvre,orientale. L’application de ce
procédé y est toujours extrêmement timide ; on sent que l’ouvrier a