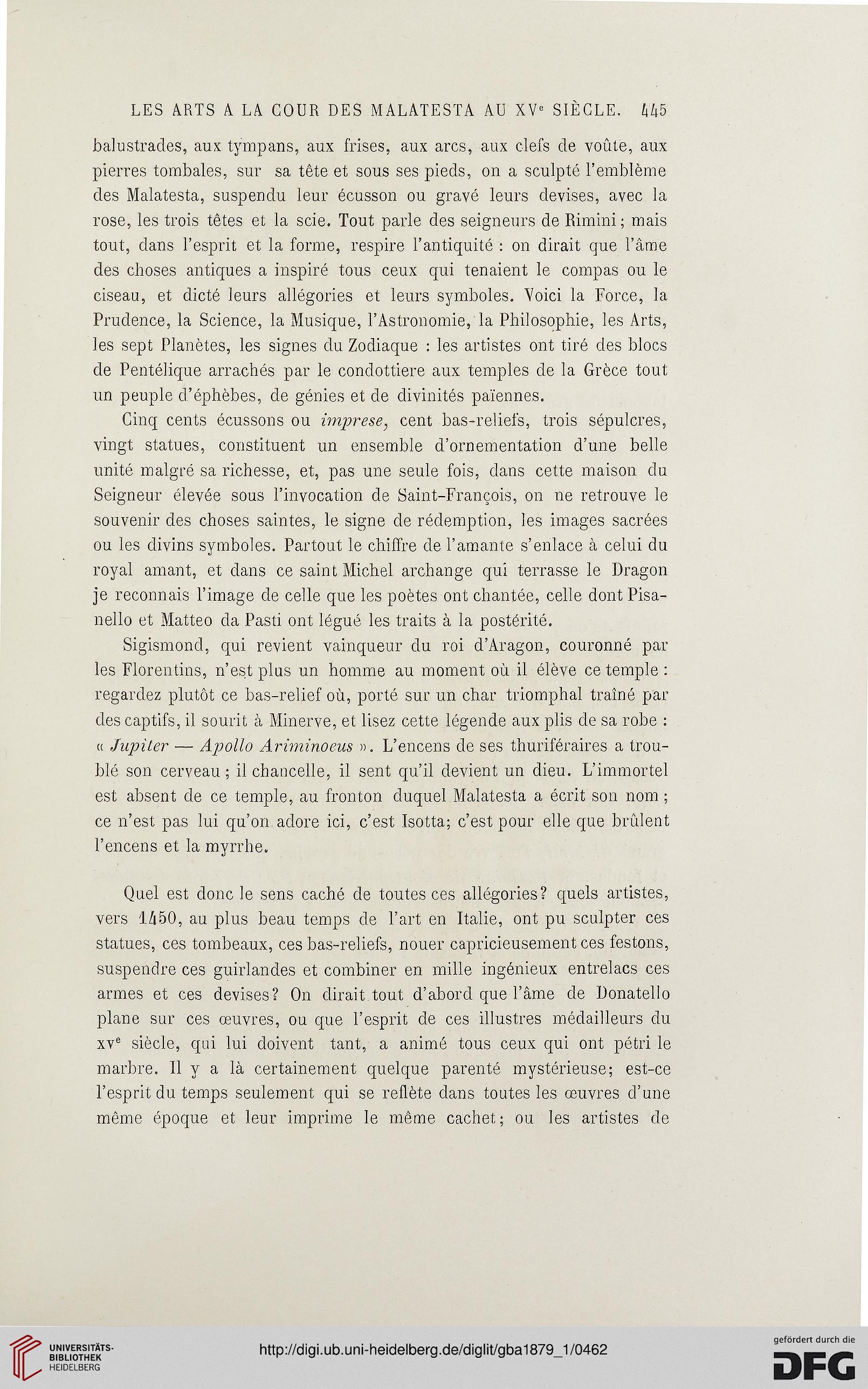LES ARTS A LA COUR DES MALATESTA AU XVe SIÈCLE, bbro
balustrades, aux tympans, aux frises, aux arcs, aux clefs de voûte, aux
pierres tombales, sur sa tête et sous ses pieds, on a sculpté l’emblème
des Malatesta, suspendu leur écusson ou gravé leurs devises, avec la
rose, les trois têtes et la scie. Tout parle des seigneurs de Rimini ; mais
tout, dans l’esprit et la forme, respire l’antiquité : on dirait que l’âme
des choses antiques a inspiré tous ceux qui tenaient le compas ou le
ciseau, et dicté leurs allégories et leurs symboles. Voici la Force, la
Prudence, la Science, la Musique, l’Astronomie, la Philosophie, les Arts,
les sept Planètes, les signes du Zodiaque : les artistes ont tiré des blocs
de Pentélique arrachés par le condottiere aux temples de la Grèce tout
un peuple d’éphèbes, de génies et de divinités païennes.
Cinq cents écussons ou imprese, cent bas-reliefs, trois sépulcres,
vingt statues, constituent un ensemble d’ornementation d’une belle
unité malgré sa richesse, et, pas une seule fois, dans cette maison du
Seigneur élevée sous l’invocation de Saint-François, on ne retrouve le
souvenir des choses saintes, le signe de rédemption, les images sacrées
ou les divins symboles. Partout le chiffre de l’amante s’enlace à celui du
royal amant, et dans ce saint Michel archange qui terrasse le Dragon
je reconnais l’image de celle que les poètes ont chantée, celle dont Pisa-
nello et Matteo da Pasti ont légué les traits à la postérité.
Sigismond, qui revient vainqueur du roi d’Aragon, couronné par
les Florentins, n’est plus un homme au moment où il élève ce temple :
regardez plutôt ce bas-relief où, porté sur un char triomphal traîné par
des captifs, il sourit à Minerve, et lisez cette légende aux plis de sa robe :
a Jupiter — Apollo Ariminoeus ». L’encens de ses thuriféraires a trou-
blé son cerveau; il chancelle, il sent qu’il devient un dieu. L’immortel
est absent de ce temple, au fronton duquel Malatesta a écrit son nom ;
ce n’est pas lui qu’on adore ici, c’est Isotta; c’est pour elle que brûlent
l’encens et la myrrhe.
Quel est donc le sens caché de toutes ces allégories? quels artistes,
vers 1A50, au plus beau temps de l’art en Italie, ont pu sculpter ces
statues, ces tombeaux, ces bas-reliefs, nouer capricieusement ces festons,
suspendre ces guirlandes et combiner en mille ingénieux entrelacs ces
armes et ces devises? On dirait tout d’abord que l’âme de Donatello
plane sur ces œuvres, ou que l’esprit de ces illustres médailleurs du
xve siècle, qui lui doivent tant, a animé tous ceux qui ont pétri le
marbre. Il y a là certainement quelque parenté mystérieuse; est-ce
l’esprit du temps seulement qui se reflète dans toutes les œuvres d’une
même époque et leur imprime le même cachet; ou les artistes de
balustrades, aux tympans, aux frises, aux arcs, aux clefs de voûte, aux
pierres tombales, sur sa tête et sous ses pieds, on a sculpté l’emblème
des Malatesta, suspendu leur écusson ou gravé leurs devises, avec la
rose, les trois têtes et la scie. Tout parle des seigneurs de Rimini ; mais
tout, dans l’esprit et la forme, respire l’antiquité : on dirait que l’âme
des choses antiques a inspiré tous ceux qui tenaient le compas ou le
ciseau, et dicté leurs allégories et leurs symboles. Voici la Force, la
Prudence, la Science, la Musique, l’Astronomie, la Philosophie, les Arts,
les sept Planètes, les signes du Zodiaque : les artistes ont tiré des blocs
de Pentélique arrachés par le condottiere aux temples de la Grèce tout
un peuple d’éphèbes, de génies et de divinités païennes.
Cinq cents écussons ou imprese, cent bas-reliefs, trois sépulcres,
vingt statues, constituent un ensemble d’ornementation d’une belle
unité malgré sa richesse, et, pas une seule fois, dans cette maison du
Seigneur élevée sous l’invocation de Saint-François, on ne retrouve le
souvenir des choses saintes, le signe de rédemption, les images sacrées
ou les divins symboles. Partout le chiffre de l’amante s’enlace à celui du
royal amant, et dans ce saint Michel archange qui terrasse le Dragon
je reconnais l’image de celle que les poètes ont chantée, celle dont Pisa-
nello et Matteo da Pasti ont légué les traits à la postérité.
Sigismond, qui revient vainqueur du roi d’Aragon, couronné par
les Florentins, n’est plus un homme au moment où il élève ce temple :
regardez plutôt ce bas-relief où, porté sur un char triomphal traîné par
des captifs, il sourit à Minerve, et lisez cette légende aux plis de sa robe :
a Jupiter — Apollo Ariminoeus ». L’encens de ses thuriféraires a trou-
blé son cerveau; il chancelle, il sent qu’il devient un dieu. L’immortel
est absent de ce temple, au fronton duquel Malatesta a écrit son nom ;
ce n’est pas lui qu’on adore ici, c’est Isotta; c’est pour elle que brûlent
l’encens et la myrrhe.
Quel est donc le sens caché de toutes ces allégories? quels artistes,
vers 1A50, au plus beau temps de l’art en Italie, ont pu sculpter ces
statues, ces tombeaux, ces bas-reliefs, nouer capricieusement ces festons,
suspendre ces guirlandes et combiner en mille ingénieux entrelacs ces
armes et ces devises? On dirait tout d’abord que l’âme de Donatello
plane sur ces œuvres, ou que l’esprit de ces illustres médailleurs du
xve siècle, qui lui doivent tant, a animé tous ceux qui ont pétri le
marbre. Il y a là certainement quelque parenté mystérieuse; est-ce
l’esprit du temps seulement qui se reflète dans toutes les œuvres d’une
même époque et leur imprime le même cachet; ou les artistes de