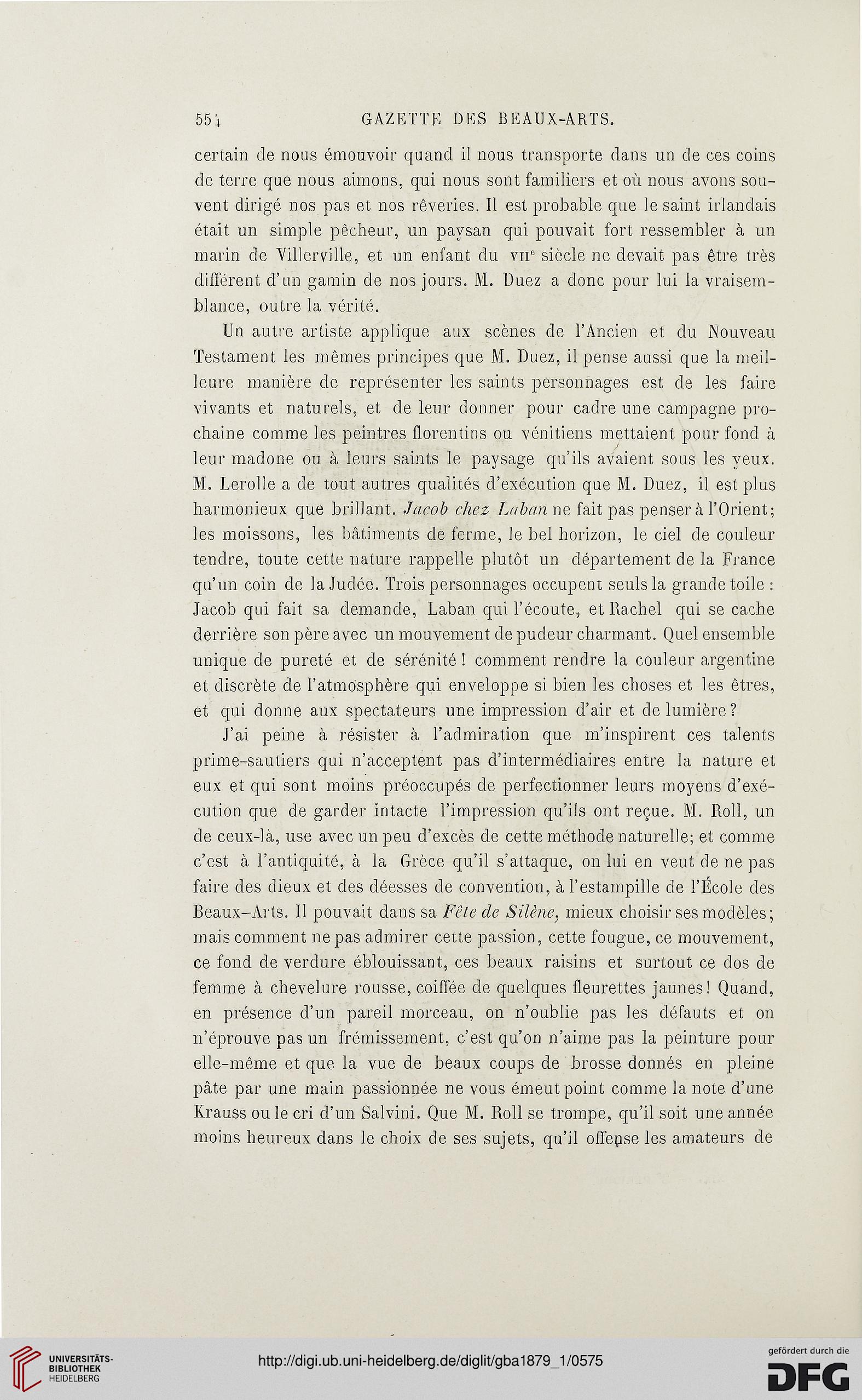554
GAZETTE DES BEAUX-ARTS.
certain de nous émouvoir quand il nous transporte dans un de ces coins
de terre que nous aimons, qui nous sont familiers et où nous avons sou-
vent dirigé nos pas et nos rêveries. Il est probable que le saint irlandais
était un simple pêcheur, un paysan qui pouvait fort ressembler à un
marin de Villerville, et un enfant du vne siècle ne devait pas être très
différent d’un gamin de nos jours. M. Duez a donc pour lui la vraisem-
blance, outre la vérité.
Un autre artiste applique aux scènes de l’Ancien et du Nouveau
Testament les mêmes principes que M. Duez, il pense aussi que la meil-
leure manière de représenter les saints personnages est de les faire
vivants et naturels, et de leur donner pour cadre une campagne pro-
chaine comme les peintres florentins ou vénitiens mettaient pour fond à
leur madone ou à leurs saints le paysage qu’ils avaient sous les yeux.
M. Leroi le a de tout autres qualités d’exécution que M. Duez, il est plus
harmonieux que brillant. Jacob chez Laban ne fait pas penser à l’Orient;
les moissons, les bâtiments de ferme, le bel horizon, le ciel de couleur
tendre, toute cette nature rappelle plutôt un département de la France
qu’un coin de la Judée. Trois personnages occupent seuls la grande toile :
Jacob qui fait sa demande, Laban qui l’écoute, et Rachel qui se cache
derrière son père avec un mouvement de pudeur charmant. Quel ensemble
unique de pureté et de sérénité ! comment rendre la couleur argentine
et discrète de l’atmosphère qui enveloppe si bien les choses et les êtres,
et qui donne aux spectateurs une impression d’air et de lumière?
J’ai peine à résister à l’admiration que m’inspirent ces talents
prime-sautiers qui n’acceptent pas d’intermédiaires entre la nature et
eux et qui sont moins préoccupés de perfectionner leurs moyens d’exé-
cution que de garder intacte l’impression qu’ils ont reçue. M. Roll, un
de ceux-là, use avec un peu d’excès de cette méthode naturelle; et comme
c’est à l’antiquité, à la Grèce qu’il s’attaque, on lui en veut de ne pas
faire des dieux et des déesses de convention, à l’estampille de l’École des
Beaux-Arts. Il pouvait dans sa Fêle de Silène; mieux choisir ses modèles;
mais comment ne pas admirer cette passion, cette fougue, ce mouvement,
ce fond de verdure éblouissant, ces beaux raisins et surtout ce dos de
femme à chevelure rousse, coiffée de quelques fleurettes jaunes! Quand,
en présence d’un pareil morceau, on n’oublie pas les défauts et on
n’éprouve pas un frémissement, c’est qu’on n’aime pas la peinture pour
elle-même et que la vue de beaux coups de brosse donnés en pleine
pâte par une main passionnée ne vous émeut point comme la note d’une
Krauss ou le cri d’un Salvini. Que M. Roll se trompe, qu’il soit une année
moins heureux dans le choix de ses sujets, qu’il offepse les amateurs de
GAZETTE DES BEAUX-ARTS.
certain de nous émouvoir quand il nous transporte dans un de ces coins
de terre que nous aimons, qui nous sont familiers et où nous avons sou-
vent dirigé nos pas et nos rêveries. Il est probable que le saint irlandais
était un simple pêcheur, un paysan qui pouvait fort ressembler à un
marin de Villerville, et un enfant du vne siècle ne devait pas être très
différent d’un gamin de nos jours. M. Duez a donc pour lui la vraisem-
blance, outre la vérité.
Un autre artiste applique aux scènes de l’Ancien et du Nouveau
Testament les mêmes principes que M. Duez, il pense aussi que la meil-
leure manière de représenter les saints personnages est de les faire
vivants et naturels, et de leur donner pour cadre une campagne pro-
chaine comme les peintres florentins ou vénitiens mettaient pour fond à
leur madone ou à leurs saints le paysage qu’ils avaient sous les yeux.
M. Leroi le a de tout autres qualités d’exécution que M. Duez, il est plus
harmonieux que brillant. Jacob chez Laban ne fait pas penser à l’Orient;
les moissons, les bâtiments de ferme, le bel horizon, le ciel de couleur
tendre, toute cette nature rappelle plutôt un département de la France
qu’un coin de la Judée. Trois personnages occupent seuls la grande toile :
Jacob qui fait sa demande, Laban qui l’écoute, et Rachel qui se cache
derrière son père avec un mouvement de pudeur charmant. Quel ensemble
unique de pureté et de sérénité ! comment rendre la couleur argentine
et discrète de l’atmosphère qui enveloppe si bien les choses et les êtres,
et qui donne aux spectateurs une impression d’air et de lumière?
J’ai peine à résister à l’admiration que m’inspirent ces talents
prime-sautiers qui n’acceptent pas d’intermédiaires entre la nature et
eux et qui sont moins préoccupés de perfectionner leurs moyens d’exé-
cution que de garder intacte l’impression qu’ils ont reçue. M. Roll, un
de ceux-là, use avec un peu d’excès de cette méthode naturelle; et comme
c’est à l’antiquité, à la Grèce qu’il s’attaque, on lui en veut de ne pas
faire des dieux et des déesses de convention, à l’estampille de l’École des
Beaux-Arts. Il pouvait dans sa Fêle de Silène; mieux choisir ses modèles;
mais comment ne pas admirer cette passion, cette fougue, ce mouvement,
ce fond de verdure éblouissant, ces beaux raisins et surtout ce dos de
femme à chevelure rousse, coiffée de quelques fleurettes jaunes! Quand,
en présence d’un pareil morceau, on n’oublie pas les défauts et on
n’éprouve pas un frémissement, c’est qu’on n’aime pas la peinture pour
elle-même et que la vue de beaux coups de brosse donnés en pleine
pâte par une main passionnée ne vous émeut point comme la note d’une
Krauss ou le cri d’un Salvini. Que M. Roll se trompe, qu’il soit une année
moins heureux dans le choix de ses sujets, qu’il offepse les amateurs de