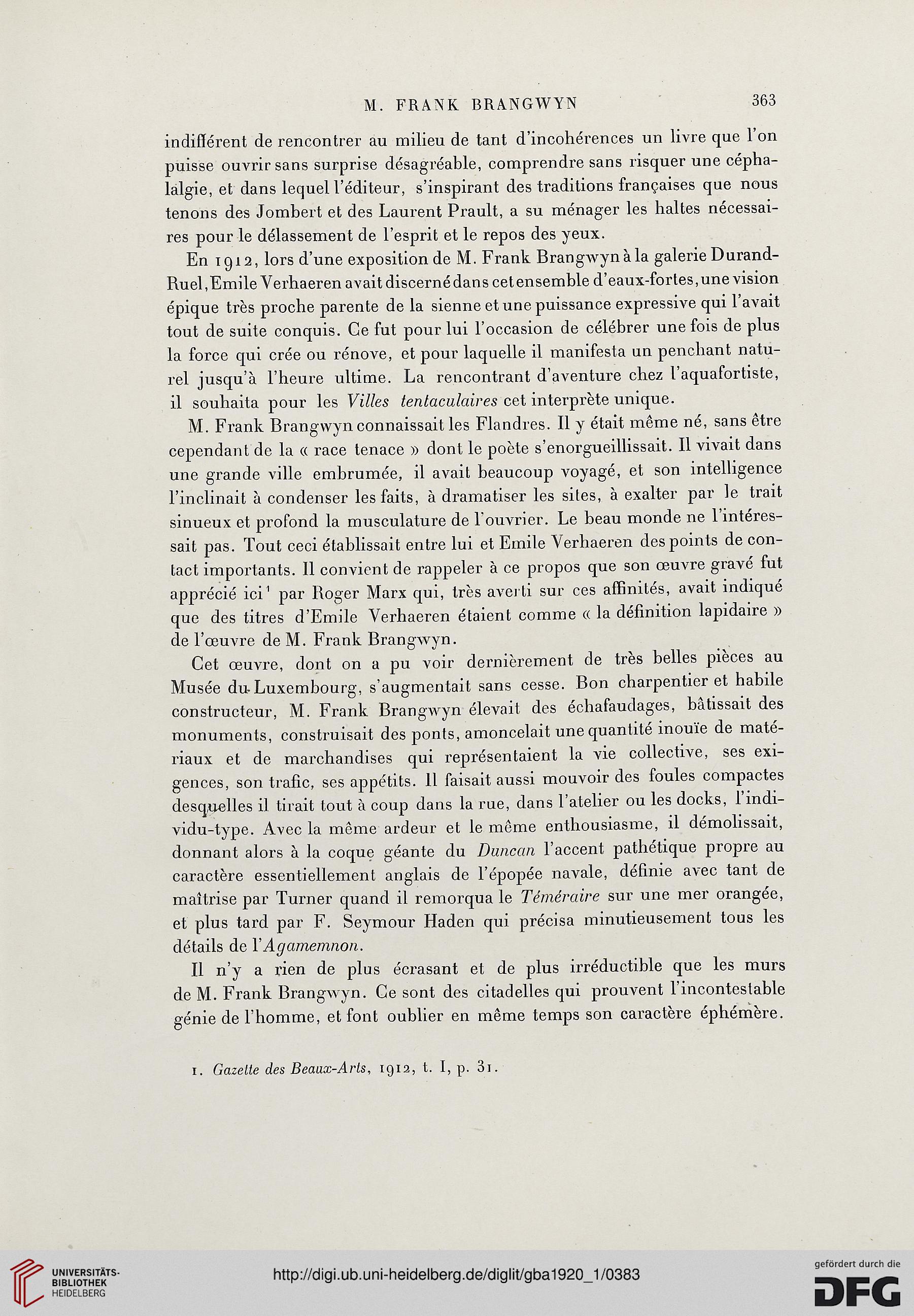M. FRANK BRANGWYN
363
indifférent de rencontrer au milieu de tant d’incohérences un livre que l’on
puisse ouvrir sans surprise désagréable, comprendre sans risquer une cépha-
lalgie, et dans lequel l’éditeur, s’inspirant des traditions françaises que nous
tenons des Jombert et des Laurent Prault, a su ménager les haltes nécessai-
res pour le délassement de l’esprit et le repos des yeux.
En 1912, lors d’une exposition de M. Frank Brangwynàla galerie Durand-
Ruel, Emile Verhaeren avait discerné dans cet ensemble d’eaux-fortes, une vision
épique très proche parente de la sienne et une puissance expressive qui l’avait
tout de suite conquis. Ce fut pour lui l’occasion de célébrer une fois de plus
la force qui crée ou rénove, et pour laquelle il manifesta un penchant natu-
rel jusqu’à l’heure ultime. La rencontrant d’aventure chez l’aquafortiste,
il souhaita pour les Villes tentaculaires cet interprète unique.
M. Frank Brangwyn connaissait les Flandres. Il y était même né, sans être
cependant de la « race tenace » dont le poète s’enorgueillissait. Il vivait dans
une grande ville embrumée, il avait beaucoup voyagé, et son intelligence
l’inclinait à condenser les faits, à dramatiser les sites, à exalter par le trait
sinueux et profond la musculature de 1 ouvrier. Le beau monde ne l'intéres-
sait pas. Tout ceci établissait entre lui et Emile Verhaeren des points de con-
tact importants. 11 convient de rappeler à ce propos que son œuvre gravé fut
apprécié ici1 par Roger Marx qui, très averti sur ces affinités, avait indiqué
que des titres d’Emile Verhaeren étaient comme « la définition lapidaire »
de 1’ œuvre de M. Frank Brangwyn.
Cet œuvre, dont on a pu voir dernièrement de très belles pièces au
Musée du-Luxembourg, s’augmentait sans cesse. Bon charpentier et habile
constructeur, M. Frank Brangwyn élevait des échafaudages, bâtissait des
monuments, construisait des ponts, amoncelait une quantité inouïe de maté-
riaux et de marchandises qui représentaient la vie collective, ses exi-
gences, son trafic, ses appétits. U faisait aussi mouvoir des foules compactes
desquelles il lirait tout à coup dans la rue, dans l’atelier ou les docks, l indi-
vidu-type. Avec la même ardeur et le même enthousiasme, il démolissait,
donnant alors à la coque géante du Duncan l’accent pathétique propre au
caractère essentiellement anglais de l’épopée navale, définie avec tant de
maîtrise par Turner quand il remorqua le Téméraire sur une mer orangée,
et plus tard par F. Seymour Haden qui précisa minutieusement tous les
détails de Y Agamemnon.
Il n’y a rien de plus écrasant et de plus irréductible que les murs
de M. Frank Brangwyn. Ce sont des citadelles qui prouvent l’incontestable
génie de l’homme, et font oublier en même temps son caractère éphémère.
1. Gazette des Beaux-Arts, 1912, t. I, p. 3i.
363
indifférent de rencontrer au milieu de tant d’incohérences un livre que l’on
puisse ouvrir sans surprise désagréable, comprendre sans risquer une cépha-
lalgie, et dans lequel l’éditeur, s’inspirant des traditions françaises que nous
tenons des Jombert et des Laurent Prault, a su ménager les haltes nécessai-
res pour le délassement de l’esprit et le repos des yeux.
En 1912, lors d’une exposition de M. Frank Brangwynàla galerie Durand-
Ruel, Emile Verhaeren avait discerné dans cet ensemble d’eaux-fortes, une vision
épique très proche parente de la sienne et une puissance expressive qui l’avait
tout de suite conquis. Ce fut pour lui l’occasion de célébrer une fois de plus
la force qui crée ou rénove, et pour laquelle il manifesta un penchant natu-
rel jusqu’à l’heure ultime. La rencontrant d’aventure chez l’aquafortiste,
il souhaita pour les Villes tentaculaires cet interprète unique.
M. Frank Brangwyn connaissait les Flandres. Il y était même né, sans être
cependant de la « race tenace » dont le poète s’enorgueillissait. Il vivait dans
une grande ville embrumée, il avait beaucoup voyagé, et son intelligence
l’inclinait à condenser les faits, à dramatiser les sites, à exalter par le trait
sinueux et profond la musculature de 1 ouvrier. Le beau monde ne l'intéres-
sait pas. Tout ceci établissait entre lui et Emile Verhaeren des points de con-
tact importants. 11 convient de rappeler à ce propos que son œuvre gravé fut
apprécié ici1 par Roger Marx qui, très averti sur ces affinités, avait indiqué
que des titres d’Emile Verhaeren étaient comme « la définition lapidaire »
de 1’ œuvre de M. Frank Brangwyn.
Cet œuvre, dont on a pu voir dernièrement de très belles pièces au
Musée du-Luxembourg, s’augmentait sans cesse. Bon charpentier et habile
constructeur, M. Frank Brangwyn élevait des échafaudages, bâtissait des
monuments, construisait des ponts, amoncelait une quantité inouïe de maté-
riaux et de marchandises qui représentaient la vie collective, ses exi-
gences, son trafic, ses appétits. U faisait aussi mouvoir des foules compactes
desquelles il lirait tout à coup dans la rue, dans l’atelier ou les docks, l indi-
vidu-type. Avec la même ardeur et le même enthousiasme, il démolissait,
donnant alors à la coque géante du Duncan l’accent pathétique propre au
caractère essentiellement anglais de l’épopée navale, définie avec tant de
maîtrise par Turner quand il remorqua le Téméraire sur une mer orangée,
et plus tard par F. Seymour Haden qui précisa minutieusement tous les
détails de Y Agamemnon.
Il n’y a rien de plus écrasant et de plus irréductible que les murs
de M. Frank Brangwyn. Ce sont des citadelles qui prouvent l’incontestable
génie de l’homme, et font oublier en même temps son caractère éphémère.
1. Gazette des Beaux-Arts, 1912, t. I, p. 3i.