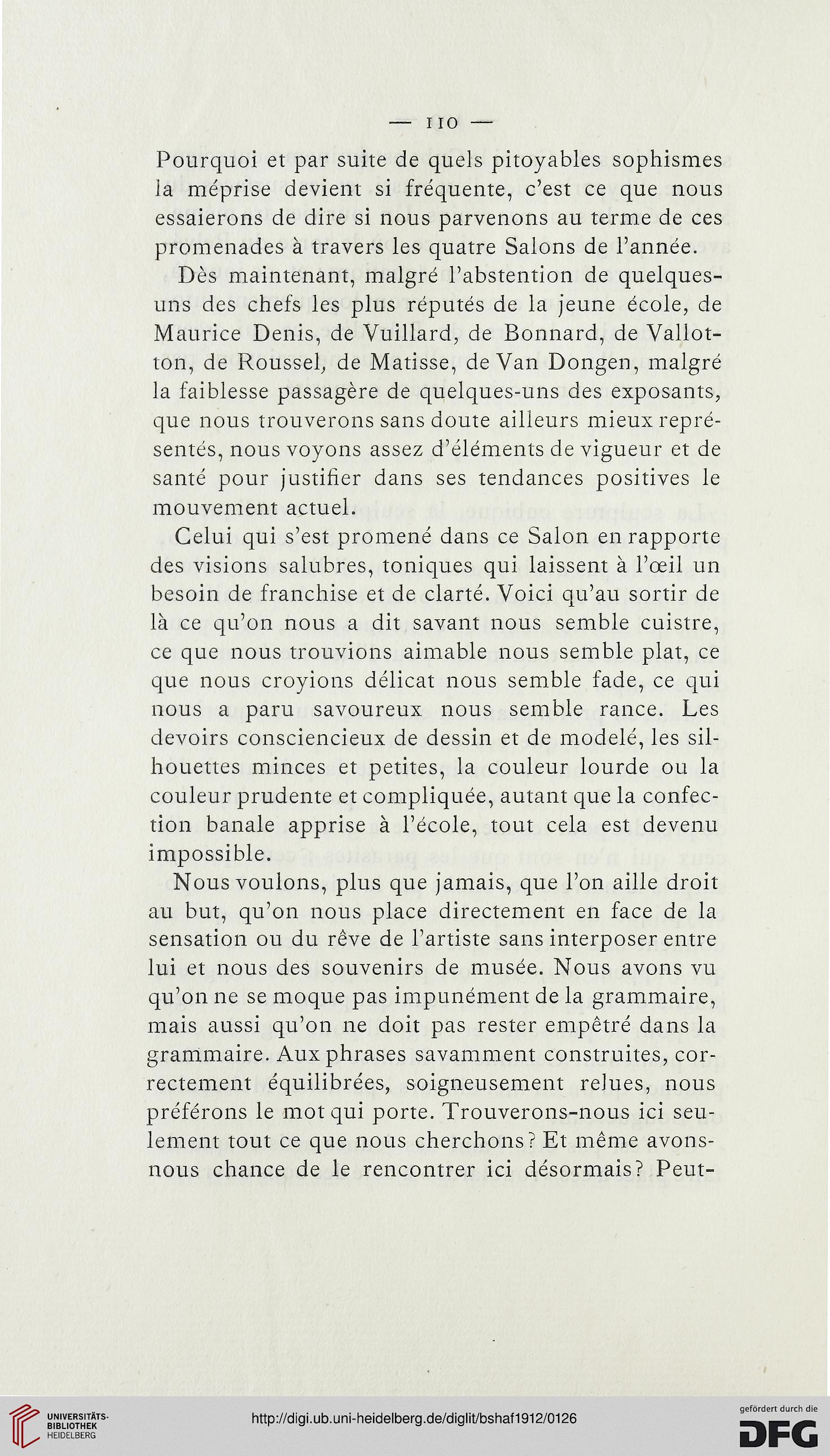I 10
Pourquoi et par suite de quels pitoyables sophismes
la méprise devient si fréquente, c’est ce que nous
essaierons de dire si nous parvenons au terme de ces
promenades à travers les quatre Salons de l’année.
Dès maintenant, malgré l’abstention de quelques-
uns des chefs les plus réputés de la jeune école, de
Maurice Denis, de Vuillard, de Bonnard, de Vallot-
ton, de Roussel, de Matisse, de Van Dongen, malgré
la faiblesse passagère de quelques-uns des exposants,
que nous trouverons sans doute ailleurs mieux repré-
sentés, nous voyons assez d’éléments de vigueur et de
santé pour justifier dans ses tendances positives le
mouvement actuel.
Celui qui s’est promené dans ce Salon en rapporte
des visions salubres, toniques qui laissent à l’œil un
besoin de franchise et de clarté. Voici qu’au sortir de
là ce qu’on nous a dit savant nous semble cuistre,
ce que nous trouvions aimable nous semble plat, ce
que nous croyions délicat nous semble fade, ce qui
nous a paru savoureux nous semble rance. Les
devoirs consciencieux de dessin et de modelé, les sil-
houettes minces et petites, la couleur lourde ou la
couleur prudente et compliquée, autant que la confec-
tion banale apprise à l’école, tout cela est devenu
impossible.
Nous voulons, plus que jamais, que l’on aille droit
au but, qu’on nous place directement en face de la
sensation ou du rêve de l’artiste sans interposer entre
lui et nous des souvenirs de musée. Nous avons vu
qu’on ne se moque pas impunément de la grammaire,
mais aussi qu’on ne doit pas rester empêtré dans la
grammaire. Aux phrases savamment construites, cor-
rectement équilibrées, soigneusement relues, nous
préférons le mot qui porte. Trouverons-nous ici seu-
lement tout ce que nous cherchons? Et même avons-
nous chance de le rencontrer ici désormais? Peut-
Pourquoi et par suite de quels pitoyables sophismes
la méprise devient si fréquente, c’est ce que nous
essaierons de dire si nous parvenons au terme de ces
promenades à travers les quatre Salons de l’année.
Dès maintenant, malgré l’abstention de quelques-
uns des chefs les plus réputés de la jeune école, de
Maurice Denis, de Vuillard, de Bonnard, de Vallot-
ton, de Roussel, de Matisse, de Van Dongen, malgré
la faiblesse passagère de quelques-uns des exposants,
que nous trouverons sans doute ailleurs mieux repré-
sentés, nous voyons assez d’éléments de vigueur et de
santé pour justifier dans ses tendances positives le
mouvement actuel.
Celui qui s’est promené dans ce Salon en rapporte
des visions salubres, toniques qui laissent à l’œil un
besoin de franchise et de clarté. Voici qu’au sortir de
là ce qu’on nous a dit savant nous semble cuistre,
ce que nous trouvions aimable nous semble plat, ce
que nous croyions délicat nous semble fade, ce qui
nous a paru savoureux nous semble rance. Les
devoirs consciencieux de dessin et de modelé, les sil-
houettes minces et petites, la couleur lourde ou la
couleur prudente et compliquée, autant que la confec-
tion banale apprise à l’école, tout cela est devenu
impossible.
Nous voulons, plus que jamais, que l’on aille droit
au but, qu’on nous place directement en face de la
sensation ou du rêve de l’artiste sans interposer entre
lui et nous des souvenirs de musée. Nous avons vu
qu’on ne se moque pas impunément de la grammaire,
mais aussi qu’on ne doit pas rester empêtré dans la
grammaire. Aux phrases savamment construites, cor-
rectement équilibrées, soigneusement relues, nous
préférons le mot qui porte. Trouverons-nous ici seu-
lement tout ce que nous cherchons? Et même avons-
nous chance de le rencontrer ici désormais? Peut-