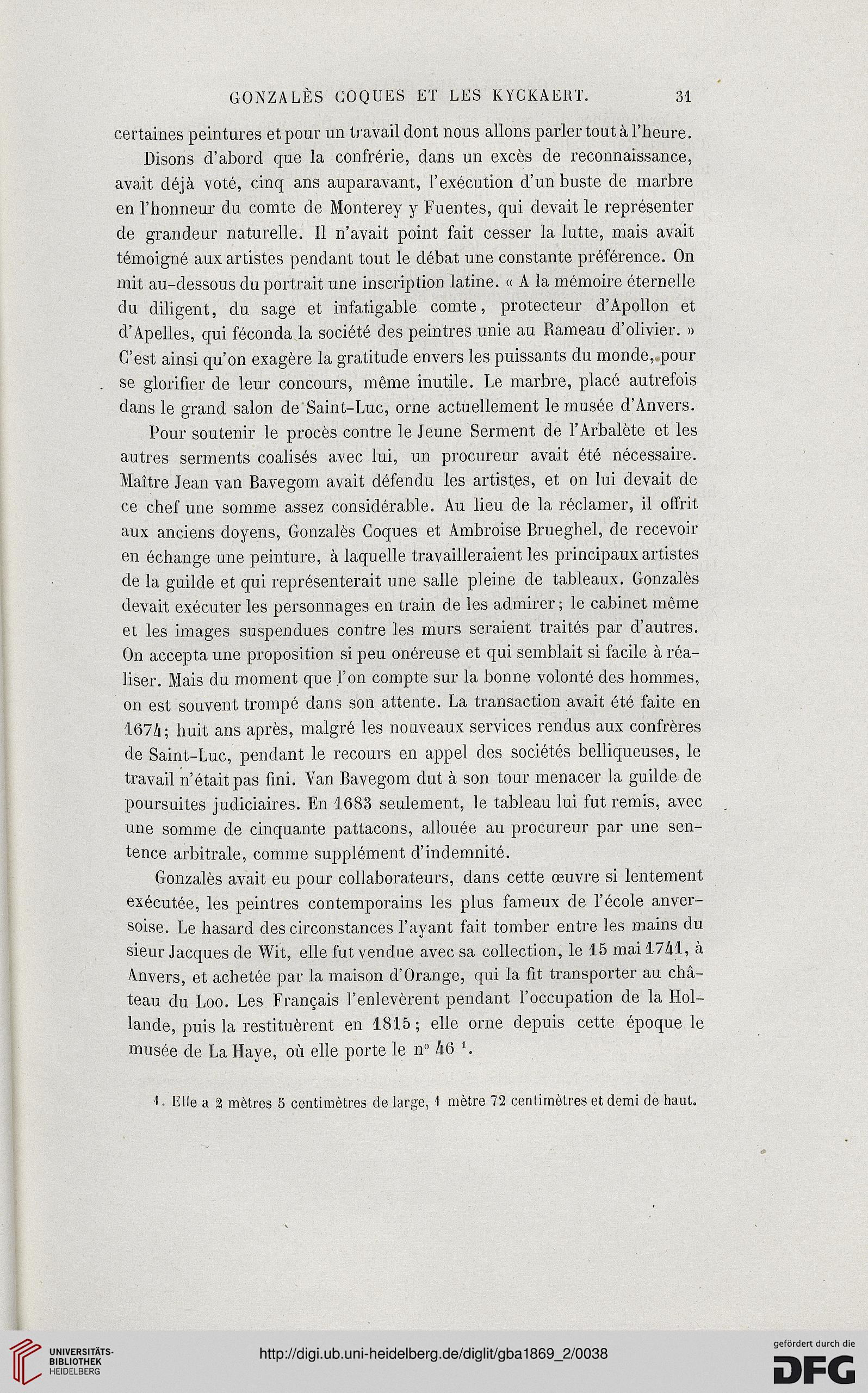GONZALÈS COQUES ET LES KYCKAERT.
31
certaines peintures et pour un travail dont nous allons parler tout à l’heure.
Disons d’abord que la confrérie, dans un excès de reconnaissance,
avait déjà voté, cinq ans auparavant, l’exécution d’un buste de marbre
en l’honneur du comte de Monterey y Fuentes, qui devait le représenter
de grandeur naturelle. Il n’avait point fait cesser la lutte, mais avait
témoigné aux artistes pendant tout le débat une constante préférence. On
mit au-dessous du portrait une inscription latine. « A la mémoire éternelle
du diligent, du sage et infatigable comte, protecteur d’Apollon et
d’Apelles, qui féconda la société des peintres unie au Rameau d’olivier. »
C’est ainsi qu’on exagère la gratitude envers les puissants du monde, .pour
se glorifier de leur concours, même inutile. Le marbre, placé autrefois
dans le grand salon de Saint-Luc, orne actuellement le musée d’Anvers.
Pour soutenir le procès contre le Jeune Serment de l’Arbalète et les
autres serments coalisés avec lui, un procureur avait été nécessaire.
Maître Jean van Bavegom avait défendu les artistes, et on lui devait de
ce chef une somme assez considérable. Au lieu de la réclamer, il offrit
aux anciens doyens, Gonzalès Coques et Ambroise Brueghel, de recevoir
en échange une peinture, à laquelle travailleraient les principaux artistes
de la guilde et qui représenterait une salle pleine de tableaux. Gonzalès
devait exécuter les personnages en train de les admirer ; le cabinet même
et les images suspendues contre les murs seraient traités par d’autres.
On accepta une proposition si peu onéreuse et qui semblait si facile à réa-
liser. Mais du moment que l’on compte sur la bonne volonté des hommes,
on est souvent trompé dans son attente. La transaction avait été faite en
167/i ; huit ans après, malgré les nouveaux services rendus aux confrères
de Saint-Luc, pendant le recours en appel des sociétés belliqueuses, le
travail n’était pas fini. Van Bavegom dut à son tour menacer la guilde de
poursuites judiciaires. En 1683 seulement, le tableau lui fut remis, avec
une somme de cinquante pattacons, allouée au procureur par une sen-
tence arbitrale, comme supplément d’indemnité.
Gonzalès avait eu pour collaborateurs, dans cette œuvre si lentement
exécutée, les peintres contemporains les plus fameux de l’école anver-
soise. Le hasard des circonstances l’ayant fait tomber entre les mains du
sieur Jacques de Wit, elle fut vendue avec sa collection, le 15 mai 1741, à
Anvers, et achetée par la maison d’Orange, qui la fit transporter au châ-
teau du Loo. Les Français l’enlevèrent pendant l’occupation de la Hol-
lande, puis la restituèrent en 1815; elle orne depuis cette époque le
musée de La Haye, où elle porte le n° 46 1.
I • Elle a 2 mètres 5 centimètres de large, I mètre 72 centimètres et demi de haut.
31
certaines peintures et pour un travail dont nous allons parler tout à l’heure.
Disons d’abord que la confrérie, dans un excès de reconnaissance,
avait déjà voté, cinq ans auparavant, l’exécution d’un buste de marbre
en l’honneur du comte de Monterey y Fuentes, qui devait le représenter
de grandeur naturelle. Il n’avait point fait cesser la lutte, mais avait
témoigné aux artistes pendant tout le débat une constante préférence. On
mit au-dessous du portrait une inscription latine. « A la mémoire éternelle
du diligent, du sage et infatigable comte, protecteur d’Apollon et
d’Apelles, qui féconda la société des peintres unie au Rameau d’olivier. »
C’est ainsi qu’on exagère la gratitude envers les puissants du monde, .pour
se glorifier de leur concours, même inutile. Le marbre, placé autrefois
dans le grand salon de Saint-Luc, orne actuellement le musée d’Anvers.
Pour soutenir le procès contre le Jeune Serment de l’Arbalète et les
autres serments coalisés avec lui, un procureur avait été nécessaire.
Maître Jean van Bavegom avait défendu les artistes, et on lui devait de
ce chef une somme assez considérable. Au lieu de la réclamer, il offrit
aux anciens doyens, Gonzalès Coques et Ambroise Brueghel, de recevoir
en échange une peinture, à laquelle travailleraient les principaux artistes
de la guilde et qui représenterait une salle pleine de tableaux. Gonzalès
devait exécuter les personnages en train de les admirer ; le cabinet même
et les images suspendues contre les murs seraient traités par d’autres.
On accepta une proposition si peu onéreuse et qui semblait si facile à réa-
liser. Mais du moment que l’on compte sur la bonne volonté des hommes,
on est souvent trompé dans son attente. La transaction avait été faite en
167/i ; huit ans après, malgré les nouveaux services rendus aux confrères
de Saint-Luc, pendant le recours en appel des sociétés belliqueuses, le
travail n’était pas fini. Van Bavegom dut à son tour menacer la guilde de
poursuites judiciaires. En 1683 seulement, le tableau lui fut remis, avec
une somme de cinquante pattacons, allouée au procureur par une sen-
tence arbitrale, comme supplément d’indemnité.
Gonzalès avait eu pour collaborateurs, dans cette œuvre si lentement
exécutée, les peintres contemporains les plus fameux de l’école anver-
soise. Le hasard des circonstances l’ayant fait tomber entre les mains du
sieur Jacques de Wit, elle fut vendue avec sa collection, le 15 mai 1741, à
Anvers, et achetée par la maison d’Orange, qui la fit transporter au châ-
teau du Loo. Les Français l’enlevèrent pendant l’occupation de la Hol-
lande, puis la restituèrent en 1815; elle orne depuis cette époque le
musée de La Haye, où elle porte le n° 46 1.
I • Elle a 2 mètres 5 centimètres de large, I mètre 72 centimètres et demi de haut.