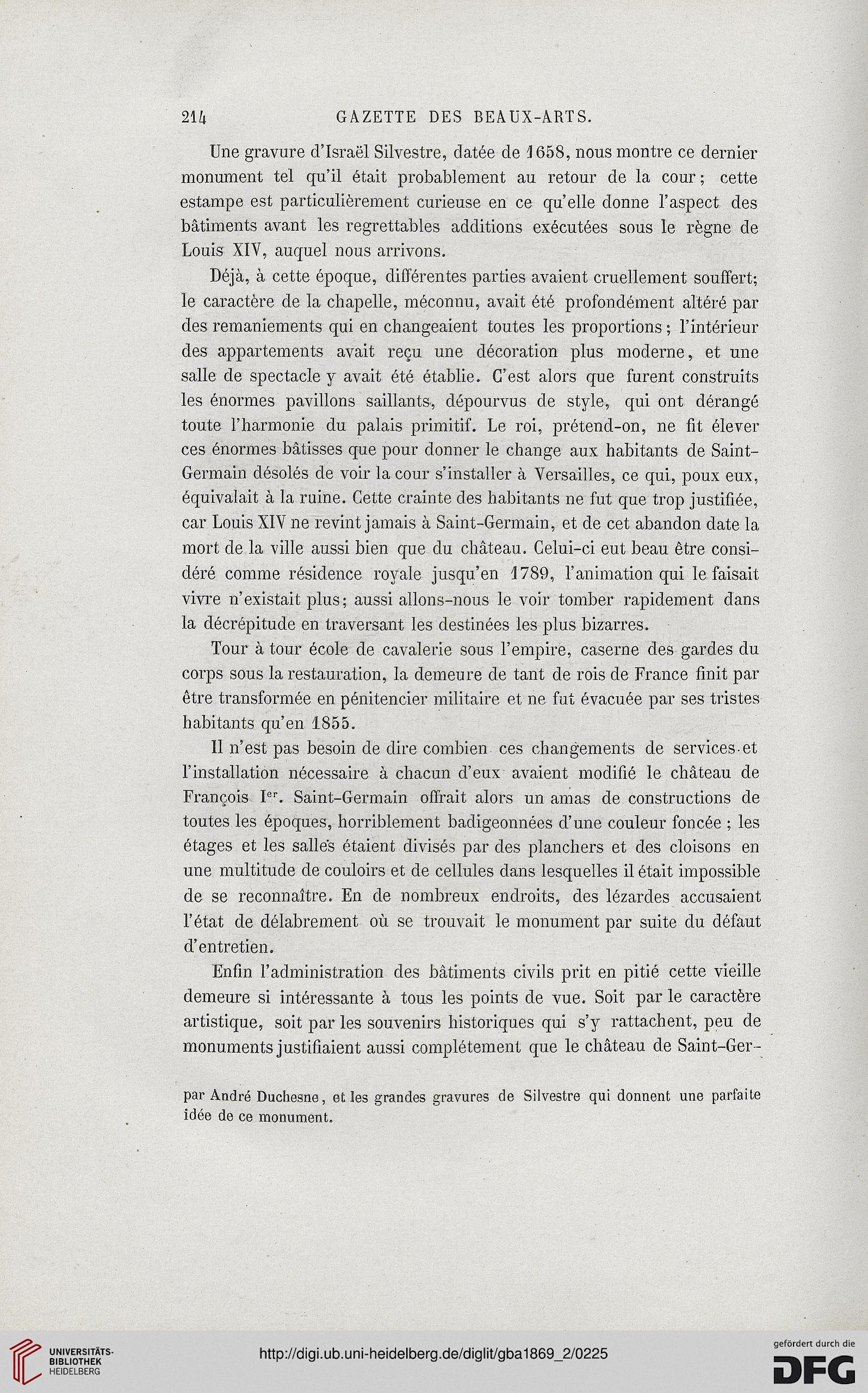GAZETTE DES BEAUX-ARTS.
214
Une gravure d’Israël Silvestre, datée de 1658, nous montre ce dernier
monument tel qu’il était probablement au retour de la cour; cette
estampe est particulièrement curieuse en ce quelle donne l’aspect des
bâtiments avant les regrettables additions exécutées sous le règne de
Louis XIV, auquel nous arrivons.
Déjà, à cette époque, différentes parties avaient cruellement souffert;
le caractère de la chapelle, méconnu, avait été profondément altéré par
des remaniements qui en changeaient toutes les proportions ; l’intérieur
des appartements avait reçu une décoration plus moderne, et une
salle de spectacle y avait été établie. C’est alors que furent construits
les énormes pavillons saillants, dépourvus de style, qui ont dérangé
toute l’harmonie du palais primitif. Le roi, prétend-on, ne fit élever
ces énormes bâtisses que pour donner le change aux habitants de Saint-
Germain désolés de voir la cour s’installer à Versailles, ce qui, poux eux,
équivalait à la ruine. Cette crainte des habitants ne fut que trop justifiée,
car Louis XIV ne revint jamais à Saint-Germain, et de cet abandon date la
mort de la ville aussi bien que du château. Celui-ci eut beau être consi-
déré comme résidence royale jusqu’en 1789, l’animation qui le faisait
vivre n’existait plus; aussi allons-nous le voir tomber rapidement dans
la décrépitude en traversant les destinées les plus bizarres.
Tour à tour école de cavalerie sous l’empire, caserne des gardes du
corps sous la restauration, la demeure de tant de rois de France finit par
être transformée en pénitencier militaire et ne fut évacuée par ses tristes
habitants qu’en 1855.
Il n’est pas besoin de dire combien ces changements de services-et
l’installation nécessaire à chacun d’eux avaient modifié le château de
François Ier. Saint-Germain offrait alors un amas de constructions de
toutes les époques, horriblement badigeonnées d’une couleur foncée ; les
étages et les salles étaient divisés par des planchers et des cloisons en
une multitude de couloirs et de cellules dans lesquelles il était impossible
de se reconnaître. En de nombreux endroits, des lézardes accusaient
l’état de délabrement où se trouvait le monument par suite du défaut
d’entretien.
Enfin l’administration des bâtiments civils prit en pitié cette vieille
demeure si intéressante à tous les points de vue. Soit par le caractère
artistique, soit par les souvenirs historiques qui s’y rattachent, peu de
monuments justifiaient aussi complètement que le château de Saint-Ger-
par André Duchesne, et les grandes gravures de Silvestre qui donnent une parfaite
idée de ce monument.
214
Une gravure d’Israël Silvestre, datée de 1658, nous montre ce dernier
monument tel qu’il était probablement au retour de la cour; cette
estampe est particulièrement curieuse en ce quelle donne l’aspect des
bâtiments avant les regrettables additions exécutées sous le règne de
Louis XIV, auquel nous arrivons.
Déjà, à cette époque, différentes parties avaient cruellement souffert;
le caractère de la chapelle, méconnu, avait été profondément altéré par
des remaniements qui en changeaient toutes les proportions ; l’intérieur
des appartements avait reçu une décoration plus moderne, et une
salle de spectacle y avait été établie. C’est alors que furent construits
les énormes pavillons saillants, dépourvus de style, qui ont dérangé
toute l’harmonie du palais primitif. Le roi, prétend-on, ne fit élever
ces énormes bâtisses que pour donner le change aux habitants de Saint-
Germain désolés de voir la cour s’installer à Versailles, ce qui, poux eux,
équivalait à la ruine. Cette crainte des habitants ne fut que trop justifiée,
car Louis XIV ne revint jamais à Saint-Germain, et de cet abandon date la
mort de la ville aussi bien que du château. Celui-ci eut beau être consi-
déré comme résidence royale jusqu’en 1789, l’animation qui le faisait
vivre n’existait plus; aussi allons-nous le voir tomber rapidement dans
la décrépitude en traversant les destinées les plus bizarres.
Tour à tour école de cavalerie sous l’empire, caserne des gardes du
corps sous la restauration, la demeure de tant de rois de France finit par
être transformée en pénitencier militaire et ne fut évacuée par ses tristes
habitants qu’en 1855.
Il n’est pas besoin de dire combien ces changements de services-et
l’installation nécessaire à chacun d’eux avaient modifié le château de
François Ier. Saint-Germain offrait alors un amas de constructions de
toutes les époques, horriblement badigeonnées d’une couleur foncée ; les
étages et les salles étaient divisés par des planchers et des cloisons en
une multitude de couloirs et de cellules dans lesquelles il était impossible
de se reconnaître. En de nombreux endroits, des lézardes accusaient
l’état de délabrement où se trouvait le monument par suite du défaut
d’entretien.
Enfin l’administration des bâtiments civils prit en pitié cette vieille
demeure si intéressante à tous les points de vue. Soit par le caractère
artistique, soit par les souvenirs historiques qui s’y rattachent, peu de
monuments justifiaient aussi complètement que le château de Saint-Ger-
par André Duchesne, et les grandes gravures de Silvestre qui donnent une parfaite
idée de ce monument.