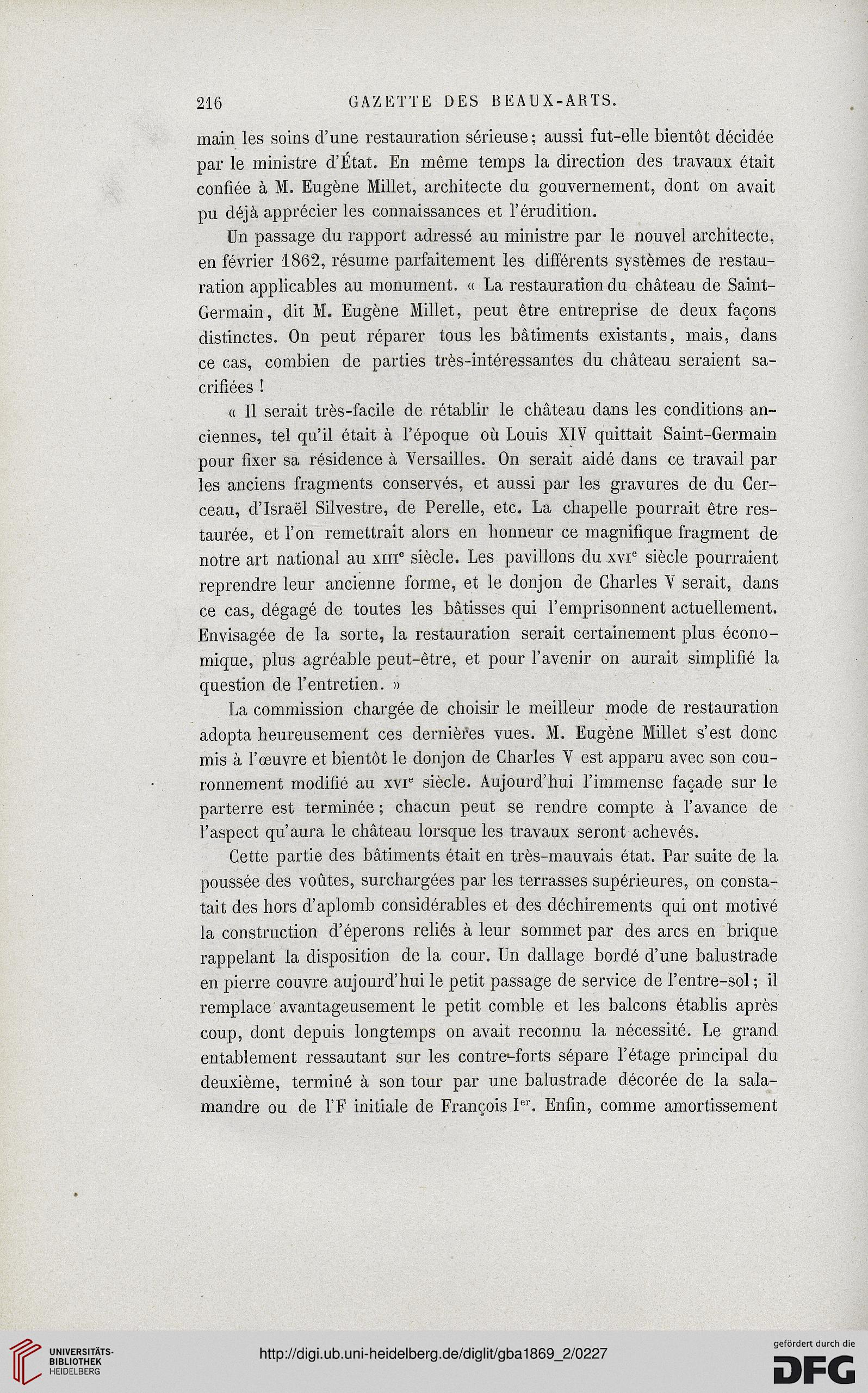216
GAZETTE DES BEAUX-ARTS.
main les soins d’une restauration sérieuse; aussi fut-elle bientôt décidée
par le ministre d’Etat. En même temps la direction des travaux était
confiée à M. Eugène Millet, architecte du gouvernement, dont on avait
pu déjà apprécier les connaissances et l’érudition.
Un passage du rapport adressé au ministre par le nouvel architecte,
en février 1862, résume parfaitement les différents systèmes de restau-
ration applicables au monument. « La restauration du château de Saint-
Germain, dit M. Eugène Millet, peut être entreprise de deux façons
distinctes. On peut réparer tous les bâtiments existants, mais, dans
ce cas, combien de parties très-intéressantes du château seraient sa-
crifiées !
ce II serait très-facile de rétablir le château dans les conditions an-
ciennes, tel qu’il était à l’époque où Louis XIV quittait Saint-Germain
pour fixer sa résidence à Versailles. On serait aidé dans ce travail par
les anciens fragments conservés, et aussi par les gravures de du Cer-
ceau, d’Israël Silvestre, de Perelle, etc. La chapelle pourrait être res-
taurée, et l’on remettrait alors en honneur ce magnifique fragment de
notre art national au xme siècle. Les pavillons du xvie siècle pourraient
reprendre leur ancienne forme, et le donjon de Charles V serait, dans
ce cas, dégagé de toutes les bâtisses qui l’emprisonnent actuellement.
Envisagée de la sorte, la restauration serait certainement plus écono-
mique, plus agréable peut-être, et pour l’avenir on aurait simplifié la
question de l’entretien. »
La commission chargée de choisir le meilleur mode de restauration
adopta heureusement ces dernières vues. M. Eugène Millet s’est donc
mis à l’œuvre et bientôt le donjon de Charles V est apparu avec son cou-
ronnement modifié au xvi“ siècle. Aujourd’hui l’immense façade sur le
parterre est terminée ; chacun peut se rendre compte à l’avance de
l’aspect qu’aura le château lorsque les travaux seront achevés.
Cette partie des bâtiments était en très-mauvais état. Par suite de la
poussée des voûtes, surchargées par les terrasses supérieures, on consta-
tait des hors d’aplomb considérables et des déchirements qui ont motivé
la construction d’éperons reliés à leur sommet par des arcs en brique
rappelant la disposition de la cour. Un dallage bordé d’une balustrade
en pierre couvre aujourd’hui le petit passage de service de l’entre-sol ; il
remplace avantageusement le petit comble et les balcons établis après
coup, dont depuis longtemps on avait reconnu la nécessité. Le grand
entablement ressautant sur les contre*-forts sépare l’étage principal du
deuxième, terminé à son tour par une balustrade décorée de la sala-
mandre ou de l’F initiale de François Ier. Enfin, comme amortissement
GAZETTE DES BEAUX-ARTS.
main les soins d’une restauration sérieuse; aussi fut-elle bientôt décidée
par le ministre d’Etat. En même temps la direction des travaux était
confiée à M. Eugène Millet, architecte du gouvernement, dont on avait
pu déjà apprécier les connaissances et l’érudition.
Un passage du rapport adressé au ministre par le nouvel architecte,
en février 1862, résume parfaitement les différents systèmes de restau-
ration applicables au monument. « La restauration du château de Saint-
Germain, dit M. Eugène Millet, peut être entreprise de deux façons
distinctes. On peut réparer tous les bâtiments existants, mais, dans
ce cas, combien de parties très-intéressantes du château seraient sa-
crifiées !
ce II serait très-facile de rétablir le château dans les conditions an-
ciennes, tel qu’il était à l’époque où Louis XIV quittait Saint-Germain
pour fixer sa résidence à Versailles. On serait aidé dans ce travail par
les anciens fragments conservés, et aussi par les gravures de du Cer-
ceau, d’Israël Silvestre, de Perelle, etc. La chapelle pourrait être res-
taurée, et l’on remettrait alors en honneur ce magnifique fragment de
notre art national au xme siècle. Les pavillons du xvie siècle pourraient
reprendre leur ancienne forme, et le donjon de Charles V serait, dans
ce cas, dégagé de toutes les bâtisses qui l’emprisonnent actuellement.
Envisagée de la sorte, la restauration serait certainement plus écono-
mique, plus agréable peut-être, et pour l’avenir on aurait simplifié la
question de l’entretien. »
La commission chargée de choisir le meilleur mode de restauration
adopta heureusement ces dernières vues. M. Eugène Millet s’est donc
mis à l’œuvre et bientôt le donjon de Charles V est apparu avec son cou-
ronnement modifié au xvi“ siècle. Aujourd’hui l’immense façade sur le
parterre est terminée ; chacun peut se rendre compte à l’avance de
l’aspect qu’aura le château lorsque les travaux seront achevés.
Cette partie des bâtiments était en très-mauvais état. Par suite de la
poussée des voûtes, surchargées par les terrasses supérieures, on consta-
tait des hors d’aplomb considérables et des déchirements qui ont motivé
la construction d’éperons reliés à leur sommet par des arcs en brique
rappelant la disposition de la cour. Un dallage bordé d’une balustrade
en pierre couvre aujourd’hui le petit passage de service de l’entre-sol ; il
remplace avantageusement le petit comble et les balcons établis après
coup, dont depuis longtemps on avait reconnu la nécessité. Le grand
entablement ressautant sur les contre*-forts sépare l’étage principal du
deuxième, terminé à son tour par une balustrade décorée de la sala-
mandre ou de l’F initiale de François Ier. Enfin, comme amortissement