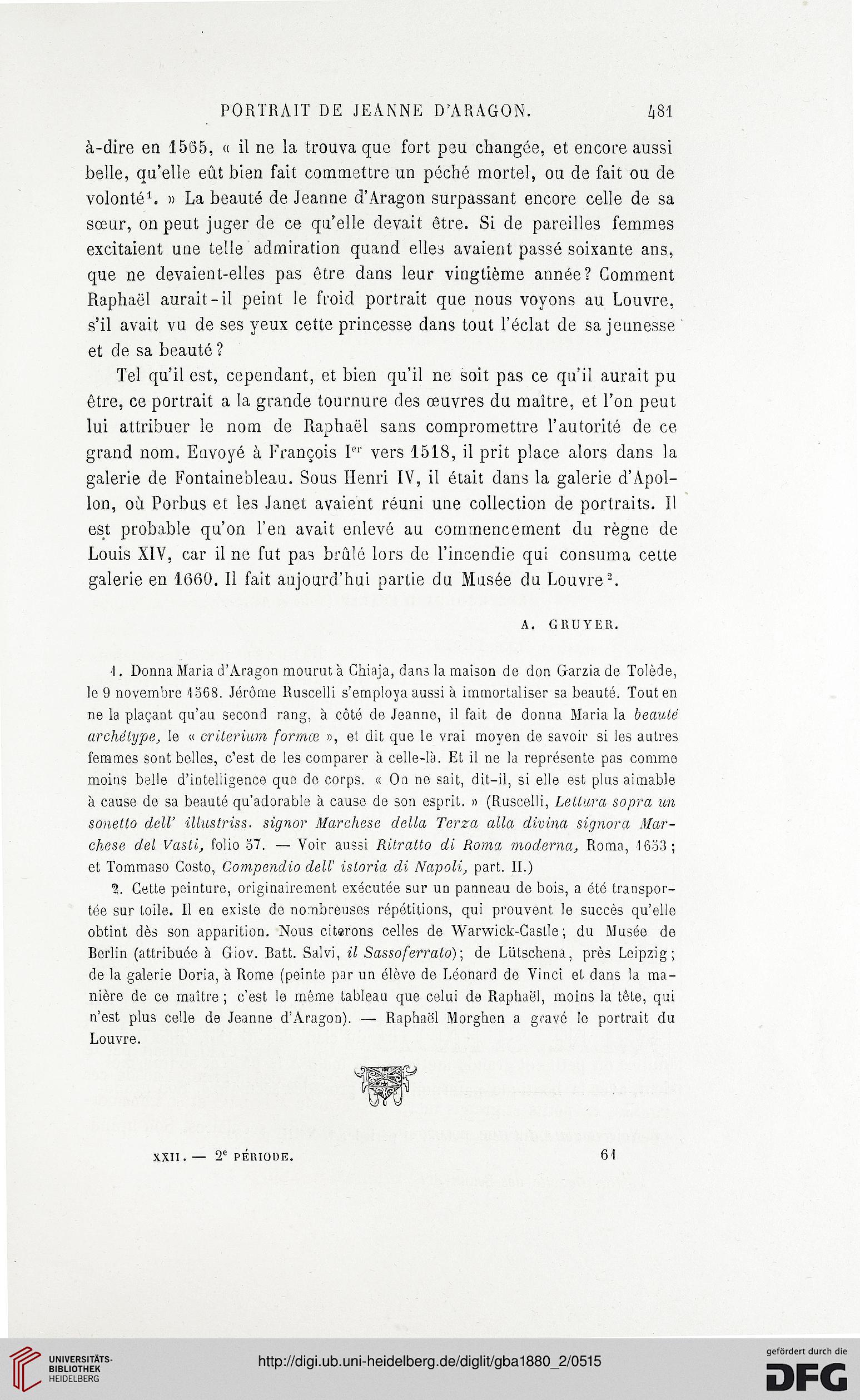PORTRAIT DE JEANNE D'ARAGON.
481
à-dire en 1555, « il ne la trouva que fort peu changée, et encore aussi
belle, qu'elle eût bien fait commettre un péché mortel, ou de fait ou de
volonté1. » La beauté de Jeanne d'Aragon surpassant encore celle de sa
sœur, on peut juger de ce qu'elle devait être. Si de pareilles femmes
excitaient une telle admiration quand elles avaient passé soixante ans,
que ne devaient-elles pas être dans leur vingtième année? Gomment
Raphaël aurait-il peint le froid portrait que nous voyons au Louvre,
s'il avait vu de ses yeux cette princesse dans tout l'éclat de sa jeunesse
et de sa beauté ?
Tel qu'il est, cependant, et bien qu'il ne soit pas ce qu'il aurait pu
être, ce portrait a la grande tournure des œuvres du maître, et l'on peut
lui attribuer le nom de Raphaël sans compromettre l'autorité de ce
grand nom. Envoyé à François Ier vers 1518, il prit place alors dans la
galerie de Fontainebleau, Sous Henri IV, il était dans la galerie d'Apol-
lon, où Porbus et les Janct avaient réuni une collection de portraits. 11
est probable qu'on l'en avait enlevé au commencement du règne de
Louis XIV, car il ne fut pas brûlé lors de l'incendie qui consuma cette
galerie en 1660. Il fait aujourd'hui partie du Musée du Louvre2.
<l. Donna Maria d'Aragon mourut à Chiaja, dans la maison de don Garzia de Tolède,
le 9 novembre 1S68. Jérôme Ruscelli s'employa aussi à immortaliser sa beauté. Tout en
ne la plaçant qu'au second rang, à côté de Jeanne, il fait de donna Maria la beauté
archétype, le « critérium formœ », et dit que le vrai moyen de savoir si les autres
femmes sont belles, c'est de les comparer à celle-là. Et il ne la représente pas comme
moins belle d'intelligence que de corps. « On ne sait, dit-il, si elle est plus aimable
à cause de sa beauté qu'adorable à cause de son esprit. » (Ruscelli, Lettura sopra un
sonetto delV illustriss. signor Marchese delta Terza alla divina signora Mar-
chese del V.asti, folio 37. — Voir aussi Ritratto di Roma modema, Roma, I653;
et Tommaso Costo, Compendio deW istoria di Najjoli, part. II.)
%. Cette peinture, originairement exécutée sur un panneau de bois, a été transpor-
tée sur toile. Il en existe de nombreuses répétitions, qui prouvent le succès qu'elle
obtint dès son apparition. Nous citerons celles de Warwick-Castle ; du Musée de
Berlin (attribuée à Giov. Batt. Salvi, il Sassoferrato); de Lutschena, près Leipzig;
de la galerie Doria, à Rome (peinte par un élève de Léonard de Vinci et dans la ma-
nière de ce maître ; c'est le même tableau que celui de Raphaël, moins la tête, qui
n'est plus celle de Jeanne d'Aragon). — Raphaël Morghen a gravé le portrait du
Louvre.
A.
GRUYER.
XXII
. — 2e
PERIODE.
61
481
à-dire en 1555, « il ne la trouva que fort peu changée, et encore aussi
belle, qu'elle eût bien fait commettre un péché mortel, ou de fait ou de
volonté1. » La beauté de Jeanne d'Aragon surpassant encore celle de sa
sœur, on peut juger de ce qu'elle devait être. Si de pareilles femmes
excitaient une telle admiration quand elles avaient passé soixante ans,
que ne devaient-elles pas être dans leur vingtième année? Gomment
Raphaël aurait-il peint le froid portrait que nous voyons au Louvre,
s'il avait vu de ses yeux cette princesse dans tout l'éclat de sa jeunesse
et de sa beauté ?
Tel qu'il est, cependant, et bien qu'il ne soit pas ce qu'il aurait pu
être, ce portrait a la grande tournure des œuvres du maître, et l'on peut
lui attribuer le nom de Raphaël sans compromettre l'autorité de ce
grand nom. Envoyé à François Ier vers 1518, il prit place alors dans la
galerie de Fontainebleau, Sous Henri IV, il était dans la galerie d'Apol-
lon, où Porbus et les Janct avaient réuni une collection de portraits. 11
est probable qu'on l'en avait enlevé au commencement du règne de
Louis XIV, car il ne fut pas brûlé lors de l'incendie qui consuma cette
galerie en 1660. Il fait aujourd'hui partie du Musée du Louvre2.
<l. Donna Maria d'Aragon mourut à Chiaja, dans la maison de don Garzia de Tolède,
le 9 novembre 1S68. Jérôme Ruscelli s'employa aussi à immortaliser sa beauté. Tout en
ne la plaçant qu'au second rang, à côté de Jeanne, il fait de donna Maria la beauté
archétype, le « critérium formœ », et dit que le vrai moyen de savoir si les autres
femmes sont belles, c'est de les comparer à celle-là. Et il ne la représente pas comme
moins belle d'intelligence que de corps. « On ne sait, dit-il, si elle est plus aimable
à cause de sa beauté qu'adorable à cause de son esprit. » (Ruscelli, Lettura sopra un
sonetto delV illustriss. signor Marchese delta Terza alla divina signora Mar-
chese del V.asti, folio 37. — Voir aussi Ritratto di Roma modema, Roma, I653;
et Tommaso Costo, Compendio deW istoria di Najjoli, part. II.)
%. Cette peinture, originairement exécutée sur un panneau de bois, a été transpor-
tée sur toile. Il en existe de nombreuses répétitions, qui prouvent le succès qu'elle
obtint dès son apparition. Nous citerons celles de Warwick-Castle ; du Musée de
Berlin (attribuée à Giov. Batt. Salvi, il Sassoferrato); de Lutschena, près Leipzig;
de la galerie Doria, à Rome (peinte par un élève de Léonard de Vinci et dans la ma-
nière de ce maître ; c'est le même tableau que celui de Raphaël, moins la tête, qui
n'est plus celle de Jeanne d'Aragon). — Raphaël Morghen a gravé le portrait du
Louvre.
A.
GRUYER.
XXII
. — 2e
PERIODE.
61