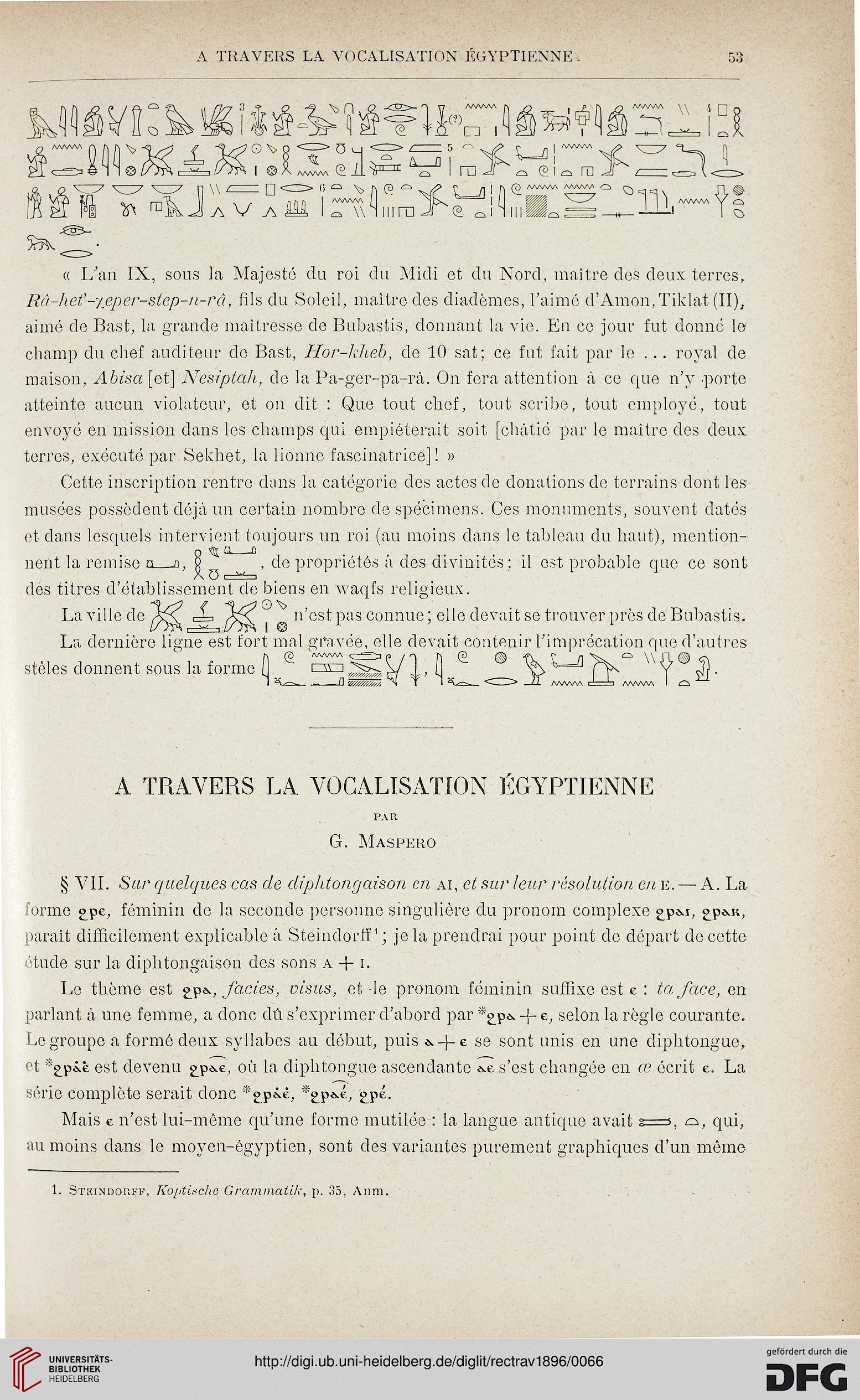a travers la vocalisation egyptienne.
53
W * □
a £ ^37 n\\C=:[]<Oliû ^ rs (9 ^ ^> r_fl | ^ (3 amma m«w o 0=q=3\ Il
£2>
« L'an IX, sous la Majesté (lu roi du Midi et du Nord, maître des deux terres,
Râ-het'—yeper-^step-n-râ, fils du Soleil, maître des diadèmes, l'aimé d'Amon.Tiklat (II),
aimé de Bast, la grande maîtresse de Bubastis, donnant la vie. En ce jour fut donne le
champ du chef auditeur de Bast, Hor-kheh, de 10 sat; ce fut fait par h; ... royal de
maison, Abisa [et] Nesiptaii, de la Pa-ger-pa-râ. On fera attention à ce que n'y porte
atteinte aucun violateur, et on dit : Que tout chef, tout scribe, tout employé, tout
envoyé en mission dans les champs qui empiéterait soit [châtié par le maître des deux
terres, exécuté par Sekhet, la lionne fascinatrice] ! »
Cette inscription rentre dans la catégorie des actes de donations de terrains dont les
musées possèdent déjà un certain nombre do spécimens. Ces monuments, souvent datés
et clans lesquels intervient toujours un roi (au moins dans le tableau du haut), mention-
n ^ a_h
nent la remise a_o, 8 , de propriétés à des divinités ; il est probable que ce sont
des titres d'établissement cle biens en waqfs religieux.
La ville de S=> ' • n'est pas connue ; elle devait se trouver près de Bubastis.
La dernière ligne est fort mal gravée, elle devait contenir L'imprécation que d'autres
t\ (à 'wam cr^> p y v* /v @ OfVr 71 <=? \\n@ o
stèles donnent sous la forme (. i=so { Y\ fV Y il •
A TRAVERS LA VOCALISATION ÉGYPTIENNE
PAR
G. Maspero
§ VII. Sur quelques cas cle diphtongaison en ai, et sur leur résolution en e.— A. La
forme <>pe, féminin cle la seconde personne singulière du pronom complexe <>p^i, £P^k,
parait difficilement explicable â Steindorlï' ; je la prendrai pour point cle départ cle cette
étude sur la diphtongaison des sons a + i.
Le thème est faciès, visus, et le pronom féminin suffixe est e : ta face, en
parlant à une femme, a donc dû s'exprimer d'abord par *£p> -f- e, selon la règle courante.
Le groupe a formé deux syllabes au début, puis Ô.-J- e se sont unis en une diphtongue,
et \p^ê est devenu <>pd.e, où la diphtongue ascendante s'est changée en œ écrit e. La
série complète serait clone *£p^ê, *£P^é, g.pé.
Mais e n'est lui-même qu'une forme mutilée : la langue antique avait g—>, qui,
au moins clans le moyen-égyptien, sont des variantes purement graphiques d'un même
1. Steindouff, Ko'ptisçhe Grammati/:, p. 35. Anm.
53
W * □
a £ ^37 n\\C=:[]<Oliû ^ rs (9 ^ ^> r_fl | ^ (3 amma m«w o 0=q=3\ Il
£2>
« L'an IX, sous la Majesté (lu roi du Midi et du Nord, maître des deux terres,
Râ-het'—yeper-^step-n-râ, fils du Soleil, maître des diadèmes, l'aimé d'Amon.Tiklat (II),
aimé de Bast, la grande maîtresse de Bubastis, donnant la vie. En ce jour fut donne le
champ du chef auditeur de Bast, Hor-kheh, de 10 sat; ce fut fait par h; ... royal de
maison, Abisa [et] Nesiptaii, de la Pa-ger-pa-râ. On fera attention à ce que n'y porte
atteinte aucun violateur, et on dit : Que tout chef, tout scribe, tout employé, tout
envoyé en mission dans les champs qui empiéterait soit [châtié par le maître des deux
terres, exécuté par Sekhet, la lionne fascinatrice] ! »
Cette inscription rentre dans la catégorie des actes de donations de terrains dont les
musées possèdent déjà un certain nombre do spécimens. Ces monuments, souvent datés
et clans lesquels intervient toujours un roi (au moins dans le tableau du haut), mention-
n ^ a_h
nent la remise a_o, 8 , de propriétés à des divinités ; il est probable que ce sont
des titres d'établissement cle biens en waqfs religieux.
La ville de S=> ' • n'est pas connue ; elle devait se trouver près de Bubastis.
La dernière ligne est fort mal gravée, elle devait contenir L'imprécation que d'autres
t\ (à 'wam cr^> p y v* /v @ OfVr 71 <=? \\n@ o
stèles donnent sous la forme (. i=so { Y\ fV Y il •
A TRAVERS LA VOCALISATION ÉGYPTIENNE
PAR
G. Maspero
§ VII. Sur quelques cas cle diphtongaison en ai, et sur leur résolution en e.— A. La
forme <>pe, féminin cle la seconde personne singulière du pronom complexe <>p^i, £P^k,
parait difficilement explicable â Steindorlï' ; je la prendrai pour point cle départ cle cette
étude sur la diphtongaison des sons a + i.
Le thème est faciès, visus, et le pronom féminin suffixe est e : ta face, en
parlant à une femme, a donc dû s'exprimer d'abord par *£p> -f- e, selon la règle courante.
Le groupe a formé deux syllabes au début, puis Ô.-J- e se sont unis en une diphtongue,
et \p^ê est devenu <>pd.e, où la diphtongue ascendante s'est changée en œ écrit e. La
série complète serait clone *£p^ê, *£P^é, g.pé.
Mais e n'est lui-même qu'une forme mutilée : la langue antique avait g—>, qui,
au moins clans le moyen-égyptien, sont des variantes purement graphiques d'un même
1. Steindouff, Ko'ptisçhe Grammati/:, p. 35. Anm.