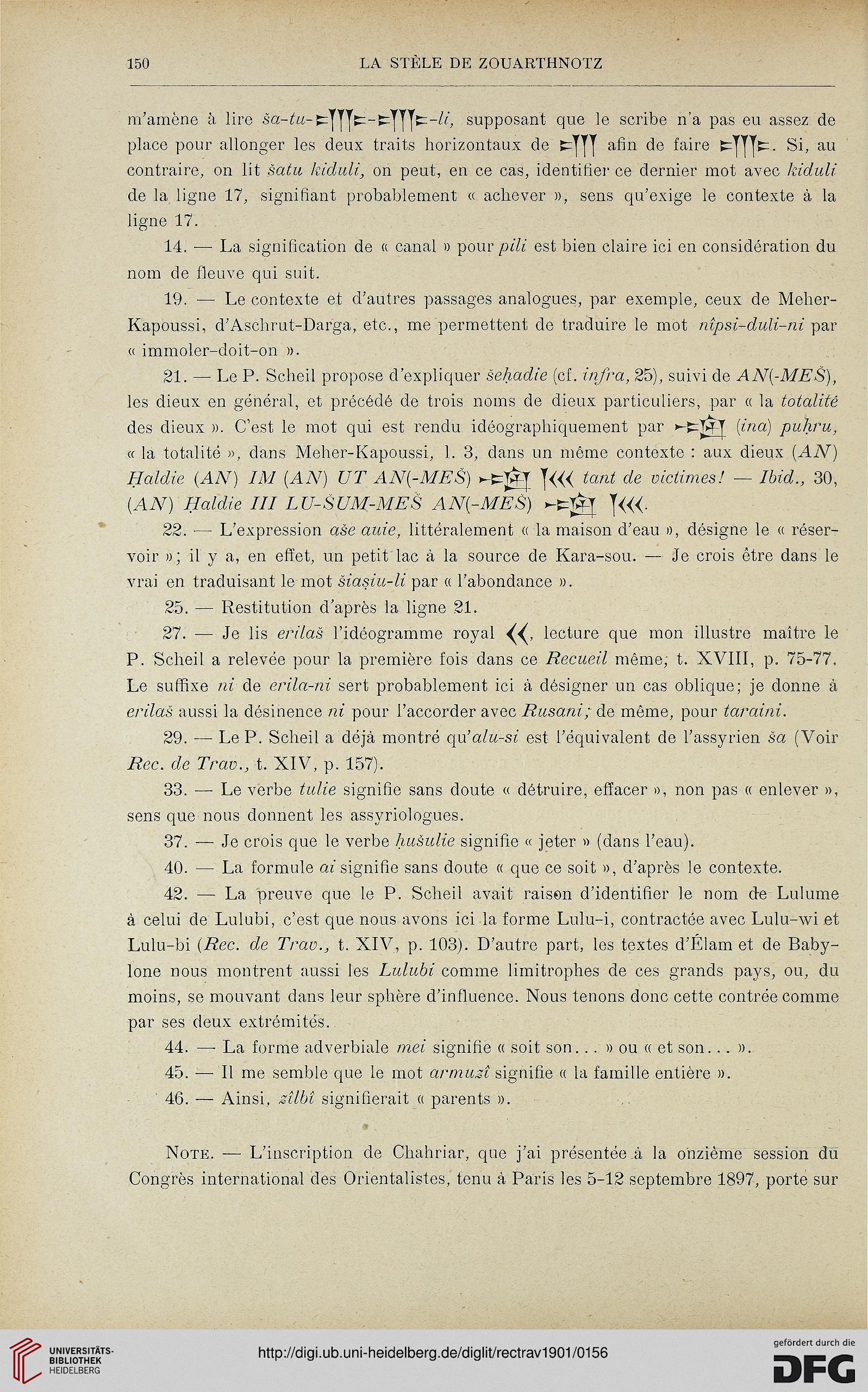150
LA STÈLE DE ZOUARTHNOTZ
m'amène à lire sa-tu-t^\\\^-^\\\^-li, supposant que le scribe n'a pas eu assez de
place pour allonger les deux traits horizontaux de afin de faire fr|yy^. Si, au
contraire, on lit satu kididi, on peut, en ce cas, identifier ce dernier mot avec kiduli
de la ligne 17, signifiant probablement « achever », sens qu'exige le contexte à la
ligne 17.
14. — La signification de « canal » pour pili est bien claire ici en considération du
nom de fleuve qui suit.
19. — Le contexte et d'autres passages analogues, par exemple, ceux de Meher-
Kapoussi, d'Aschrut-Darga, etc., me permettent de traduire le mot nîpsi-duli-ni par
« immoler-doit-on ».
21. — Le P. Scheil propose d'expliquer sehadie (cf. infra, 25), suivi de AN(-MES),
les dieux en général, et précédé de trois noms de dieux particuliers, par « la totalité
des dieux ». C'est le mot qui est rendu idéographiquement par ^ffif [ina) puhru,
« la totalité », dans Meher-Kapoussi, 1. 3, dans un même contexte : aux dieux (AN)
Haldie (AN) IM (AN) UT AN(-MES) ^fcffi |<« tant de victimes! - - Ibid., 30,
{AN) Haldie III LU-SUM-MES AN(-MES) ^JfJ |<«.
22. — L'expression ase aide, littéralement « la maison d'eau », désigne le « réser-
voir »; il y a, en effet, un petit lac à la source de Kara-sou. — Je crois être dans le
vrai en traduisant le mot siasiu-li par « l'abondance ».
25. — Restitution d'après la ligne 21.
27. — Je lis erilas l'idéogramme royal lecture que mon illustre maître le
P. Scheil a relevée pour la première fois dans ce Recueil même, t. XVIII, p. 75-77.
Le suffixe ni de ërila-ni sert probablement ici à désigner un cas oblique; je donne à
erilas aussi la désinence ni pour l'accorder avec Rusani; de même, pour tafaini.
29. — Le P. Scheil a déjà montré qu'alu-si est l'équivalent de l'assyrien sa (Voir
Rec. de Trav., t. XIV, p. 157).
33. — Le verbe tulie signifie sans doute « détruire, effacer », non pas « enlever »,
sens que nous donnent les assyriologues.
37. — Je crois que le verbe husulie signifie « jeter » (dans l'eau).
40. — La formule m signifie sans doute « que ce soit », d'après le contexte.
42. — La preuve que le P. Scheil avait raison d'identifier le nom de Lulume
à celui de Lulubi, c'est que nous avons ici la forme Lulu-i, contractée avec Lulu-wi et
Lulu-bi (Rec. de Trav., t. XIV, p. 103). D'autre part, les textes d'Élam et de Baby-
lone nous montrent aussi les Lulubi comme limitrophes de ces grands pays, ou, du
moins, se mouvant dans leur sphère d'influence. Nous tenons donc cette contrée comme
par ses deux extrémités.
44. —■ La forme adverbiale met signifie « soit son. . . » ou « et son... ».
45. — Il me semble que le mot armuzî signifie « la famille entière ».
46. — Ainsi, zîlbî signifierait a parents ».
•.
Note. — L'inscription de Chahriar, que j'ai présentée à la onzième session du
Congrès international des Orientalistes, tenu à Paris les 5-12 septembre 1897, porte sur
LA STÈLE DE ZOUARTHNOTZ
m'amène à lire sa-tu-t^\\\^-^\\\^-li, supposant que le scribe n'a pas eu assez de
place pour allonger les deux traits horizontaux de afin de faire fr|yy^. Si, au
contraire, on lit satu kididi, on peut, en ce cas, identifier ce dernier mot avec kiduli
de la ligne 17, signifiant probablement « achever », sens qu'exige le contexte à la
ligne 17.
14. — La signification de « canal » pour pili est bien claire ici en considération du
nom de fleuve qui suit.
19. — Le contexte et d'autres passages analogues, par exemple, ceux de Meher-
Kapoussi, d'Aschrut-Darga, etc., me permettent de traduire le mot nîpsi-duli-ni par
« immoler-doit-on ».
21. — Le P. Scheil propose d'expliquer sehadie (cf. infra, 25), suivi de AN(-MES),
les dieux en général, et précédé de trois noms de dieux particuliers, par « la totalité
des dieux ». C'est le mot qui est rendu idéographiquement par ^ffif [ina) puhru,
« la totalité », dans Meher-Kapoussi, 1. 3, dans un même contexte : aux dieux (AN)
Haldie (AN) IM (AN) UT AN(-MES) ^fcffi |<« tant de victimes! - - Ibid., 30,
{AN) Haldie III LU-SUM-MES AN(-MES) ^JfJ |<«.
22. — L'expression ase aide, littéralement « la maison d'eau », désigne le « réser-
voir »; il y a, en effet, un petit lac à la source de Kara-sou. — Je crois être dans le
vrai en traduisant le mot siasiu-li par « l'abondance ».
25. — Restitution d'après la ligne 21.
27. — Je lis erilas l'idéogramme royal lecture que mon illustre maître le
P. Scheil a relevée pour la première fois dans ce Recueil même, t. XVIII, p. 75-77.
Le suffixe ni de ërila-ni sert probablement ici à désigner un cas oblique; je donne à
erilas aussi la désinence ni pour l'accorder avec Rusani; de même, pour tafaini.
29. — Le P. Scheil a déjà montré qu'alu-si est l'équivalent de l'assyrien sa (Voir
Rec. de Trav., t. XIV, p. 157).
33. — Le verbe tulie signifie sans doute « détruire, effacer », non pas « enlever »,
sens que nous donnent les assyriologues.
37. — Je crois que le verbe husulie signifie « jeter » (dans l'eau).
40. — La formule m signifie sans doute « que ce soit », d'après le contexte.
42. — La preuve que le P. Scheil avait raison d'identifier le nom de Lulume
à celui de Lulubi, c'est que nous avons ici la forme Lulu-i, contractée avec Lulu-wi et
Lulu-bi (Rec. de Trav., t. XIV, p. 103). D'autre part, les textes d'Élam et de Baby-
lone nous montrent aussi les Lulubi comme limitrophes de ces grands pays, ou, du
moins, se mouvant dans leur sphère d'influence. Nous tenons donc cette contrée comme
par ses deux extrémités.
44. —■ La forme adverbiale met signifie « soit son. . . » ou « et son... ».
45. — Il me semble que le mot armuzî signifie « la famille entière ».
46. — Ainsi, zîlbî signifierait a parents ».
•.
Note. — L'inscription de Chahriar, que j'ai présentée à la onzième session du
Congrès international des Orientalistes, tenu à Paris les 5-12 septembre 1897, porte sur