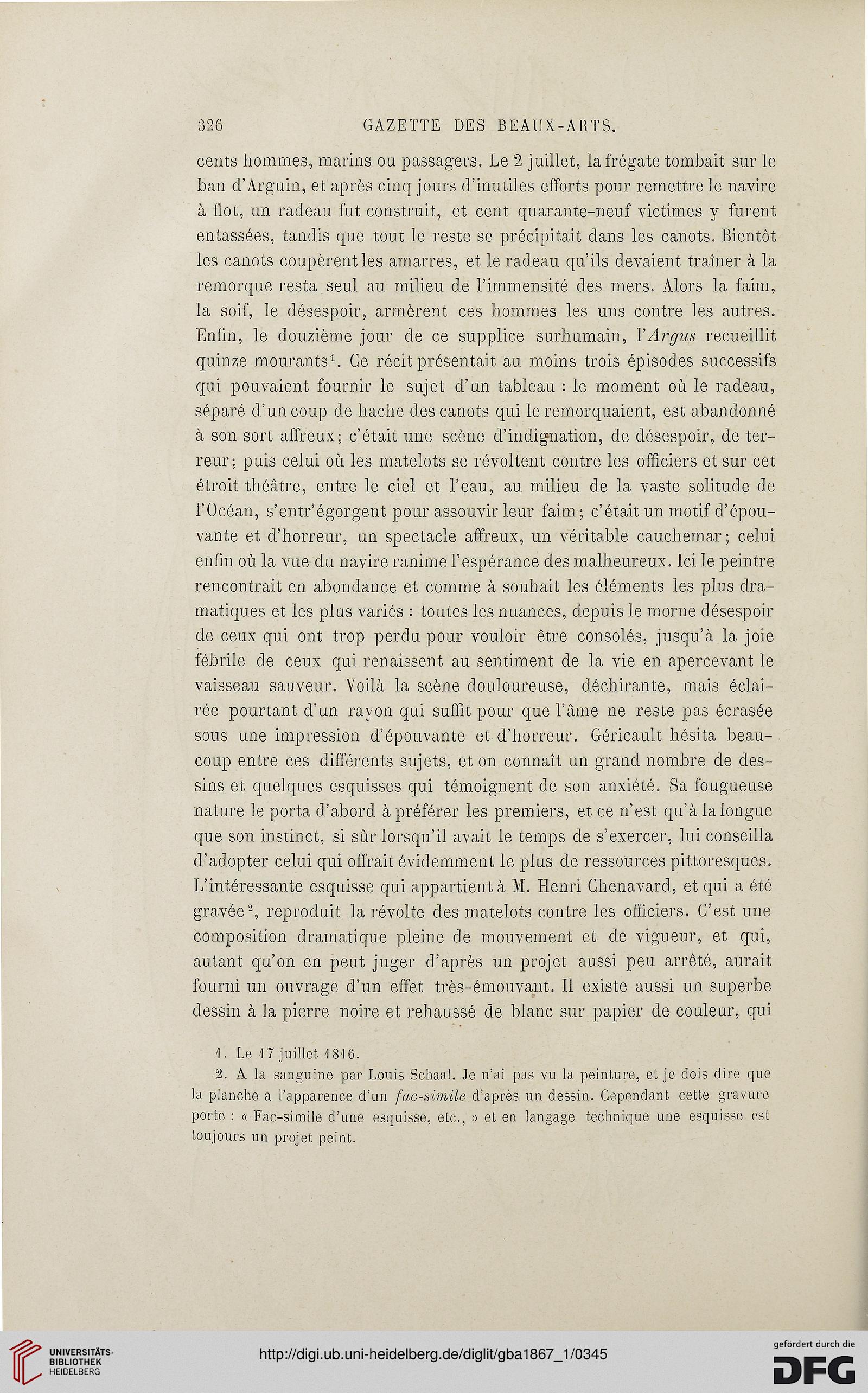326
GAZETTE DES BEAUX-ARTS.
cents hommes, marins ou passagers. Le 2 juillet, la frégate tombait sur le
ban cl’Arguin, et après cinq jours d’inutiles efforts pour remettre le navire
à (lot, un radeau fut construit, et cent quarante-neuf victimes y furent
entassées, tandis que tout le reste se précipitait dans les canots. Bientôt
les canots coupèrent les amarres, et le radeau qu’ils devaient traîner à la
remorque resta seul au milieu de l’immensité des mers. Alors la faim,
la soif, le désespoir, armèrent ces hommes les uns contre les autres.
Enfin, le douzième jour de ce supplice surhumain, Y Argus recueillit
quinze mourants1. Ce récit présentait au moins trois épisodes successifs
qui pouvaient fournir le sujet d’un tableau : le moment où le radeau,
séparé d’un coup de hache des canots qui le remorquaient, est abandonné
à son sort affreux; c’était une scène d’indignation, de désespoir, de ter-
reur; puis celui où les matelots se révoltent contre les officiers et sur cet
étroit théâtre, entre le ciel et l’eau, au milieu de la vaste solitude de
l’Océan, s’entr’égorgent pour assouvir leur faim; c’était un motif d’épou-
vante et d’horreur, un spectacle affreux, un véritable cauchemar; celui
enfin où la vue du navire ranime l’espérance des malheureux. Ici le peintre
rencontrait en abondance et comme à souhait les éléments les plus dra-
matiques et les plus variés : toutes les nuances, depuis le morne désespoir
de ceux qui ont trop perdu pour vouloir être consolés, jusqu’à la joie
fébrile de ceux qui renaissent au sentiment de la vie en apercevant le
vaisseau sauveur. Voilà la scène douloureuse, déchirante, mais éclai-
rée pourtant d’un rayon qui suffit pour que l’âme ne reste pas écrasée
sous une impression d’épouvante et d’horreur. Géricault hésita beau-
coup entre ces différents sujets, et on connaît un grand nombre de des-
sins et quelques esquisses qui témoignent de son anxiété. Sa fougueuse
nature le porta d’abord à préférer les premiers, et ce n’est qu’à la longue
que son instinct, si sûr lorsqu’il avait le temps de s’exercer, lui conseilla
d’adopter celui qui offrait évidemment le plus de ressources pittoresques.
L’intéressante esquisse qui appartient à M. Henri Chenavard, et qui a été
gravée2, reproduit la révolte des matelots contre les officiers. C’est une
composition dramatique pleine de mouvement et de vigueur, et qui,
autant qu’on en peut juger d’après un projet aussi peu arrêté, aurait
fourni un ouvrage d’un effet très-émouvant. Il existe aussi un superbe
dessin à la pierre noire et rehaussé de blanc sur papier de couleur, qui
1. Le 17 juillet 1816.
2. A la sanguine par Louis Schaal. Je n’ai pas vu la peinture, et je dois dire cpie
la planche a l’apparence d’un fac-similé d’après un dessin. Cependant cette gravure
porte : « Fac-similé d’une esquisse, etc., » et en langage technique une esquisse est
toujours un projet peint.
GAZETTE DES BEAUX-ARTS.
cents hommes, marins ou passagers. Le 2 juillet, la frégate tombait sur le
ban cl’Arguin, et après cinq jours d’inutiles efforts pour remettre le navire
à (lot, un radeau fut construit, et cent quarante-neuf victimes y furent
entassées, tandis que tout le reste se précipitait dans les canots. Bientôt
les canots coupèrent les amarres, et le radeau qu’ils devaient traîner à la
remorque resta seul au milieu de l’immensité des mers. Alors la faim,
la soif, le désespoir, armèrent ces hommes les uns contre les autres.
Enfin, le douzième jour de ce supplice surhumain, Y Argus recueillit
quinze mourants1. Ce récit présentait au moins trois épisodes successifs
qui pouvaient fournir le sujet d’un tableau : le moment où le radeau,
séparé d’un coup de hache des canots qui le remorquaient, est abandonné
à son sort affreux; c’était une scène d’indignation, de désespoir, de ter-
reur; puis celui où les matelots se révoltent contre les officiers et sur cet
étroit théâtre, entre le ciel et l’eau, au milieu de la vaste solitude de
l’Océan, s’entr’égorgent pour assouvir leur faim; c’était un motif d’épou-
vante et d’horreur, un spectacle affreux, un véritable cauchemar; celui
enfin où la vue du navire ranime l’espérance des malheureux. Ici le peintre
rencontrait en abondance et comme à souhait les éléments les plus dra-
matiques et les plus variés : toutes les nuances, depuis le morne désespoir
de ceux qui ont trop perdu pour vouloir être consolés, jusqu’à la joie
fébrile de ceux qui renaissent au sentiment de la vie en apercevant le
vaisseau sauveur. Voilà la scène douloureuse, déchirante, mais éclai-
rée pourtant d’un rayon qui suffit pour que l’âme ne reste pas écrasée
sous une impression d’épouvante et d’horreur. Géricault hésita beau-
coup entre ces différents sujets, et on connaît un grand nombre de des-
sins et quelques esquisses qui témoignent de son anxiété. Sa fougueuse
nature le porta d’abord à préférer les premiers, et ce n’est qu’à la longue
que son instinct, si sûr lorsqu’il avait le temps de s’exercer, lui conseilla
d’adopter celui qui offrait évidemment le plus de ressources pittoresques.
L’intéressante esquisse qui appartient à M. Henri Chenavard, et qui a été
gravée2, reproduit la révolte des matelots contre les officiers. C’est une
composition dramatique pleine de mouvement et de vigueur, et qui,
autant qu’on en peut juger d’après un projet aussi peu arrêté, aurait
fourni un ouvrage d’un effet très-émouvant. Il existe aussi un superbe
dessin à la pierre noire et rehaussé de blanc sur papier de couleur, qui
1. Le 17 juillet 1816.
2. A la sanguine par Louis Schaal. Je n’ai pas vu la peinture, et je dois dire cpie
la planche a l’apparence d’un fac-similé d’après un dessin. Cependant cette gravure
porte : « Fac-similé d’une esquisse, etc., » et en langage technique une esquisse est
toujours un projet peint.