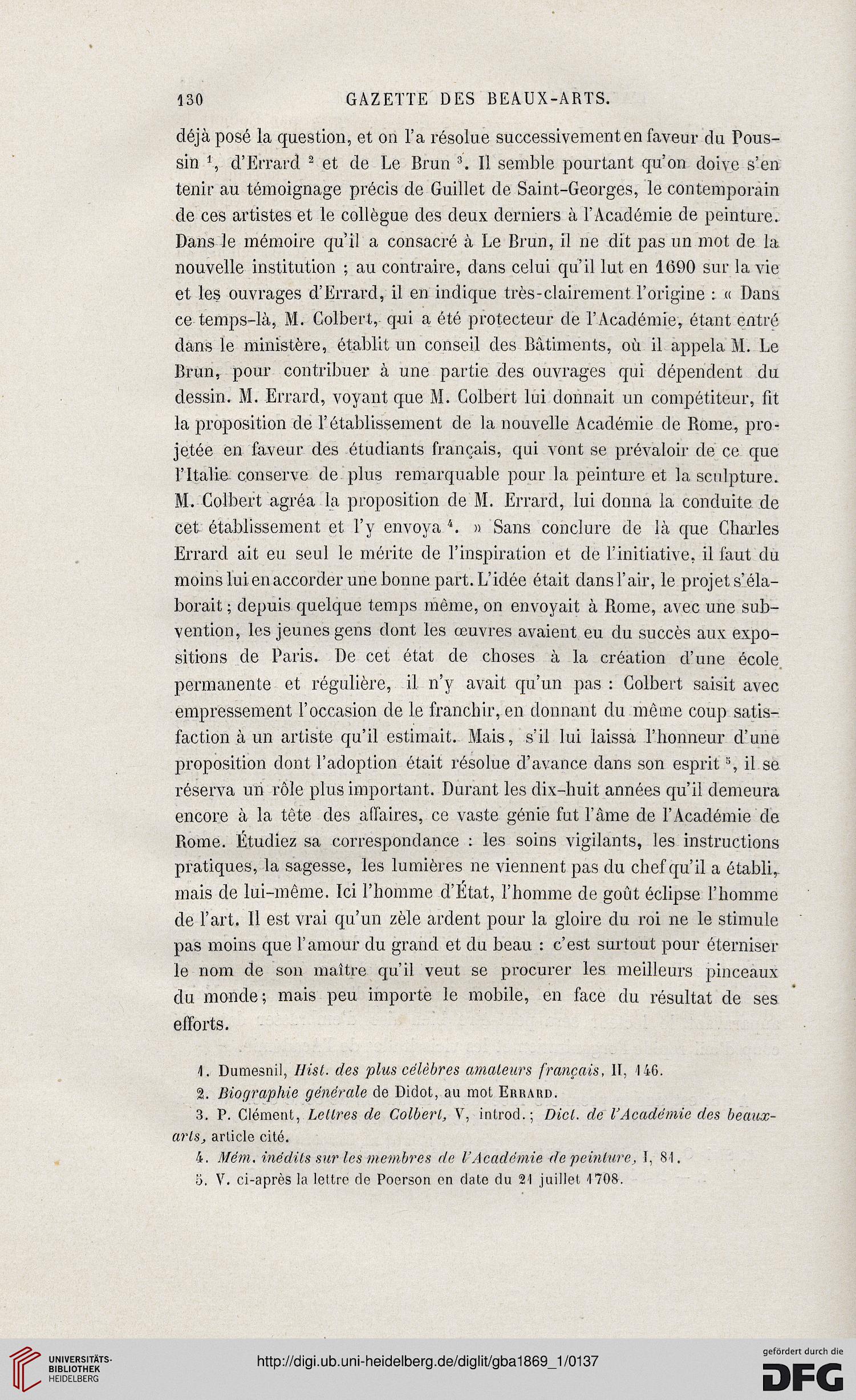130
GAZETTE DES BEAUX-ARTS.
déjà posé la question, et on l’a résolue successivement en faveur du Pous-
sin *, d’Errard 1 2 et de Le Brun 3. Il semble pourtant qu’on doive s’en
tenir au témoignage précis de Guillet de Saint-Georges, le contemporain
de ces artistes et le collègue des deux derniers à l’Académie de peinture.
Dans le mémoire qu’il a consacré à Le Brun, il ne dit pas un mot de la
nouvelle institution ; au contraire, dans celui qu’il lut en 1690 sur la vie
et les ouvrages d’Errard, il en indique très-clairement l’origine : « Dans
ee temps-là, M. Colbert, qui a été protecteur de l’Académie, étant entré
dans le ministère, établit un conseil des Bâtiments, où il appela M. Le
Brun, pour contribuer à une partie des ouvrages qui dépendent du
dessin. M. Errard, voyant que M. Colbert lui donnait un compétiteur, fit
la proposition de l’établissement de la nouvelle Académie de Rome, pro-
jetée en faveur des étudiants français, qui vont se prévaloir de ce que
f Italie conserve de plus remarquable pour la peinture et la sculpture.
M. Colbert agréa la proposition de M. Errard, lui donna la conduite de
cet établissement et l’y envoya 4. » Sans conclure de là que Charles
Errard ait eu seul le mérite de l’inspiration et de l’initiative, il faut du
moins lui en accorder une bonne part. L’idée était dans l'air, le projet s’éla-
borait ; depuis quelque temps même, on envoyait à Rome, avec une sub-
vention, les jeunes gens dont les œuvres avaient eu du succès aux expo-
sitions de Paris. De cet état de choses à la création d’une école
permanente et régulière, il n’y avait qu’un pas : Colbert saisit avec
empressement l’occasion de le franchir, en donnant du même coup satis-
faction à un artiste qu’il estimait. Mais, s’il lui laissa l’honneur d’une
proposition dont l’adoption était résolue d’avance dans son esprit5, il se
réserva un rôle plus important. Durant les dix-huit années qu’il demeura
encore à la tête des affaires, ce vaste génie fut l’âme de l’Académie de
Rome. Étudiez sa correspondance : les soins vigilants, les instructions
pratiques, la sagesse, les lumières ne viennent pas du chef qu’il a établi,,
mais de lui-même. Ici l’homme d’État, l’homme de goût éclipse l’homme
de l’art. 11 est vrai qu’un zèle ardent pour la gloire du roi ne le stimule
pas moins que l’amour du grand et du beau : c’est surtout pour éterniser
le nom de son maître qu’il veut se procurer les meilleurs pinceaux
du monde; mais peu importe le mobile, en face du résultat de ses
efforts.
1. Dumesnil, lïist. des plus célèbres amateurs français, H, 146.
2. Biographie générale de Didot, au mot Lkhaud.
3. P. Clément, Lettres de Colbert, V, introd. ; Dicl. de l’Académie des beaux-
arts, article cité.
4. Mém. inédits sur les membres de l’Académie de peinture, I, 81.
8. V. ci-après la lettre de Poorson en date du 21 juillet 1708.
GAZETTE DES BEAUX-ARTS.
déjà posé la question, et on l’a résolue successivement en faveur du Pous-
sin *, d’Errard 1 2 et de Le Brun 3. Il semble pourtant qu’on doive s’en
tenir au témoignage précis de Guillet de Saint-Georges, le contemporain
de ces artistes et le collègue des deux derniers à l’Académie de peinture.
Dans le mémoire qu’il a consacré à Le Brun, il ne dit pas un mot de la
nouvelle institution ; au contraire, dans celui qu’il lut en 1690 sur la vie
et les ouvrages d’Errard, il en indique très-clairement l’origine : « Dans
ee temps-là, M. Colbert, qui a été protecteur de l’Académie, étant entré
dans le ministère, établit un conseil des Bâtiments, où il appela M. Le
Brun, pour contribuer à une partie des ouvrages qui dépendent du
dessin. M. Errard, voyant que M. Colbert lui donnait un compétiteur, fit
la proposition de l’établissement de la nouvelle Académie de Rome, pro-
jetée en faveur des étudiants français, qui vont se prévaloir de ce que
f Italie conserve de plus remarquable pour la peinture et la sculpture.
M. Colbert agréa la proposition de M. Errard, lui donna la conduite de
cet établissement et l’y envoya 4. » Sans conclure de là que Charles
Errard ait eu seul le mérite de l’inspiration et de l’initiative, il faut du
moins lui en accorder une bonne part. L’idée était dans l'air, le projet s’éla-
borait ; depuis quelque temps même, on envoyait à Rome, avec une sub-
vention, les jeunes gens dont les œuvres avaient eu du succès aux expo-
sitions de Paris. De cet état de choses à la création d’une école
permanente et régulière, il n’y avait qu’un pas : Colbert saisit avec
empressement l’occasion de le franchir, en donnant du même coup satis-
faction à un artiste qu’il estimait. Mais, s’il lui laissa l’honneur d’une
proposition dont l’adoption était résolue d’avance dans son esprit5, il se
réserva un rôle plus important. Durant les dix-huit années qu’il demeura
encore à la tête des affaires, ce vaste génie fut l’âme de l’Académie de
Rome. Étudiez sa correspondance : les soins vigilants, les instructions
pratiques, la sagesse, les lumières ne viennent pas du chef qu’il a établi,,
mais de lui-même. Ici l’homme d’État, l’homme de goût éclipse l’homme
de l’art. 11 est vrai qu’un zèle ardent pour la gloire du roi ne le stimule
pas moins que l’amour du grand et du beau : c’est surtout pour éterniser
le nom de son maître qu’il veut se procurer les meilleurs pinceaux
du monde; mais peu importe le mobile, en face du résultat de ses
efforts.
1. Dumesnil, lïist. des plus célèbres amateurs français, H, 146.
2. Biographie générale de Didot, au mot Lkhaud.
3. P. Clément, Lettres de Colbert, V, introd. ; Dicl. de l’Académie des beaux-
arts, article cité.
4. Mém. inédits sur les membres de l’Académie de peinture, I, 81.
8. V. ci-après la lettre de Poorson en date du 21 juillet 1708.