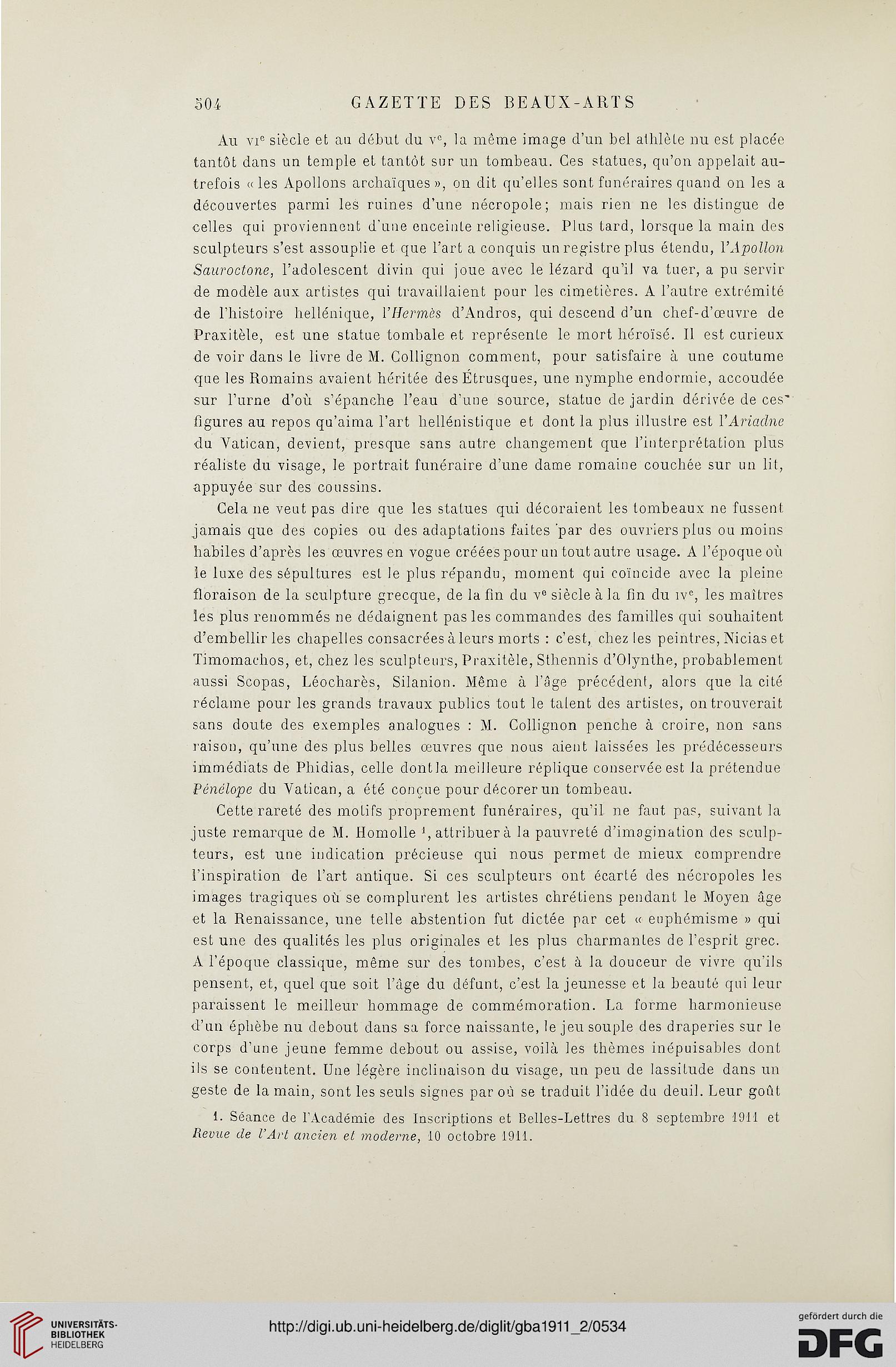GAZETTE DES BEAUX-ARTS
504
Au vie siècle et au début du v°, la même image d’un bel athlète nu est placée
tantôt dans un temple et tantôt sur un tombeau. Ces statues, qu’on appelait au-
trefois «les Apollons archaïques», on dit qu’elles sont funéraires quand on les a
découvertes parmi les ruines d’une nécropole; mais rien ne les distingue de
celles qui proviennent d'une enceinte religieuse. Plus tard, lorsque la main des
sculpteurs s’est assouplie et que l’art a conquis un registre plus étendu, VApollon
Sauroctone, l’adolescent divin qui joue avec le lézard qu’il va tuer, a pu servir
de modèle aux artistes qui travaillaient pour les cimetières. A l’autre extrémité
de l’histoire hellénique, l'Hermès d’Andros, qui descend d’un chef-d’œuvre de
Praxitèle, est une statue tombale et représente le mort héroïsé. Il est curieux
de voir dans le livre de M. Collignon comment, pour satisfaire à une coutume
que les Romains avaient héritée des Étrusques, une nymphe endormie, accoudée
sur l’urne d’où s’épanche l’eau d'une source, statue de jardin dérivée de ces'
figures au repos qu’aima l’art hellénistique et dont la plus illustre est YAriadne
du Vatican, devient, presque sans autre changement que l’interprétation plus
réaliste du visage, le portrait funéraire d’une dame romaine couchée sur un lit,
appuyée sur des coussins.
Cela ne veut pas dire que les statues qui décoraient les tombeaux ne fussent
jamais que des copies ou des adaptations faites 'par des ouvriers plus ou moins
habiles d’après les œuvres en vogue créées pour un tout autre usage. A l’époque où
le luxe des sépultures est le plus répandu, moment qui coïncide avec la pleine
floraison de la sculpture grecque, de la fin du ve siècle à la fin du ive, les maîtres
les plus renommés ne dédaignent pas les commandes des familles qui souhaitent
d’embellir les chapelles consacrées à leurs morts : c’est, chez les peintres, Nicias et
Timomachos, et, chez les sculpteurs, Praxitèle, Sthennis d’Olynthe, probablement
aussi Scopas, Léocharès, Silanion. Même à l'âge précédent, alors que la cité
réclame pour les grands travaux publics tout le talent des artistes, on trouverait
sans doute des exemples analogues : M. Collignon penche à croire, non sans
raison, qu’une des plus belles œuvres que nous aient laissées les prédécesseurs
immédiats de Phidias, celle dont la meilleure réplique conservée est la prétendue
Pénélope du Vatican, a été conçue pour décorer un tombeau.
Cette rareté des motifs proprement funéraires, qu'il ne faut pas, suivant la
juste remarque de M. Homolle 1, attribuera la pauvreté d’imagination des sculp-
teurs, est une indication précieuse qui nous permet de mieux comprendre
l’inspiration de l’art antique. Si ces sculpteurs ont écarté des nécropoles les
images tragiques où se complurent les artistes chrétiens pendant le Moyen âge
et la Renaissance, une telle abstention fut dictée par cet « euphémisme » qui
est une des qualités les plus originales et les plus charmantes de l’esprit grec.
A l’époque classique, même sur des tombes, c’est à la douceur de vivre qu'ils
pensent, et, quel que soit l’âge du défunt, c’est la jeunesse et la beauté qui leur
paraissent le meilleur hommage de commémoration. La forme harmonieuse
d’un éplièbe nu debout dans sa force naissante, le jeu souple des draperies sur le
corps d’une jeune femme debout ou assise, voilà les thèmes inépuisables dont
iis se contentent. Une légère inclinaison du visage, un peu de lassitude dans un
geste de la main, sont les seuls signes par où se traduit l’idée du deuil. Leur goût
1. Séance de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres du 8 septembre 1911 et
Revue de l’Art ancien et moderne, 10 octobre 1911.
504
Au vie siècle et au début du v°, la même image d’un bel athlète nu est placée
tantôt dans un temple et tantôt sur un tombeau. Ces statues, qu’on appelait au-
trefois «les Apollons archaïques», on dit qu’elles sont funéraires quand on les a
découvertes parmi les ruines d’une nécropole; mais rien ne les distingue de
celles qui proviennent d'une enceinte religieuse. Plus tard, lorsque la main des
sculpteurs s’est assouplie et que l’art a conquis un registre plus étendu, VApollon
Sauroctone, l’adolescent divin qui joue avec le lézard qu’il va tuer, a pu servir
de modèle aux artistes qui travaillaient pour les cimetières. A l’autre extrémité
de l’histoire hellénique, l'Hermès d’Andros, qui descend d’un chef-d’œuvre de
Praxitèle, est une statue tombale et représente le mort héroïsé. Il est curieux
de voir dans le livre de M. Collignon comment, pour satisfaire à une coutume
que les Romains avaient héritée des Étrusques, une nymphe endormie, accoudée
sur l’urne d’où s’épanche l’eau d'une source, statue de jardin dérivée de ces'
figures au repos qu’aima l’art hellénistique et dont la plus illustre est YAriadne
du Vatican, devient, presque sans autre changement que l’interprétation plus
réaliste du visage, le portrait funéraire d’une dame romaine couchée sur un lit,
appuyée sur des coussins.
Cela ne veut pas dire que les statues qui décoraient les tombeaux ne fussent
jamais que des copies ou des adaptations faites 'par des ouvriers plus ou moins
habiles d’après les œuvres en vogue créées pour un tout autre usage. A l’époque où
le luxe des sépultures est le plus répandu, moment qui coïncide avec la pleine
floraison de la sculpture grecque, de la fin du ve siècle à la fin du ive, les maîtres
les plus renommés ne dédaignent pas les commandes des familles qui souhaitent
d’embellir les chapelles consacrées à leurs morts : c’est, chez les peintres, Nicias et
Timomachos, et, chez les sculpteurs, Praxitèle, Sthennis d’Olynthe, probablement
aussi Scopas, Léocharès, Silanion. Même à l'âge précédent, alors que la cité
réclame pour les grands travaux publics tout le talent des artistes, on trouverait
sans doute des exemples analogues : M. Collignon penche à croire, non sans
raison, qu’une des plus belles œuvres que nous aient laissées les prédécesseurs
immédiats de Phidias, celle dont la meilleure réplique conservée est la prétendue
Pénélope du Vatican, a été conçue pour décorer un tombeau.
Cette rareté des motifs proprement funéraires, qu'il ne faut pas, suivant la
juste remarque de M. Homolle 1, attribuera la pauvreté d’imagination des sculp-
teurs, est une indication précieuse qui nous permet de mieux comprendre
l’inspiration de l’art antique. Si ces sculpteurs ont écarté des nécropoles les
images tragiques où se complurent les artistes chrétiens pendant le Moyen âge
et la Renaissance, une telle abstention fut dictée par cet « euphémisme » qui
est une des qualités les plus originales et les plus charmantes de l’esprit grec.
A l’époque classique, même sur des tombes, c’est à la douceur de vivre qu'ils
pensent, et, quel que soit l’âge du défunt, c’est la jeunesse et la beauté qui leur
paraissent le meilleur hommage de commémoration. La forme harmonieuse
d’un éplièbe nu debout dans sa force naissante, le jeu souple des draperies sur le
corps d’une jeune femme debout ou assise, voilà les thèmes inépuisables dont
iis se contentent. Une légère inclinaison du visage, un peu de lassitude dans un
geste de la main, sont les seuls signes par où se traduit l’idée du deuil. Leur goût
1. Séance de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres du 8 septembre 1911 et
Revue de l’Art ancien et moderne, 10 octobre 1911.