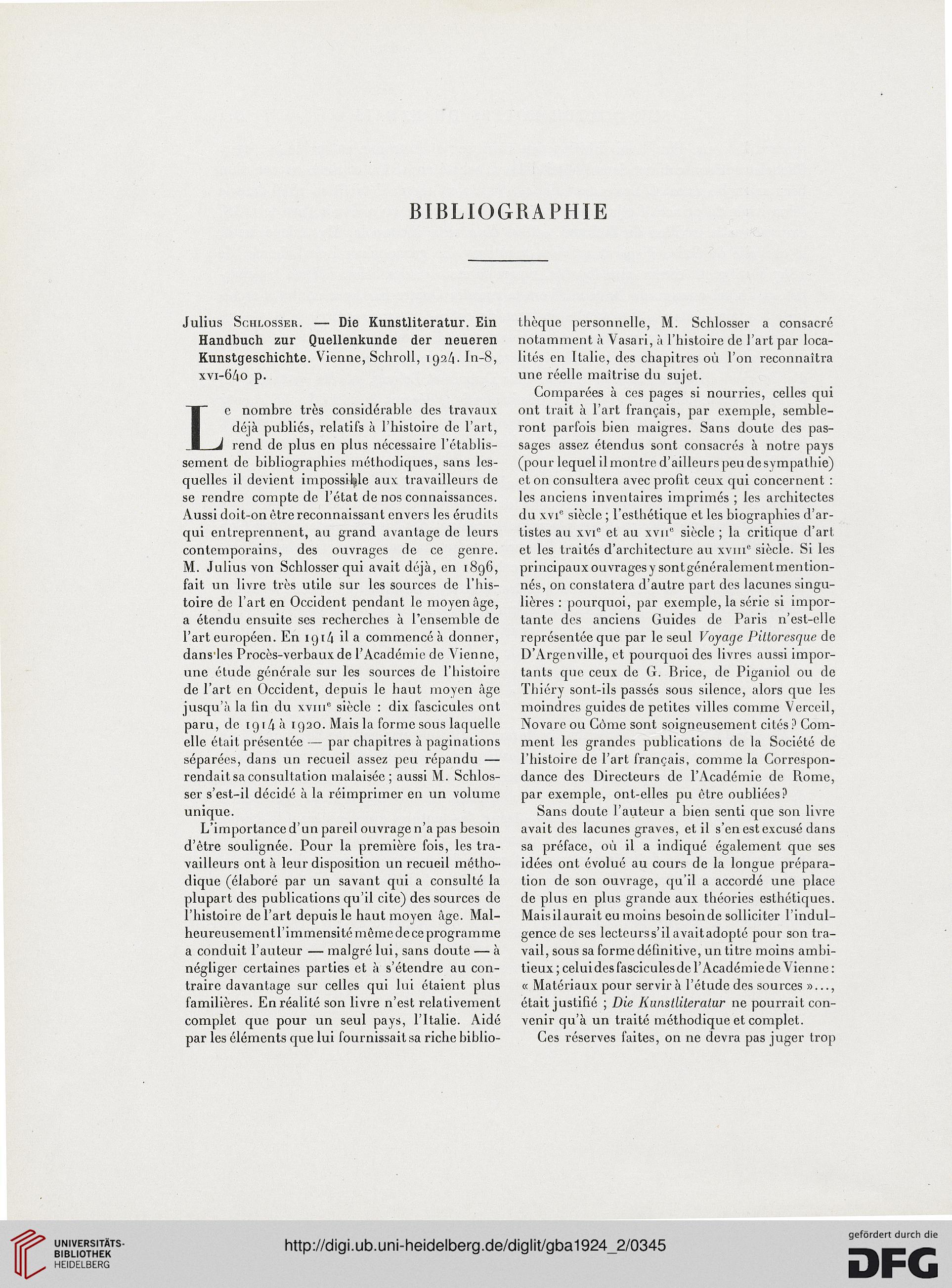BIBLIOGRAPHIE
Julius Schlosser. — Die Kunstliteratur. Ein
Handbuch zur Quellenkunde der neueren
Kunstgeschichte. Vienne, Schroll, iga4- Jn-8,
xvi-64o p.
Le nombre très considérable des travaux
déjà publiés, relatifs à l’histoire de l’art,
rend de plus en plus nécessaire l’établis-
sement de bibliographies méthodiques, sans les-
quelles il devient impossible aux travailleurs de
se rendre compte de l’état de nos connaissances.
Aussi doit-on être reconnaissant envers les érudits
qui entreprennent, au grand avantage de leurs
contemporains, des ouvrages de ce genre.
M. Julius von Schlosser qui avait déjà, en 1896,
fait un livre très utile sur les sources de l’his-
toire de l’art en Occident pendant le moyen âge,
a étendu ensuite ses recherches à l’ensemble de
l’art européen. En igi4 il a commencé à donner,
dans'les Procès-verbaux de l’Académie de Vienne,
une étude générale sur les sources de l’histoire
de l’art en Occident, depuis le haut moyen âge
jusqu’à la lin du xvm® siècle : dix fascicules ont
paru, de ig >4 à 1920. Mais la forme sous laquelle
elle était présentée — par chapitres à paginations
séparées, dans un recueil assez peu répandu —
rendait sa consultation malaisée ; aussi M. Schlos-
ser s’est-il décidé à la réimprimer en un volume
unique.
L’importanced’un pareil ouvragen’a pas besoin
d’être soulignée. Pour la première fois, les tra-
vailleurs ont à leur disposition un recueil métho-
dique (élaboré par un savant qui a consulté la
plupart des publications qu’il cite) des sources de
l’histoire de l’art depuis le haut moyen âge. Mal-
heureusement l’immensité même de ce programme
a conduit l’auteur — malgré lui, sans doute — à
négliger certaines parties et à s’étendre au con-
traire davantage sur celles qui lui étaient plus
familières. En réalité son livre n’est relativement
complet que pour un seul pays, l’Italie. Aidé
par les éléments que lui fournissait sa riche biblio-
thèque personnelle, M. Schlosser a consacré
notamment à Vasari, à l’histoire de l’art par loca-
lités en Italie, des chapitres où l’on reconnaîtra
une réelle maîtrise du sujet.
Comparées à ces pages si nourries, celles qui
ont trait à l’art français, par exemple, semble-
ront parfois bien maigres. Sans doute des pas-
sages assez étendus sont consacrés à notre pays
(pour lequel il montre d’ailleurs peu de sympathie)
et on consultera avec profit ceux qui concernent :
les anciens inventaires imprimés ; les architectes
du xvie siècle ; l’esthétique et les biographies d’ar-
tistes au xvie et au xvae siècle ; la critique d’art
et les traités d’architecture au xvme siècle. Si les
principaux ouvrages y sont généralement mention-
nés, on constatera d’autre part des lacunes singu-
lières : pourquoi, par exemple, la série si impor-
tante des anciens Guides de Paris n’est-elle
représentée que par le seul Voyage Pittoresque de
D’Argenville, et pourquoi des livres aussi impor-
tants que ceux de G. Brice, de Piganiol ou de
Thiéry sont-ils passés sous silence, alors que les
moindres guides de petites villes comme Verceil,
Novare ou Corne sont soigneusement cités? Com-
ment les grandes publications de la Société de
l’histoire de l’art français, comme la Correspon-
dance des Directeurs de l’Académie de Rome,
par exemple, ont-elles pu être oubliées?
Sans doute l’auteur a bien senti que son livre
avait des lacunes graves, et il s’en est excusé dans
sa préface, où il a indiqué également que ses
idées ont évolué au cours de la longue prépara-
tion de son ouvrage, qu’il a accordé une place
de plus en plus grande aux théories esthétiques.
Mais il aurait eu moins besoinde solliciter l’indul-
gence de ses lecteurss’il avaitadopté pour son tra-
vail, sous sa forme définitive, un titre moins ambi-
tieux ; celui des fascicules de l’Académie de Vienne :
« Matériaux pour servir à l’étude des sources »...,
était justifié ; Die Kunstliteratur ne pourrait con-
venir qu’à un traité méthodique et complet.
Ces réserves faites, on ne devra pas juger trop
Julius Schlosser. — Die Kunstliteratur. Ein
Handbuch zur Quellenkunde der neueren
Kunstgeschichte. Vienne, Schroll, iga4- Jn-8,
xvi-64o p.
Le nombre très considérable des travaux
déjà publiés, relatifs à l’histoire de l’art,
rend de plus en plus nécessaire l’établis-
sement de bibliographies méthodiques, sans les-
quelles il devient impossible aux travailleurs de
se rendre compte de l’état de nos connaissances.
Aussi doit-on être reconnaissant envers les érudits
qui entreprennent, au grand avantage de leurs
contemporains, des ouvrages de ce genre.
M. Julius von Schlosser qui avait déjà, en 1896,
fait un livre très utile sur les sources de l’his-
toire de l’art en Occident pendant le moyen âge,
a étendu ensuite ses recherches à l’ensemble de
l’art européen. En igi4 il a commencé à donner,
dans'les Procès-verbaux de l’Académie de Vienne,
une étude générale sur les sources de l’histoire
de l’art en Occident, depuis le haut moyen âge
jusqu’à la lin du xvm® siècle : dix fascicules ont
paru, de ig >4 à 1920. Mais la forme sous laquelle
elle était présentée — par chapitres à paginations
séparées, dans un recueil assez peu répandu —
rendait sa consultation malaisée ; aussi M. Schlos-
ser s’est-il décidé à la réimprimer en un volume
unique.
L’importanced’un pareil ouvragen’a pas besoin
d’être soulignée. Pour la première fois, les tra-
vailleurs ont à leur disposition un recueil métho-
dique (élaboré par un savant qui a consulté la
plupart des publications qu’il cite) des sources de
l’histoire de l’art depuis le haut moyen âge. Mal-
heureusement l’immensité même de ce programme
a conduit l’auteur — malgré lui, sans doute — à
négliger certaines parties et à s’étendre au con-
traire davantage sur celles qui lui étaient plus
familières. En réalité son livre n’est relativement
complet que pour un seul pays, l’Italie. Aidé
par les éléments que lui fournissait sa riche biblio-
thèque personnelle, M. Schlosser a consacré
notamment à Vasari, à l’histoire de l’art par loca-
lités en Italie, des chapitres où l’on reconnaîtra
une réelle maîtrise du sujet.
Comparées à ces pages si nourries, celles qui
ont trait à l’art français, par exemple, semble-
ront parfois bien maigres. Sans doute des pas-
sages assez étendus sont consacrés à notre pays
(pour lequel il montre d’ailleurs peu de sympathie)
et on consultera avec profit ceux qui concernent :
les anciens inventaires imprimés ; les architectes
du xvie siècle ; l’esthétique et les biographies d’ar-
tistes au xvie et au xvae siècle ; la critique d’art
et les traités d’architecture au xvme siècle. Si les
principaux ouvrages y sont généralement mention-
nés, on constatera d’autre part des lacunes singu-
lières : pourquoi, par exemple, la série si impor-
tante des anciens Guides de Paris n’est-elle
représentée que par le seul Voyage Pittoresque de
D’Argenville, et pourquoi des livres aussi impor-
tants que ceux de G. Brice, de Piganiol ou de
Thiéry sont-ils passés sous silence, alors que les
moindres guides de petites villes comme Verceil,
Novare ou Corne sont soigneusement cités? Com-
ment les grandes publications de la Société de
l’histoire de l’art français, comme la Correspon-
dance des Directeurs de l’Académie de Rome,
par exemple, ont-elles pu être oubliées?
Sans doute l’auteur a bien senti que son livre
avait des lacunes graves, et il s’en est excusé dans
sa préface, où il a indiqué également que ses
idées ont évolué au cours de la longue prépara-
tion de son ouvrage, qu’il a accordé une place
de plus en plus grande aux théories esthétiques.
Mais il aurait eu moins besoinde solliciter l’indul-
gence de ses lecteurss’il avaitadopté pour son tra-
vail, sous sa forme définitive, un titre moins ambi-
tieux ; celui des fascicules de l’Académie de Vienne :
« Matériaux pour servir à l’étude des sources »...,
était justifié ; Die Kunstliteratur ne pourrait con-
venir qu’à un traité méthodique et complet.
Ces réserves faites, on ne devra pas juger trop