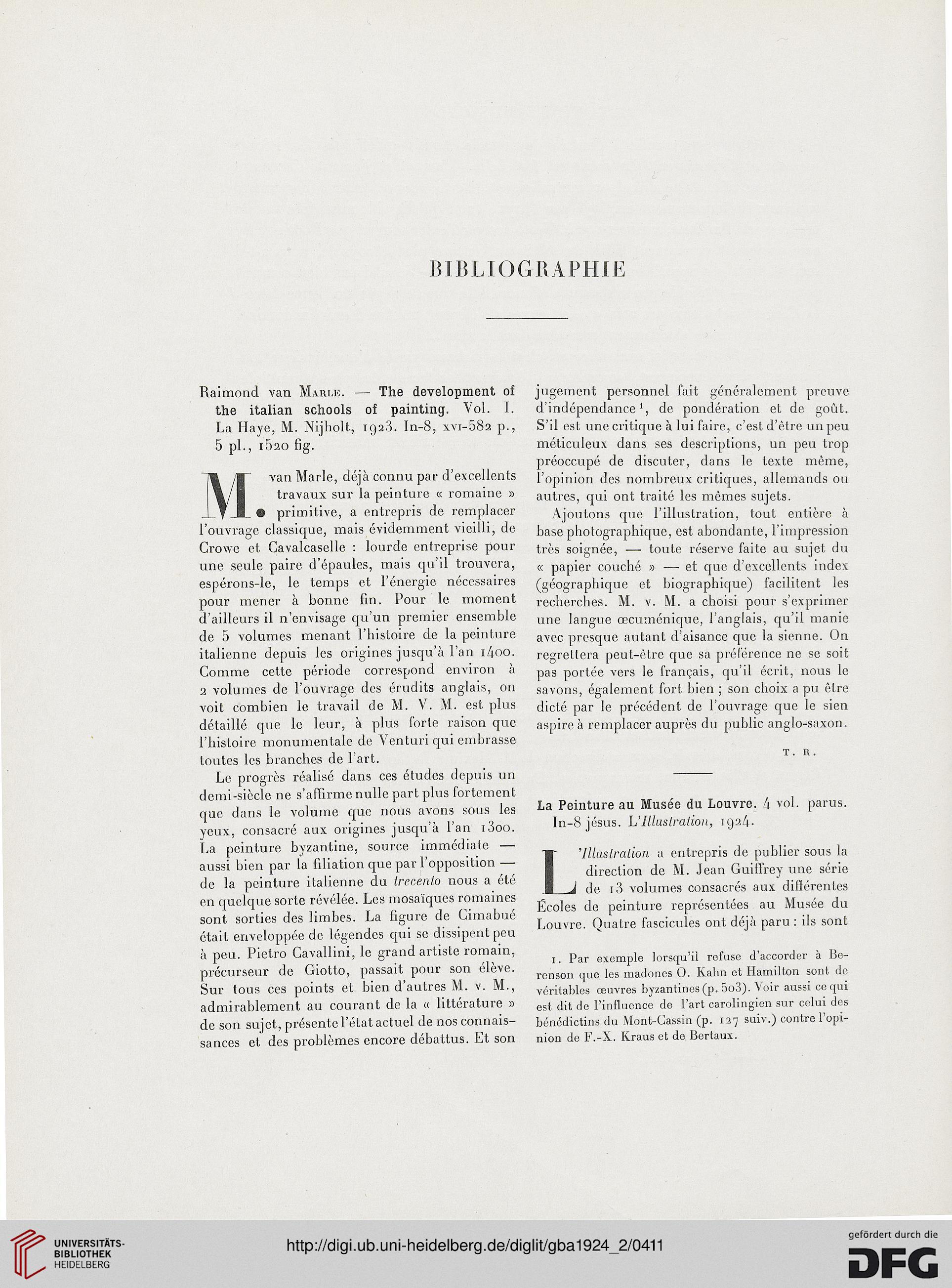BIBLIOGRAPHIE
Raimond van Marle. — The development of
the italian schools of painting. Vol. I.
La Haye, M. Nijliolt, 1923. In-8, xvi-582 p.,
5 pl., i5ao fig.
van Marie, déjà connu par d’excellents
travaux sur la peinture « romaine »
• primitive, a entrepris de remplacer
l’ouvrage classique, mais évidemment vieilli, de
Crowe et Cavalcaselle : lourde entreprise pour
une seule paire d’épaules, mais qu’il trouvera,
espérons-le, le temps et l’énergie nécessaires
pour mener à bonne fin. Pour le moment
d’ailleurs il n’envisage qu’un premier ensemble
de 5 volumes menant l’histoire de la peinture
italienne depuis les origines jusqu’à l’an i4oo.
Comme cette période correspond environ à
2 volumes de l’ouvrage des érudits anglais, on
voit combien le travail de M. V. M. est plus
détaillé que le leur, à plus forte raison que
l’histoire monumentale de Venturi qui embrasse
toutes les branches de l’art.
Le progrès réalisé dans ces études depuis un
demi-siècle ne s’affirme nulle part plus fortement
que dans le volume que nous avons sous les
yeux, consacré aux origines jusqu’à l’an i3oo.
La peinture byzantine, source immédiate —
aussi bien par la filiation que par l’opposition —
de la peinture italienne du trecento nous a été
en quelque sorte révélée. Les mosaïques romaines
sont sorties des limbes. La figure de Cimabué
était enveloppée de légendes qui se dissipent peu
à peu. Pietro Cavallini, le grand artiste romain,
précurseur de Giotto, passait pour son élève.
Sur tous ces points et bien d’autres M. v. M.,
admirablement au courant de la « littérature »
de son sujet, présente l’état actuel de nos connais-
sances et des problèmes encore débattus. Et son
jugement personnel fait généralement preuve
d’indépendance1, de pondération et de goût.
S’il est une critique à lui faire, c’est d’être un peu
méticuleux dans ses descriptions, un peu trop
préoccupé de discuter, dans le texte même,
l’opinion des nombreux critiques, allemands ou
autres, qui ont traité les mêmes sujets.
Ajoutons que l’illustration, tout entière à
base photographique, est abondante, l’impression
très soignée, — toute réserve faite au sujet du
« papier couché » — et que d’excellents index
(géographique et biographique) facilitent les
recherches. M. v. M. a choisi pour s’exprimer
une langue œcuménique, l’anglais, qu’il manie
avec presque autant d’aisance que la sienne. On
regrettera peut-être que sa préférence ne se soit
pas portée vers le français, qu’il écrit, nous le
savons, également fort bien ; son choix a pu être
dicté par le précédent de l’ouvrage que le sien
aspire à remplacer auprès du public anglo-saxon.
t . n.
La Peinture au Musée du Louvre. 4 vol. parus.
In-8jésus. L’Illustration, 1924.
L’Illustration a entrepris de publier sous la
direction de M. Jean Guiffrey une série
de i3 volumes consacrés aux différentes
Ecoles de peinture représentées au Musée du
Louvre. Quatre fascicules ont déjà paru : ils sont
1. Par exemple lorsqu’il refuse d’accorder à Be-
renson que les madones O. Kahn et Hamilton sont de
véritables œuvres byzantines (p. 5o3). Voir aussi ce qui
est dit de l’influence de l’art carolingien sur celui des
bénédictins du Mont-Gassin (p. 127 suiv.) contre l’opi-
nion de F.-X. Kraus et de Bertaux.
Raimond van Marle. — The development of
the italian schools of painting. Vol. I.
La Haye, M. Nijliolt, 1923. In-8, xvi-582 p.,
5 pl., i5ao fig.
van Marie, déjà connu par d’excellents
travaux sur la peinture « romaine »
• primitive, a entrepris de remplacer
l’ouvrage classique, mais évidemment vieilli, de
Crowe et Cavalcaselle : lourde entreprise pour
une seule paire d’épaules, mais qu’il trouvera,
espérons-le, le temps et l’énergie nécessaires
pour mener à bonne fin. Pour le moment
d’ailleurs il n’envisage qu’un premier ensemble
de 5 volumes menant l’histoire de la peinture
italienne depuis les origines jusqu’à l’an i4oo.
Comme cette période correspond environ à
2 volumes de l’ouvrage des érudits anglais, on
voit combien le travail de M. V. M. est plus
détaillé que le leur, à plus forte raison que
l’histoire monumentale de Venturi qui embrasse
toutes les branches de l’art.
Le progrès réalisé dans ces études depuis un
demi-siècle ne s’affirme nulle part plus fortement
que dans le volume que nous avons sous les
yeux, consacré aux origines jusqu’à l’an i3oo.
La peinture byzantine, source immédiate —
aussi bien par la filiation que par l’opposition —
de la peinture italienne du trecento nous a été
en quelque sorte révélée. Les mosaïques romaines
sont sorties des limbes. La figure de Cimabué
était enveloppée de légendes qui se dissipent peu
à peu. Pietro Cavallini, le grand artiste romain,
précurseur de Giotto, passait pour son élève.
Sur tous ces points et bien d’autres M. v. M.,
admirablement au courant de la « littérature »
de son sujet, présente l’état actuel de nos connais-
sances et des problèmes encore débattus. Et son
jugement personnel fait généralement preuve
d’indépendance1, de pondération et de goût.
S’il est une critique à lui faire, c’est d’être un peu
méticuleux dans ses descriptions, un peu trop
préoccupé de discuter, dans le texte même,
l’opinion des nombreux critiques, allemands ou
autres, qui ont traité les mêmes sujets.
Ajoutons que l’illustration, tout entière à
base photographique, est abondante, l’impression
très soignée, — toute réserve faite au sujet du
« papier couché » — et que d’excellents index
(géographique et biographique) facilitent les
recherches. M. v. M. a choisi pour s’exprimer
une langue œcuménique, l’anglais, qu’il manie
avec presque autant d’aisance que la sienne. On
regrettera peut-être que sa préférence ne se soit
pas portée vers le français, qu’il écrit, nous le
savons, également fort bien ; son choix a pu être
dicté par le précédent de l’ouvrage que le sien
aspire à remplacer auprès du public anglo-saxon.
t . n.
La Peinture au Musée du Louvre. 4 vol. parus.
In-8jésus. L’Illustration, 1924.
L’Illustration a entrepris de publier sous la
direction de M. Jean Guiffrey une série
de i3 volumes consacrés aux différentes
Ecoles de peinture représentées au Musée du
Louvre. Quatre fascicules ont déjà paru : ils sont
1. Par exemple lorsqu’il refuse d’accorder à Be-
renson que les madones O. Kahn et Hamilton sont de
véritables œuvres byzantines (p. 5o3). Voir aussi ce qui
est dit de l’influence de l’art carolingien sur celui des
bénédictins du Mont-Gassin (p. 127 suiv.) contre l’opi-
nion de F.-X. Kraus et de Bertaux.